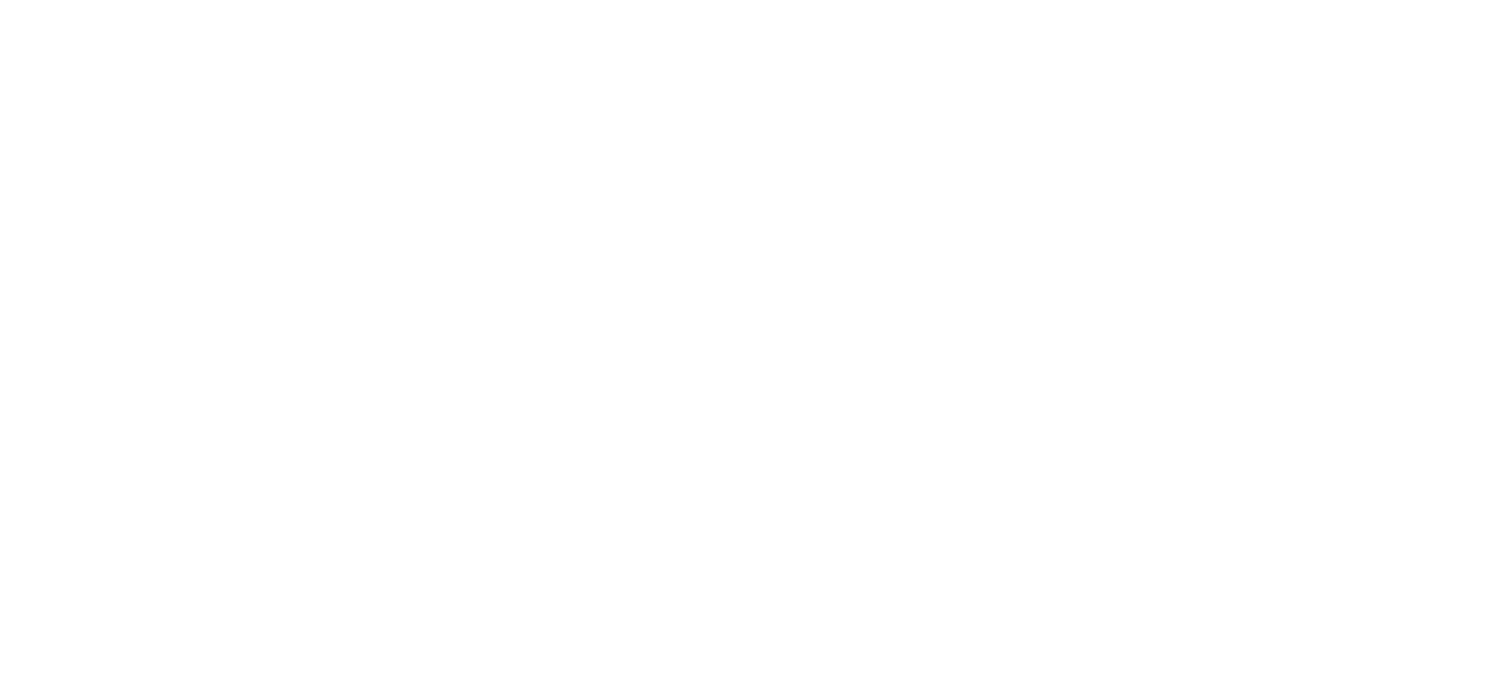Introduction par Marie-Françoise Bechtel, présidente de la Fondation Res Publica, lors du colloque "Quelle architecture de sécurité en Europe ?" du mercredi 26 mars 2025.
Monsieur le Président fondateur,
Chers amis,
Messieurs les intervenants,
Je suis très heureuse de voir une salle aussi heureusement remplie. Ce dont nous nous félicitons.
Ce colloque est le premier par lequel nous tentons d’approfondir un concept que nous devons à notre président fondateur, Jean-Pierre Chevènement : « La France puissance de paix » (nous en tiendrons sans doute deux autres au cours de l’année 2025 dont l’un sera consacré à la question du Moyen-Orient). Quelle ambition y a-t-il derrière une telle vocation à l’heure que nous vivons aujourd’hui ?
Nous mesurons naturellement la difficulté de l’objectif dans la ligne de ce que nous disions lors de nos colloques des 20 février, Occident collectif, Sud global. Qu’est-ce à dire ? et 21 mars 2024, Quelle politique étrangère pour la France ? Vous retrouvez ici et pour cause les trois intervenants de l’un de ces colloques.
Et pour cause car, dans les soubresauts des relations internationales qui marquent pour l’Europe et l’Amérique un parcours chaotique dont nul ne détient la garantie de lisibilité – y compris les acteurs les plus puissants – il est clair que notre pays n’a guère avancé dans ce cheminement qui aurait pu lui rendre une voix audible fût-elle singulière – ou parce que singulière.
La tâche est certes difficile. Nous avons besoin d’abord de lisibilité d’une situation que les débats médiatiques et politiques présentent comme simple au prix de l’évacuation de l’histoire des dernières décennies. C’est pourtant dans le mouvement de l’histoire et non dans le monde plat d’une actualité rendue illisible par le défaut de l’analyse et l’empressement des idéologies qu’il faudrait rechercher la clé ce qui nous arrive.
Les soubresauts actuels de la guerre d’Ukraine, les voies tantôt frontales tantôt détournées empruntées par les diplomaties des pays en cause, semblent se fondre en une sorte de tintamarre d’où émergent des nouvelles plus ou moins fracassantes, nouvelles d’un jour parfois démenties le lendemain.
Dans cette actualité faiblement lisible qui est aujourd’hui le lot de notre continent il y a comme un grand absent : quel est l’objectif d’avenir qu’il serait bon de poursuivre en termes d’intérêt national ? Et à le supposer défini, comment cet objectif s’articulerait-il avec un projet existentiel, un projet d’avenir pour notre continent ?
Le vacarme médiatique alimenté par les analyses au premier degré – nourries des excentricités d’outre-Atlantique – qui jouent le rôle de l’arbre qui cache la forêt tout en fournissant un prétexte quasi quotidien aux responsables politiques et aux médias d’analyses dépourvues de tout recul quant aux sérieux des questions qui devraient se poser
Faiblesse des questions, faiblesse des réponses.
Des réponses d’abord. Car avant même les questions qui devraient être correctement posées il y a aux yeux de la plupart des responsables de note continent une réponse : la défense européenne. Mais de quoi s’agit-il vraiment ? Et de quoi d’ailleurs peut-il s’agir dès lors que l’objectif est défini sans que soit perceptible l’analyse sérieuse qui le fonde ?
Est-il en effet incorrect de rappeler que l’architecture de sécurité en Europe destinée à pallier le désengagement des États-Unis de l’OTAN ne souffre pas seulement des faiblesses de la mise en place d’une hypothétique économie commune de la défense ? Celle-ci est certes à court terme un problème incontournable. Au titre des interventions médiatiques trop rares sur cette question je citerai celle de Natacha Polony qui dans un récent article relevait que les conditions de fond pour une autonomie stratégique européenne étaient l’indépendance militaire et l’indépendance énergétique qui l’une et l’autre font défaut.
De son côté Nicolas Baverez évoquait dans une récente tribune le « fantôme de la Communauté européenne de défense » qui devait échouer en 1954 en estimant que le contournement des États aujourd’hui entrepris par la Commission européenne fragilisera encore la sécurité de notre continent
Faiblesse des réponses mais aussi faiblesse des questions : c’est donc qu’il faut remonter en amont pour rechercher les conditions de mise en place d’une défense européenne qui pourraient fonder une réponse légitime.
Mais il y a là encore une grande absence dans le questionnement : sur quelle analyse politique et géopolitique l’idée d’une architecture future de sécurité repose-t-elle ? C’est le point majeur.
Or s’il est un domaine où le passé peut légitimement inspirer le présent c’est bien le positionnement international des puissances – ce ne sont pas les lecteurs de Kissinger qui sont à cette table qui me contrediront… – En d’autres termes on ne source pas suffisamment dans le débat public les raisons qui ont conduit notre continent à la situation présente.
Au contraire on reste frappé par le côté infantile d’analyses sans profondeur historique où finalement le journaliste adopte le ton de l’invité, à moins que ce ne soit l’inverse. Il est pourtant essentiel d’approfondir la question de l’après avec celle de l’ensuite. L’une et l’autre doivent être articulées et il est fort léger de penser que pour cela on peut se dispenser d’analyser l’histoire et non la seule actualité. On est ainsi conduit à se demander si cette légèreté ne fait pas partie du problème. Surtout si l’on se remémore les propos de Kissinger que vous avez l’un et l’autre cités : La paix de Westphalie a duré 150 ans, celle du Congrès de Vienne cent ans (1815-1914) et le traité de Versailles fait aujourd’hui figure de parenthèse
Quelle est la manière sérieuse d’aborder la question ? Je laisserai bien entendu nos sages intervenants déployer une analyse qui nous changera du prêt-à-porter actuel et ferai seulement une remarque préliminaire : nous sommes en plein dans ce que Thierry de Montbrial appelle au sens strict la géopolitique, c’est-à-dire l’idéologie attachée aux territoires et non, comme on le dit communément aujourd’hui, les relations internationales. Dit autrement une analyse véritable des relations internationales ne peut se passer de considérations géopolitiques. Or cette différence est ici d’une portée considérable
Quoi en effet de plus « géopolitique » que la question de l’avenir de l’Europe que nous abordons ce soir sous l’angle de sa sécurité future ? Nous avons bien ici des territoires marqués par des idéologies différentes dont un part seulement est commune :
Avec tout d’abord la Russie et l’Ukraine nous sommes en plein dans la question territoriale marquée par l’idéologie, il n’est pas besoin d’en rappeler les différents stades historiques jusqu’à Maïdan.
Avec ensuite un territoire, celui de l’Union européenne, fait d’ensembles de nations dont l’unité réelle ou supposée est quant à elle une donnée très récente de l’histoire à supposer que cette unité ne soit pas une simple idée.
Avec en effet à l’intérieur de ce territoire, de l’Atlantique à la Vistule, les positions parfois hétérogènes de nombreux pays européens : on a pu assister à la façon dont leurs fondamentaux historiques jouaient dans leurs positions : c’est évident bien sûr pour la Pologne ou les Pays baltes mais aussi pour la France dont l’évolution récente a marqué à quel point la volonté européiste a fini par dominer quelques fondamentaux de notre relation avec l’Est du continent, étant observé que la position géographique de la France rend beaucoup plus inconfortable pour elle aussi bien d’entrer dans un ensemble uni qui l’étouffera que de rester aux marges. Un dilemme qui reste peut-être à mesurer.
Et que dire de l’entrée en scène du Royaume-Uni, toujours de retour sur le continent en cas de crise des puissances (aujourd’hui suivi de l’armada de quelques grands pays du Commonwealth) qui n’entend pas plus aujourd’hui qu’hier être absent d’un avenir du continent où sa position de puissance doit être reconnue.
Enfin, pour en revenir aux évidences, le retour à cette sorte d’isolationnisme interventionniste qui caractérise aujourd’hui la politique des États-Unis.
Je finis ce propos liminaire en me tournant vers nos intervenants.
Si nous les avons conviés ici, vous le comprenez en creux de ce que j’ai dit, c’est pour deux raisons qui se renforcent l’une l’autre.
De par ce que vous avez publié nous savons que votre niveau de réflexion est à l’inverse des innombrables analyses que nous entendons tous les jours. L’autre raison c’est que de longue date vous avez creusé un terrain qui demande en effet la connaissance de l’histoire, celle de la diplomatie fondée, je le disais, sur la géopolitique, celle des relations réelles des pays réels et des hommes réels. Et que devant une question d’une actualité brûlante il est essentiel de ne pas s’en tenir à l’immédiat, cet immédiat qui, je crois, nous fait aujourd’hui tant de mal. Et qui n’est pas pour rien sans doute dans l’angoisse qui saisit l’ensemble des générations qui sont aujourd’hui devant l’insécurité de notre continent alors qu’on leur a dit pendant des décennies que la paix était quelque chose d’absolument garanti pour le futur et qu’ils n’avaient pas même à songer à la notion de guerre.
Encore faut-il avoir sérieusement labouré le terrain pour sortir du psittacisme médiatico-politicien. C’est ce que vous avez fait chacun à votre manière et c’est pourquoi il sera très précieux de vous entendre ce soir.
Nous entendrons Jean de Gliniasty, ancien ambassadeur de France à Moscou (2009-2013), directeur de recherche à l’Iris, auteur, notamment, de La Russie, un nouvel échiquier (Eyrolles, 2022) et de France, une diplomatie déboussolée (L’inventaire, 2024).
Lui succédera Thierry de Montbrial, président fondateur de l’Institut français de relations internationales, président de la World Policy Conference, auteur, récemment, de L’ère des affrontements : Les grands tournants géopolitiques (Dunod, 2025) où il reprend et remet à jour chapitre par chapitre un certain nombre d’analyses qu’il a faites depuis 1998. Je noterai aussi sa très belle introduction dans le Ramsès 2025 dans laquelle il pose nombre de questions qui sont en relation avec ce que nous allons dire ce soir.
Pierre Lellouche enfin, ancien secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, ancien président de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, ancien député, auteur de Engrenages (Odile Jacob, 2024).
Jean de Gliniasty, vous aviez conclu votre intervention dans le précédent colloque sur la politique étrangère de la France en mentionnant l’absence de projet d’autonomie stratégique de l’Europe. C’était avant les bouleversements infligés, quoi qu’attendus, par la nouvelle administration américaine. Aujourd’hui, comment voyez-vous le contexte politique et diplomatique dans lequel infuse la question d’Ukraine ? et quelles sont à vos yeux les données nouvelles – ou pas – quant à une sécurité européenne future ?
—–
Le cahier imprimé du colloque « Quelle architecture de sécurité en Europe ? » est disponible à la vente dans la boutique en ligne de la Fondation.
S'inscire à notre lettre d'informations
Recevez nos invitations aux colloques et nos publications.