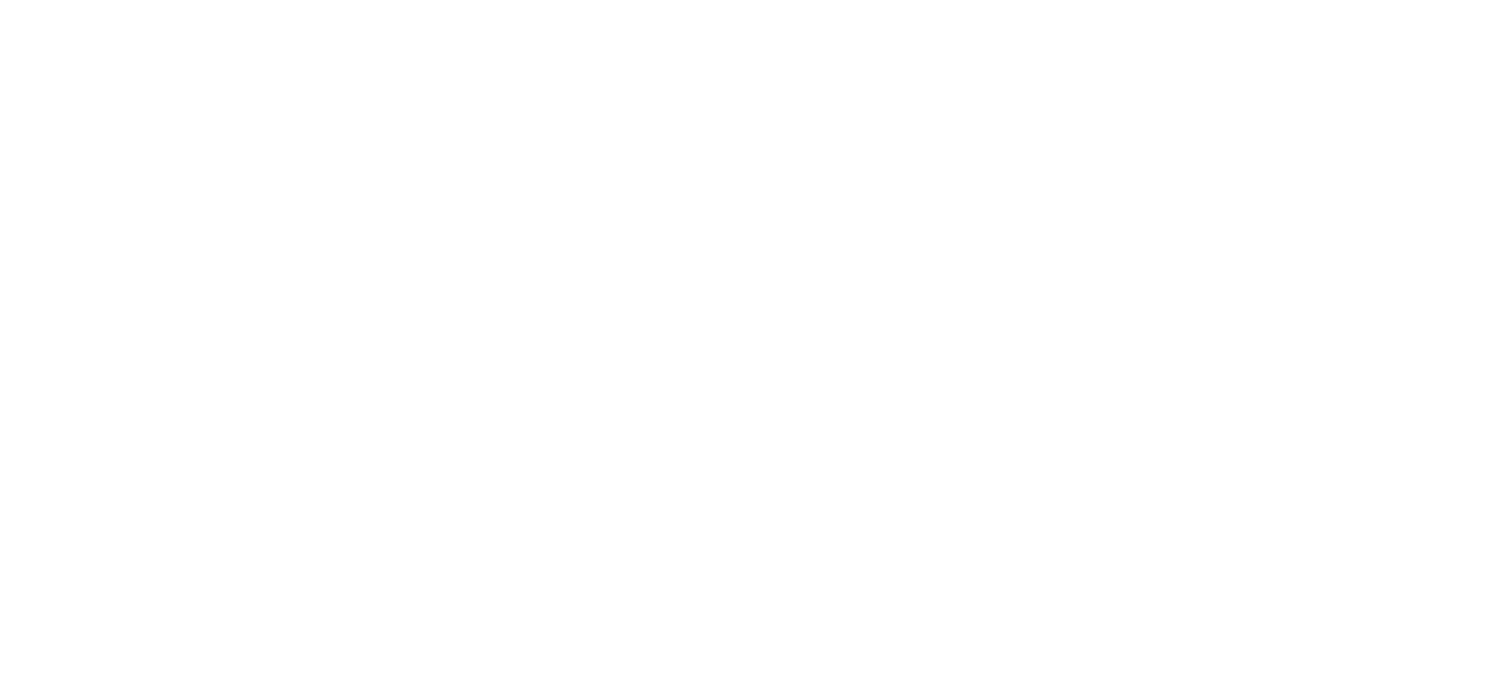Retrouver le peuple
Intervention de Marie-Françoise Bechtel, conseiller d'État (h), ancienne vice-présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, présidente de la Fondation Res Publica, lors du colloque "Comment les institutions de la Ve République peuvent-elles évoluer ?" du mardi 15 octobre 2024.
C’est un exercice redoutable que de prendre la suite d’interventions aussi brillantes que celles qui précèdent. La puissance d’analyse de nos trois intervenants oblige notre Fondation dans les deux sens du terme. Elle nous fait un honneur que nous mesurons, tout en nous contraignant à regarder les choses d’en haut, ce lieu si peu fréquenté s’il faut en croire un grand homme d’État…
Tentons d’abord une synthèse par définition réductrice. Ce qu’il y a au fond de commun dans les analyses si riches que nous avons eu le privilège d’entendre est que la fracture entre le haut et le bas est l’élément dominant de la crise qui frappe notre démocratie. Chacun l’a dit à sa manière. Et c’estce constat qui induit les questions d’avenir.
I/ Le constat devrait d’abord nous conduire à ne pas inverser les effets et les causes : le désarroi du peuple français n’est pas la cause de nos difficultés institutionnelles.
C’est un lourd travail que de s’attaquer comme nous essayons de le faire ici à un débat public littéralement infesté par les fausses vérités. Que disons-nous en effet ici ? D’abord qu’il ne suffit pas de constater que les couches populaires se sentent délaissées comme le notent tant de spécialistes de la chose politique tout en omettant de voir qu’il y a cela une excellente raison : c’est qu’elles le sont effectivement. La plupart de nos politistes ont lu Guilluy et Fourquet : mais ils en tirent les conséquences les plus erronées qui imprègnent à leur tour l’esprit de politiciens en mal de remèdes. Non, les « passions tristes » ne sont pas la cause du dérapage de nos institutions, c’est l’inverse qui est vrai. Ce n’est pas le désamour populaire qui mine au départ celles-ci mais l’abandon de l’intérêt national par ceux qui ont la charge de le faire vivre[1].
Je vois dans ce constat le point nodal de notre colloque : chacune des interventions que nous avons entendues en a magistralement décortiqué les causes et les effets dans leur relation avec la vie de nos institutions. Jean-Éric Schoettl a démontré implacablement, en allant selon son habitude au fond des choses, que l’abandon de l’exigence républicaine est ce qui mine celles-ci, qu’il s’agisse des juges, du Parlement, des autorités politiques, auxquels on peut ajouter les médias. Il l’a même analysé avec une précision chirurgicale en montrant pourquoi le passage à la représentation proportionnelle au Parlement, sous quelque forme que ce soit, loin de porter remède à cet abandon, serait une mauvaise réponse aux vraies questions qui minent l’électorat : plus qu’un méfait en somme, une erreur historique sur les conditions nécessaires d’exercice de la souveraineté[2]. Marcel Gauchet portant le regard sur l’état de la société démocratique, a labouré un terrain fertile en découvertes, pour en extraire, par le patient travail inductif dont il a le secret, quelques pépites qu’il a savamment reliées entre elles. La conclusion que l’on pourrait en tirer est que ce n’est pas dans le dur des institutions qu’il faut chercher la clé d’une rénovation de notre vie publique mais dans deux directions, celle de nos engagements européens et celle de l’affaissement des partis politiques sur fond d’évolution pathogène de la société.
Last but not least, Jean-Yves Autexier, convoquant son expérience de parlementaire et d’entomologiste du terroir nous a régalés de fulgurances qui ont illustré avec une amère saveur la dissociation du national et du local. Entre nombre de propos incisifs, il a montré combien les regrettables réformes du découpage régional et des intercommunalités à marche forcée ont contribué à déchirer un peu plus encore le tissu national.
Au total donc que de réformes inutiles et nuisibles auront été mise sur le métier, aggravant encore le divorce entre le haut et le bas ! Jean-Éric Schoettl en a fait le compte et le jugement sévère qu’il porte sur la quasi-totalité d’entre elles, incluant le projet ou faut-il dire l’hypothèse du passage à la représentation proportionnelle, nous laisse bien dans le registre du « haut » contre le « bas ».
Je reviendrai sur deux points qui me semblent essentiels.
D’abord, la méconnaissance profonde du second par le premier qui s’est illustrée dans l’artifice des « conventions citoyennes » et autres débats fabriqués sur mesure sont la démonstration même que l’éparpillement et la thématisation ne sont, sous couleur d’appel aux initiatives du « terrain », que le dernier état du renoncement à la recherche d’un élan national collectif.
Ensuite, et c’est à mes yeux un point majeur, le contrepoint de cette méthode qui n’a de démocratique que le nom est dans la leçon de démocratie infligée aux élites dirigeantes par le référendum de 2005 sur la « Constitution européenne ». Je voudrai insister sur ce moment historique : il aura joué un rôle essentiel dans la question de l’avenir de nos institutions au point qu’on puisse le regarder comme un pivot :
- d’abord en démontrant que le peuple français dans son ensemble répond présent lorsqu’on lui propose de s’investir dans un débat collectif sur son avenir. Il s’y est même ardemment prêté sous l’œil effaré d’un Président de la République qui avait largement sous-estimé la capacité du peuple à se passionner pour une question qu’il croyait d’une rassurante obscurité[3] ;
- ensuite en s’emparant – pour la première fois – de la question européenne dans toute sa clarté, tout en montrant qu’il en avait parfaitement compris les enjeux : ceux-ci étaient clairs, la réponse le fut aussi ;
- enfin en prouvant l’utilité de l’appel direct au suffrage populaire pour les grandes questions touchant l’avenir du pays : le taux de participation l’a montré.
Ce succès historique et populaire du référendum sur notre avenir européen ne se borne pas à mettre en lumière le contre sens plus ou moins innocent qui fonde le désarroi institutionnel sur les « passions négatives ». Il fait a contrario des mécanismes inventés depuis lors autant de fausses fenêtres. La parole du peuple français résonne haut et clair lorsqu’on lui parle de l’avenir de la France ? Qu’à cela ne tienne… on ne le consultera plus. Et en effet d’ailleurs on ne le consulte plus depuis lors sur aucun sujet majeur : les occasions n’ont pourtant pas manqué du Traité de Lisbonne (ratifié en 2009) au Traité sur la gouvernance en Europe (ratifié en 2012), mais aussi sur l’opportunité d’un redécoupage de la France en grandes régions (loi de 2014) ou encore – quoique cela reste en théorie possible – sur l’élargissement de l’Union européenne.
Aucun raisonnement de politologue ne tient devant ce constat : on avait trouvé le peuple en 2005 on l’a perdu depuis, privilégiant au contraire l’émiettement des aspirations supposées ou réelles des Français, la catégorisation des citoyens, la représentativité fabriquée à coups de tirage au sort ou de préemption du milieu associatif. Or tout cela simplement ne marche pas. Mieux ou pire : la fabrique de ces faux consensus sans base populaire et citoyenne accrédite plus encore dans de larges parts de l’opinion et non sans raison le fait qu’on amuse la galerie en la tenant à l’écart des questions décisives. Il fallait le dire et je crois que nous le disons ici avec force.
II/ Que résulte-t-il de ces analyses partagées ? Quelles indications, à défaut de prescriptions, pour l’avenir ?
La question des partis est à mes yeux primordiale. Entre un gouvernement structurellement instable, un Président sans audience et une assemblée réduite à un pouvoir de nuisance, il sera impossible de miser sur l’avenir de nos institutions si des partis en phase avec l’électorat ne se reconstruisent pas. Rien ne pourra fonctionner sans eux, la situation actuelle le démontre.
Car la crise institutionnelle que connaît la France, fruit d’un lent délitement de la confiance dans la classe politique qui a connu son point d’orgue avec ce moment de rupture que fut le traité de Lisbonne, est d’abord une crise des partis. Les seize années qui ont suivi cette violation explicite de la volonté populaire ont principalement servi à renforcer l’alliance implicite qui s’était nouée au moment de Maastricht entre les deux principaux partis de gouvernement. Le temps est donc venu, et c’est ce qu’exprime le vote protestataire sous ses différentes formes, du choix binaire entre l’européisme sans recul et son rejet sans nuances. Or sur cette question le blocage est quasi-total. L’intérêt électoral et la cause européiste qui devraient s’opposer contribuent en réalité à renforcer le blocage.
L’intérêt électoral, tout d’abord, ne permet que quelques échappées ponctuelles : on l’a vu avec la campagne européenne du parti socialiste suivie d’un retour à l’alliance avec les composantes de la Nupes qui ne s’explique que par les besoins électoraux – au sein desquels on n’aura garde d’oublier les municipales de 2026. Faut-il d’ailleurs que l’appétit électoraliste soit fort pour que seul l’enjeu de la construction européenne puisse y faire obstacle – momentanément il est vrai.
Ce constat peut d’ailleurs laisser rêveur si l’on considère que, à l’inverse, la cause européiste tient si fort à cœur aux partis dits de gouvernement qu’elle va jusqu’à mettre en cause, hors l’épisode cité ci-dessus, leurs intérêts électoraux, au point de les laisser perdre tous partis confondus des centaines de sièges ! Fait aveuglant : pour que le ciment de l’union implicite qui s’est créée au moment de Maastricht entre les deux grands partis de gouvernement reste si fort, il faut que quelque chose dans la cause européenne exprime le noyau dur de leur identité. Ce quelque chose est facile à trouver en ce qui concerne la droite de gouvernement : depuis le Marché unique, l’Europe met en actes l’ouverture à la concurrence, l’affaiblissement des services publics, la logique financière comme guide de l’économie, toutes réformes à marche forcée que l’on ne pourrait conduire au plan national alors qu’elles correspondent à l’identité politique traditionnelle de ces partis une fois refermée la parenthèse gaulliste. En contrepartie à quoi renoncent-t-ils ? Principalement à la maîtrise des questions de sécurité et d’immigration – ce qui leur coûte cher. On en déduira sans difficulté que l’économique a pris le pas sur le régalien avec des traductions oratoires et des traces de remords qui, sur le fond des choses, relèvent de la nuance. S’agissant de la gauche de gouvernement, il pourrait a priori sembler plus difficile de comprendre la persistance du credo de l’« Europe qui protège » : ce credo est tellement à rebours des réalités qu’il suffit de creuser à peine pour y trouver sa vraie racine qui est le rejet de la nation, l’Europe à tout prix fût-ce au prix du sacrifice de la question sociale – qui lui coûte également cher. De sorte qu’aujourd’hui les choses sont claires aux yeux du peuple français : la droite dite républicaine comme la gauche socialiste ont renoncé à la nation que ce soit sous sa forme généralement patriotique ou sous sa forme spécifiquement française d’un État social. Ni de Gaulle ni Jaurès ne peuvent plus tenir lieu de référent. C’est simple, c’est clair, si clair même que, reprenant des analyses qui n’étaient pas au départ les siennes, le RN a su parfaitement combler le vide : on a vu récemment encore comment, accompagnant le tapage sécuritaire, son virage vers la conscience sociale a achevé de dépouiller de ses sièges non seulement le parti socialiste mais un parti communiste qui n‘a pas su analyser à temps ce qui se passait et se trouve aujourd’hui pris dans des alliances où se joue sa survie… électorale justement.
A ce tableau il est utile d’ajouter la vraie fausse percée des partis du centre : la « révolution » macronienne a décliné à l’envers la « rupture » qui avait fondé son succès fulgurant. Loin de négocier une Europe conforme aux invocations de campagne électorale, plus puissante dans le monde, plus en phase avec les aspirations populaires, en suggérant la mise en cause des règles qui font obstacle à la réindustrialisation de la France, son aménagement du territoire, voire la mise en place de services publics de qualité, le président de la République a choisi d’adapter la France à l’agenda néolibéral à travers le vecteur communautaire. Totale erreur d’appréciation : les esprits étaient mûrs pour un changement du système partisan mais le porteur de ce changement n’était pas mûr dans sa compréhension des aspirations du peuple français ou, s’il les a comprises, dans sa volonté de leur donner quelque consistance. La seconde hypothèse semble a posteriori la plus probable.
C’était la dernière chance donnée aux partis « républicains ». Et c’est bien de cet échec que provient l’apparente crise institutionnelle : la fragmentation des partis qui en résulte empêche tout « fait majoritaire » et bloque en même temps les mécanismes prévus dès lors que le Président a épuisé trop tôt l’arme dont il dispose. L’enchaînement de la motion de censure et de la dissolution ne fonctionne pas dans un contexte que les pères de la Constitution n’avaient sûrement pas prévu.
Mais cet épuisement des procédures n’est en réalité que l’effet du délitement des partis. Le phénomène majeur est dans le lien devenu évident entre l’absence de confiance dans la classe politique et la prise de conscience que les élites françaises, incluant les politiques, jouent l’Europe contre la France. Il faut mesurer l’effet de cette fracture en comprenant à quel point la construction européenne, cette grande ombre portée sur le destin de la France, est aujourd’hui l’élément majeur qui perturbe le jeu normal des institutions. Certes ce fait n’incombe pas en soi à l’« Europe » qui n’est en elle-même pas autre chose que ce que l’on en fait. Il incombe au renoncement des gouvernants, c’est-à-dire des partis qui les ont portés au pouvoir. C’est le blocage sur la question européenne qui empêche aujourd’hui l’alternance. Dès lors, tant que les partis de gauche et de droite ne se seront pas reconstruits en intégrant cette donnée majeure ils ne pourront se faire entendre du peuple français. L’hypothèse d’un gouvernement ou d’une présidence RN a, chacun le sait, perdu de son improbabilité. Mais il ne disposerait que d’un fusil à un coup. Or ni une stratégie d’« alignement négocié » à l’italienne ni la désobéissance aux règles européennes les moins acceptables, ni surtout la capacité de négociation dans un rapport de forces bien mesuré, qui sont les trois hypothèses que l’on peut faire si le RN venait à décider des destinées de la France, ne semblent soit efficaces soit à sa portée.
Comment faire fonctionner des institutions avec un pareil désaveu populaire des partis dont le RN ne fait que combler le vide ? Mais comment espérer les voir se reconstituer ?
En vérité deux causes fondamentales expliquent aujourd’hui le rejet et l’effacement de partis. Sur le fond, c’est-à-dire le programme, leur délitement on l’a dit, tient à leur rejet des impératifs nationaux au profit de la logique bruxelloise dont l’emprise ne cesse de s’accentuer d’une façon désormais visible. Quant à leurs moyens d’action, l’effacement va de pair avec la disparition du militantisme. Il reste délicat de savoir s’il existe entre ces deux causes un lien nécessaire.
Certes le militantisme a déserté pour les raisons qui ont été analysées par les trois intervenants précédents. Mais ces mêmes raisons – atomisation des modes de réaction aux enjeux collectifs, évolution de la société vers le communautarisme permissif et le moralisme individualiste ainsi que le repli sur un localisme rassurant – relèvent peut-être autant des effets que des causes. Si appel n’est pas fait à ce qui peut rassembler, il ne faut pas s’étonner que, à gauche comme à droite, une sorte d’individualisme combatif (et souvent déclaratif) sans lendemain reste dominant. C’est encore une leçon à tirer a contrario de l’expérience du référendum national : qui peut douter que si demain on posait aux Français la question de leur avenir européen on ne retrouverait pas les éléments d’une vraie campagne, avec mobilisation collective et discussions internes au sein des partis, sans préjudice des nouveaux canaux d’expression que sont les réseaux sociaux ? Autre constat : la résilience de valeurs comme la nation, l’autorité (incluant l’approbation d’un service national obligatoire et universel), la laïcité, dont témoignent avec constance les sondages montre bien que le politique reste bien dans le génome français, là où la politique entraîne mépris voire détestation. La bacchanale des passions différentialistes ne serait-elle alors qu’un accompagnement ? Lorsque le cortège principal, celui de la République est vide, alors les micro-actions protestataires et le tourbillon médiatique autour des questions sociétales tiennent c’est le cas de le dire le haut du pavé… A-t-on d’ailleurs suffisamment mesuré a contrario que les protestations sociales qui se sont enchaînées autour de la réforme des retraites exprimaient à leur manière ce désir de collectif qui caractérise le peuple français, peut-être réuni en cette récente et dernière occasion sur une grande question d’intérêt commun au-delà des corporatismes ? Quoi que l’on pense du contenu des protestations, leur forme est ici essentielle en ce sens qu’elles ont aussi exprimé la possibilité d’un retour du militantisme.
Tout cela est bel et bon dira-t-on. Mais que faites-vous du parallélisme entre la situation française et la crise d’autres démocraties et non des moindres : délitement des partis de la coalition allemande et montée de l’AfD, triomphe populaire du trumpisme et même montée protestataire dans un pays comme le Royaume-Uni où un mode de scrutin particulièrement brutal est le seul rempart contre l’expression de celle-ci dans les urnes, sans parler de l’exténuation prévisible de son modèle communautariste ? Ces faits ne doivent-ils pas nous conduire, comme l’a dit Marcel Gauchet, à prendre en considération les mouvements de fond qui ont transformé en désirs sociétaux les impératifs des luttes sociales traditionnelles dans une société où comme l’ont illustré Jean-Éric Schoettl et Jean-Yves Autexier, le collectif a peut-être pour longtemps cédé la place à l’individuel ?
On ne peut qu’être d’accord avec ces constats mais ferment-ils totalement la porte à l’avenir ? On ne fera ici que des hypothèses…
– Il y a d’abord la spécificité du peuple français, « peuple politique » comme l’a souvent rappelé Jean-Pierre Chevènement, qui n’est vraiment lui-même que lorsqu’il se mobilise pour une cause commune, la condition étant que celle-ci soit en lien avec son « imaginaire » – nous retrouvons ici l’analyse de Stéphane Rozès citée plus haut. Au sein des crises que vivent nos démocraties, n’y-a-t-il pas un quid particulier à notre nation, avide de combats mais aussi de synthèse des débats par le haut ? Et c’est pourquoi d’ailleurs le référendum sur des objectifs d’intérêt national est si « appelant » pour cette nation faite, comme le disait le président Mitterrand, de « Gaulois, de Celtes belliqueux et tumultueux ». Résoudre la querelle par le haut appelle un désir du collectif lequel à son tour demande une traduction que seule une organisation de nature politique peut offrir. Or les deux partis qui aujourd’hui disposent d’un réseau actif de militants à défaut certes d’organiser beaucoup de débats avec leur base, LFI et le RN, ne comprennent pas le besoin de dépassement de la « querelle » par la verticalité. C’est probablement la raison pour laquelle ils auraient le plus grand mal à disposer d’une majorité parlementaire. Il y a donc un besoin non pourvu : qu’il trouve une réponse n’est ni certain ni impossible.
– Autre hypothèse d’avenir : l’ordre économique néo-libéral qui a fait exploser les partis ne pourrait-il, à travers les crises qu’il déclenche, incluant sa propre remise en question, contribuer à remobiliser des forces organisées[4] ? Qu’en sera-t-il demain des classes moyennes, enseignants, juges, cadres d’entreprise, ingénieurs, qui n’appartiennent ni aux élites en sécession selon le terme de Jérôme Fourquet ni aux couches populaires en révolte larvée ? Lorsque la théorie dite du « ruissellement » aura achevé de montrer ses limites sauront-elles ou non contribuer à définir une alternative collective ? Largement adeptes aujourd’hui de combats sectoriels et d’une cause écologiste très mal reliée aux grandes questions d’avenir, resteront-elles prisonnières encore longtemps du mythe de l’action individuelle et des causes ponctuelles ? Surtout, un langage commun, fait de valeurs partagées, avec les couches populaires peut-il encore se reconstituer ? La réponse est évidemment négative si l’on s’en tient au constat qui a été dressé du triomphe d’un consumérisme marchand mais aussi culturel qui est le vrai facteur de clivage. Là est toute la question : les abus de revendications sociétales qui parfois d’ailleurs se contredisent, l’ère de la dénonciation permanente, le choc de la permissivité absolue fondé sur la « liberté » d’accès aux réseaux sociaux et la répression morale et sociale finiront peut-être par lasser faute d’avoir épuisé leurs inépuisables causes. Ou bien la démocratie française comme quelques autres cédera à une entropie dont on dira rétrospectivement qu’elle était dans ses gènes…
Conclusion : Crise politique ou crise historique ? Nous ne pouvons qu’en rester au stade des hypothèses. Quand le grand vent de l’histoire aura balayé nos crises internes, que ce soit pour nous détruire ou pour nous reconstruire, nos descendants y verront plus clair. Aujourd’hui « la croix du présent » appelle peut-être « la rose de la raison »[5] mais nous ne pouvons décrypter l’avenir. En revanche tenir bon le cap républicain en attendant que la barre aille dans la bonne direction est la modeste mais résolue contribution qui est la nôtre… Nous le ferons en gardant en tête, au-delà du tumulte et des crises, le seul schéma possible pour l’avenir : en ordonnée, des institutions dignes de notre souveraineté[6] ; en abscisse, l’horizontalité des aspirations populaires. Tant que celles-ci seront refoulées au lieu d’être exprimées les institutions françaises continueront à tanguer
[1] Stéphane Rozès a donné de ce constat une interprétation magistrale dans son ouvrage Chaos, Essai sur l’imaginaire des peuples (Éditions du Cerf, 2023), sur lequel une note de lecture a été publiée sur le site de la Fondation Res Publica.
[2] Voir le débat entre Benjamin Morel et Marie-Françoise Bechtel sur le thème « Pour ou contre une proportionnelle intégrale aux prochaines législatives », publié sur le site de République Moderne le 8 janvier 2021.
[3] Comme ce fut le cas avec le référendum de Maastricht.
[4] C’est une des deux hypothèses envisagées par Stéphane Rozès dans l’ouvrage précité, non il est vrai la plus crédible selon lui…
[5] Hegel, Phénoménologie de l’esprit
[6] La place manque ici pour développer par quelles voies la souveraineté populaire pourrait réaffirmer sa juste place dans la construction européenne. Cf. le chapitre 2, consacré à cette question, dans l’ouvrage collectif de notre Fondation : Res Publica. 20 ans de réflexions pour l’avenir (Plon, 2024).
Le cahier imprimé du colloque « Comment les institutions de la Ve République peuvent-elles évoluer ? » est disponible à la vente dans la boutique en ligne de la Fondation.
S'inscire à notre lettre d'informations
Recevez nos invitations aux colloques et nos publications.