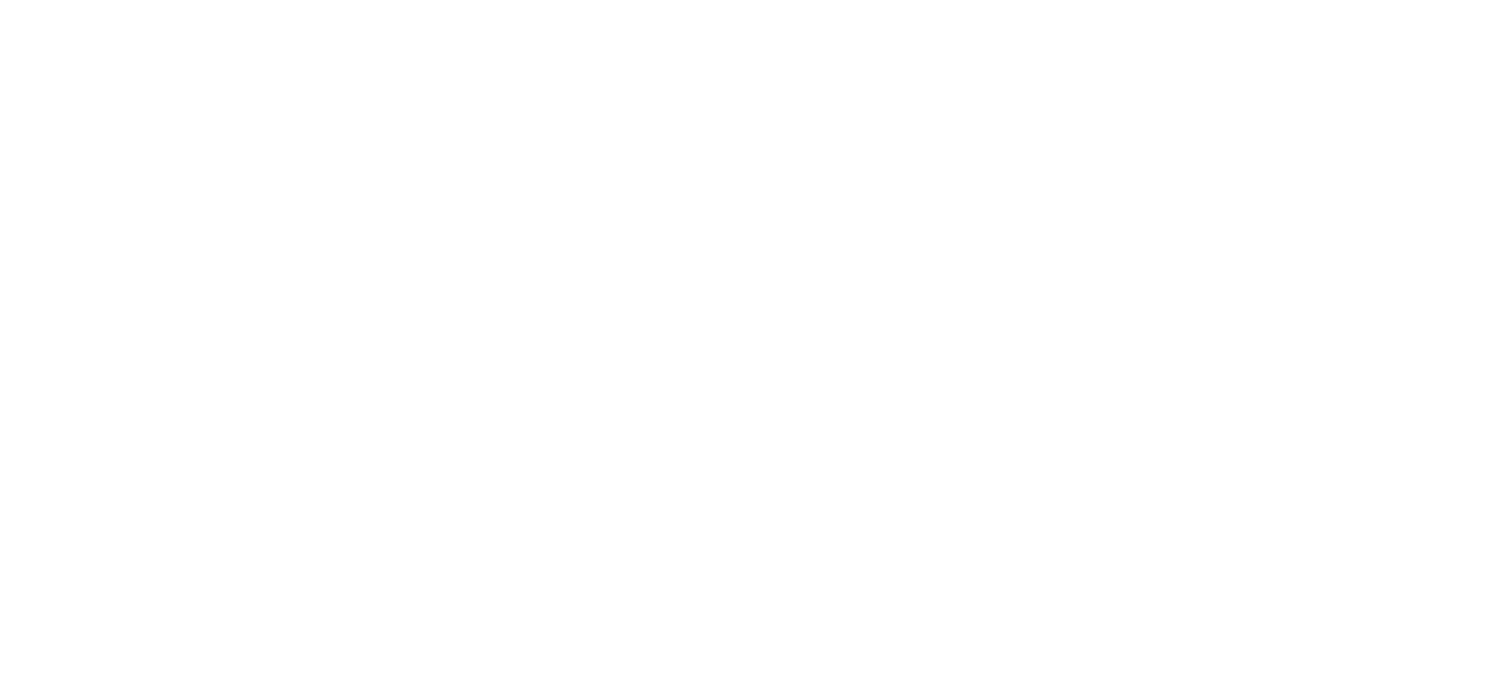Architecture de sécurité en Europe : une nécessité
Intervention de Thierry de Montbrial, président fondateur de l’Institut français de relations internationales, président de la World Policy Conference, auteur, récemment, de L'ère des affrontements : Les grands tournants géopolitiques (Dunod, 2025), lors du colloque "Quelle architecture de sécurité en Europe ?" du mercredi 26 mars 2025.
Bravo à Jean de Gliniasty. Nous sommes tout à fait « en ligne ».
Je vais faire une petite translation vers le futur puisque Pierre Lellouche abordera la question des scénarios pour l’avenir.
Commençons par deux ou trois remarques complémentaires pour compléter ce qu’a dit Jean de Gliniasty :
Comme il l’a dit, la mise en place d’une architecture de sécurité européenne comporte un aspect diplomatique global. Helsinki a été à cet égard un exemple très intéressant : je rappelle que ce furent les Soviétiques qui étaient demandeurs à l’origine et que les Occidentaux avaient d’abord refusé. Finalement, les Soviétiques avaient accepté un processus qui s’est retourné en leur défaveur pour des raisons facilement analysables qui montrent que parfois on peut rentrer dans des négociations avec certaines hypothèses et, lorsque ces hypothèses sont invalidées par les faits, être pris en défaut par cela même qu’on a voulu. C’est très intéressant mais je n’insiste pas là-dessus.
Je voudrais insister sur l’arms control, la maîtrise des armements qui a commencé après Cuba. Lors de la crise des missiles de Cuba on avait frôlé un conflit nucléaire réel. Le drame c’est que toute cette approche diplomatique, unique dans l’histoire du monde – ce fut une innovation diplomatique majeure du XXème siècle – a été abandonnée par la suite. D’ailleurs les Russes ont beaucoup regretté la destruction du savoir qui allait avec ce type de diplomatie.
Je voudrais aussi rappeler que la chute de l’URSS fut une combinaison de deux événements : la chute du communisme, bien entendu, mais, plus fondamentale encore peut-être du point de vue géopolitique, la chute de l’empire russe, le dernier empire du XXème siècle. L’histoire du XXème siècle est une histoire de chutes d’empires : après la Première Guerre mondiale les empires allemand, austro-hongrois, ottoman ; après la Seconde Guerre mondiale les empires coloniaux. Il ne restait que l’empire russe qui s’est effondré comme les tours de New York, d’un seul coup. Un événement unique, historiquement extraordinaire et largement inattendu.
Lorsque sont apparues les premières fissures, en 1986, à Almaty au Kazakhstan, les troubles s’étaient limités à quelques dizaines ou centaines de victimes dans les manifestations.
Mais la chute d’un empire, surtout quand elle s’accompagne de très peu de troubles, produit des conséquences pendant des décennies. Un petit nombre de personnes l’ont remarqué dès le départ mais on n’a pas voulu le voir, au nom d’une idéologie que j’appelle « l’équation de Fukuyama », une équation chimique en quelque sorte : démocratie et économie de marché entraînent paix et prospérité et réciproquement. Du point de vue logique c’est une tautologie. C’est une évidence si on considère les conceptions abstraites de chacun des quatre termes ou alors ce sont des questions de processus historiques, ce qui en change complètement l’interprétation.
En réalité il faut bien voir que les années 1990 ont été marquées pour la Russie par un effondrement total. Il se trouve que je l’ai beaucoup visitée pendant toute cette période. On constatait que « tout foutait le camp ». Les professeurs d’université devenaient chauffeurs de taxi, et encore… (il fallait survivre), les centres de recherche s’effondraient. Je me souviens d’une conversation avec le conseiller national pour la sécurité du Kremlin (où l’on pouvait quasiment aller sans prendre de rendez-vous). « Si ça continue comme ça la Russie va se réduire au Grand-Duché de Moscou. », m’avait-il dit. Tout se défaisait sous les yeux. Ce qui a pu être signé comme traités dans cette période n’avait donc pas grande valeur. Ils signaient n’importe quoi, pour tout dire, en fonction des urgences immédiates. C’est très important de comprendre cela. Il se trouve que j’ai bien connu Evgueny Primakov qui avait été à un moment mon homologue à la tête de l’Institut d’économie mondiale et des relations internationales (IMEMO). Il était à l’époque le plus grand spécialiste russe du Moyen-Orient et parlait parfaitement arabe. Cet homme fort intelligent a ensuite joué un rôle politique : il a été Premier ministre et a même été cité à un moment comme Président possible à la fin de la décennie 1990. « Occidentaux attention, si vous élargissez l’OTAN on entrera dans une période très dangereuse », avait-il dit en 1996. À cette date personne ne connaissait le nom de Poutine, collaborateur du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobtchak, qu’en ce temps-là nous avons reçu à l’IFRI.
J’ajouterai un dernier complément : Poutine a prononcé un célèbre discours à la conférence de sécurité de Munich en 2007. Un peu menaçant, il avait prévenu : c’est maintenant qu’il faut reconstruire le système de sécurité européen. On ne l’a pas écouté. L’année suivante il était devenu Premier ministre pour laisser la présidence à Dmitri Medvedev. Pour la première édition de la World Policy Conference en 2008 j’avais fait venir Nicolas Sarkozy, à l’époque président, et Medvedev. En marge de la conférence, ils avaient pu discuter de l’affaire géorgienne. Medvedev avait refait un discours du même type que Poutine en 2007, mais dans un style plus aimable. Il n’y a pas eu de suite. Nous n’avons pas compris la nécessité de reconstruire le système de sécurité européen.
Maintenant, une remarque sur le plan proprement géopolitique. Marie-Françoise Bechtel l’a rappelé, il faut faire très attention à l’emploi du mot « géopolitique » qu’on utilise à tort et à travers, en confondant géopolitique et relations internationales. La géopolitique est l’intersection de la géographie et de l’histoire. Elle contribue à cerner un problème mais n’en détermine pas la solution. La liberté, la manière de traiter un problème de politique internationale, dépend de ce que nous en faisons. La politique internationale introduit cet élément de liberté qui est absent dans les théories géopolitiques pures.
Tout le monde aurait dû comprendre que la chute de l’Union soviétique rouvrait la problématique générale de l’ensemble du continent eurasiatique. Et certains, comme Zbigniew Brzeziński, avaient parfaitement vu que la clef en serait l’Ukraine, pour des raisons profondes. Dans un écrit assez tardif (1997) Brzeziński était allé très loin. L’idée de cet Américain d’origine polonaise était : « qui met la main sur l’Ukraine met la main sur le continent eurasiatique » donc les Américains doivent mettre la main sur l’Ukraine. À la fin de sa vie, il a fait machine arrière quand il a compris que cela pouvait tout simplement provoquer une guerre mondiale. En disant cela je simplifie sans trop caricaturer.
Passons à la situation présente, avec « l’intermédiaire » du 24 février 2022, date de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. À l’époque, qu’est-ce qui était prévisible et qu’est-ce qui était moins prévisible ?
Quand je dis « ce qui était prévisible », je parle de choses que beaucoup de gens ont refusé de voir.
Ce qui était prévisible, à mon sens, c’est que la guerre s’arrêterait d’une manière ou d’une autre par la volonté des Américains le jour où ils changeraient d’avis comme ils ont souvent fait (Vietnam, Afghanistan, etc.). Pas besoin d’être un génie pour comprendre qu’à un certain moment les Américains diraient « Stop » ! – Ce « Stop » ! pouvant se faire de beaucoup de manières différentes – et que cela finirait par une partition territoriale. Difficile de faire entendre cela en 2022. Mais la logique était là.
Je suis très frappé de la légèreté avec laquelle beaucoup de gens parlent de l’Ukraine comme si les frontières étaient strictement délimitées par des nations proprement dites. Les frontières de l’Ukraine en 1991 sont très particulières. On a rappelé à l’envi que c’étaient des frontières administratives en quelque sorte. Mais l’Ukraine n’avait été un État indépendant que pendant trois ans dans toute son histoire, entre 1920 et 1923, après la Première Guerre mondiale (dans le contexte de la révolution d’octobre, etc.). La nation ukrainienne existe depuis longtemps mais l’État ukrainien n’a jamais existé dans des frontières coïncidant avec la nation. Je vous renvoie avec délectation à un ouvrage historique de Voltaire : Histoire de Charles XII, roi de Suède, que mon père m’avait fait lire quand j’avais 14 ans dans le but de me faire comprendre que Voltaire admirait Louis XIV. J’ai retrouvé les passages où il parle de l’Ukraine. Les Ukrainiens, écrivait-il en substance, sont entourés par trois empires : la Suède, la Pologne et la Russie. Retourner à ces textes est assez piquant. Si l’on pense à l’avenir de l’Ukraine après la guerre actuelle, il est probablement juste de croire que la nation ukrainienne se sera construite, certes à un coût extrêmement élevé. C’est une guerre nationale qui aura fait que l’Ukraine existera enfin en tant qu’État-nation. Mon point est que ce ne sera vraisemblablement pas dans les frontières de 1991.
Autre élément prévisible dès 2022 : les grands bénéficiaires de la guerre devraient être les Américains. C’est une évidence sur le plan économique, en particulier sur le plan énergétique. Et les grands perdants seront les Européens.
Ce qui était moins prévisible, c’est que les États-Unis allaient changer à ce point. En 2022 on connaissait Trump mais il était quand même difficilement imaginable qu’il prendrait des décisions aussi radicales vis-à-vis de l’Europe et de la guerre d’Ukraine. On peut se demander si, dans les postures de détail, les États-Unis jouent dans leur propre intérêt. Je veux dire par là que dans les négociations actuelles on est parfois surpris, sur un plan proprement diplomatique, par une méthode qui consiste avant même le début des négociations à donner beaucoup à la Russie. C’est un point d’étonnement par rapport à la conduite normale de la diplomatie. Toujours est-il que les tournants qui ont été pris par les États-Unis ont des arrière-plans fondamentaux pour qui observait leur évolution depuis longtemps. Mais la façon dont les choses se sont faites est assez frappante.
On peut évidemment penser que la question principale pour les États-Unis est aujourd’hui la Chine, d’où une envie de rapprochement avec la Russie. Et, pour la Russie, symétriquement, il s’agit d’être moins dépendante de la Chine, donc de se rapprocher des États-Unis. Dans les années 1970 j’étais le directeur du Centre d’analyse et de prévision auprès du Ministère des Affaires étrangères, devenu depuis le Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS). J’avais alors de bonnes relations avec André Fontaine, le grand spécialiste de la politique étrangère du journal Le Monde (dont il a été directeur par la suite). « La Russie entrera dans l’OTAN contre la Chine », avait-il prédit un jour. Je ne suis pas certain que cela se réalisera mais son intuition sur le long terme était néanmoins intéressante.
Il s’est passé ce qu’il s’est passé et le résultat est que l’Europe, fortement affaiblie économiquement, se trouve en danger.
Il faut bien voir que la question actuelle de l’élargissement tous azimuts, a pour point de départ l’effondrement de l’Union soviétique. On a fait le choix d’élargir massivement sans y regarder de trop près. Je m’intéresse depuis longtemps à la Roumanie, un pays attachant. Mais aussi la Moldavie que peu de gens connaissaient lorsque j’y suis allé pour la première fois en 2005. On n’a pas encore élargi l’Union européenne à la Moldavie mais pour la Roumanie, ce fut vraiment rapide. Encore plus pour la Bulgarie, où la corruption fait toujours des ravages. On a donc élargi précipitamment, ce qui a déstabilisé l’ensemble de la construction européenne, sans jamais répondre à la question de base : que
veut-on et que peut-on faire de cette construction ? Aujourd’hui ce problème se trouve relancé à cause de la guerre d’Ukraine et avec un engagement imprudent d’encore élargir l’Union à l’Ukraine, ce qui, à l’évidence, entraînera l’Europe du Sud-Est. Et si on ne respecte pas les promesses, on dénoncera à juste titre l’hypocrisie des engagements européens.
Nous nous trouvons ainsi, à l’intérieur de l’Union européenne, avec des clivages qui se sont beaucoup accentués. Certains de ces clivages tiennent à l’histoire de l’Europe. Je pense par exemple à l’opposition entre le monde catholique et le monde orthodoxe.
Mais je me bornerai au clivage Nord-Sud qui oppose les frugaux et les cigales. En effet la plupart des engagements et des directions dans lesquelles nous sommes engagés vont très vite se heurter à des difficultés majeures (Marie-Françoise Bechtel a fait allusion aux questions économiques).
Cet affaiblissement considérable de l’Europe est encore augmenté par le fait que les réactions, particulièrement françaises, à la guerre d’Ukraine vont sur le plan politique international dans un sens différent de l’orientation traditionnelle de la France. Pour dire les choses succinctement nous avons fait le choix de soutenir totalement le point de vue de la Grande-Bretagne et de l’Europe du Nord, particulièrement la Pologne et les Pays Baltes. Je ne parle pas ici de morale mais de géopolitique et de politique internationale. D’ailleurs, dans la Commission européenne actuelle il est assez remarquable de constater que les postes principaux dans ces domaines sont confiés à des personnalités originaires des Pays Baltes.
D’où des fissures qui commencent déjà à apparaître parce que les intérêts des pays-membres de l’Union européenne ne coïncident pas toujours avec ces choix.
Ceci renvoie à une question posée par Marie-Françoise Bechtel dans son introduction : qu’entendons-nous par défense européenne ? Que voulons-nous défendre exactement ?
Je vois bien qu’Emmanuel Macron a voulu profiter des circonstances pour que la France puisse essayer de prendre une sorte de leadership de l’Europe qui pour le moment n’a pas de leader naturel. Mais on peut dire également qu’un tel leadership est extrêmement fragile. En effet tout peut changer très vite. On verra comment évoluera l’Allemagne du chancelier Merz. De toute façon les engagements nécessaires prendront leur sens sur la longue durée, non dans l’immédiat. Concernant le réarmement, on parle facilement d’une décennie. On ne va pas construire une défense européenne en cinq ans. Cela n’aurait pas grand sens ni industriellement, ni militairement, ni politiquement.
Nous sommes dans une situation qui pourtant produit des effets immédiats en France même. Ainsi, répète-t-on à l’envi que la Russie mène une forme de guerre contre la France. C’est vrai. Pas avec des chars mais à travers la guerre « hybride » et en s’en prenant à nos intérêts au Sahel par exemple. Dans le contexte actuel, quiconque au Kremlin chercherait à nuire au maximum aux intérêts français, du fait de nos positions.
Il faut aussi réfléchir au long terme. Même si on a peur de le dire publiquement, certains scénarios s’imposent à la réflexion. On peut imaginer par exemple que l’Algérie se rapproche substantiellement de la Russie et même que celle-ci veuille y déployer une base navale. Et pourquoi pas y déployer des missiles. Tant de choses arrivent qui n’étaient pas pensables.
Quand on réfléchit à la défense et à la sécurité, on doit raisonner sur le long terme, non à quatre ou cinq ans. Je donne ces exemples, mais il y a beaucoup de problèmes auxquels on doit réfléchir sérieusement, en sortant du confort des idées reçues.
Quelques remarques sur la question du futur système de sécurité européen :
Jean de Gliniasty a dit l’essentiel, c’est que de toute façon viendra un moment où il faudra penser à la reconstruction effective d’un système de sécurité européen auquel la Russie devra participer.
Je suis de ceux qui pensent qu’on aurait pu et dû faire l’économie de cette guerre, ce qui aurait permis aussi de préserver les frontières de 1991. Les circonstances en ont voulu autrement. Mais dans quelques années il faudra revenir à un vrai système de sécurité.
Aujourd’hui, me semble-t-il, on confond les conditions d’une trêve ou d’un cessez-le-feu avec l’établissement d’un système de sécurité. Or ce ne sont pas les mêmes échelles de temps. Trump pense en termes de résultat immédiat, d’ailleurs avec une certaine naïveté : il voit dans un cessez-le-feu une sorte de paix qui pourrait se prolonger. Les Russes qui bénéficient pour le moment d’un avantage certain en termes de rapport de force, ont à moyen terme intérêt à rentrer dans des transactions avec les États-Unis. Les Russes sont donc moins pressés. Le rapport de force ne les place pas dans l’urgence, aussi poussent-ils beaucoup plus vers quelque chose qui commencerait immédiatement à ressembler à l’embryon d’un système de sécurité européen. Ils fixent des conditions répétées tous les jours que je n’ai pas besoin de rappeler. En même temps ils sont devant la possibilité que Trump, las d’attendre les concessions de la Russie, fasse volte-face.
L’Union européenne est en danger vital.
Il est concevable qu’elle ne survive pas à long terme. Je ne dis pas que c’est certain, je dis que le danger est réel. Il est donc plus que temps de réfléchir à l’avenir de l’organisation de l’Union car, quels que soient les griefs que l’on puisse nourrir à l’égard de la construction européenne telle qu’elle a été faite jusqu’ici, je crois que l’on peut tous se mettre d’accord sur ceci : le chaos dans une Union européenne qui exploserait serait dramatique pour tous ses membres et, dans une large mesure, pour beaucoup d’autres pays dans le monde. Mais le danger existe.
Il est essentiel de réfléchir constructivement à ce qu’il est possible de faire, donc aussi à ce qu’il n’est pas possible de faire.
Développer une industrie d’armement, oui. Il y a beaucoup d’actifs industriels en Europe qui peuvent donner sens à cette formule. Mais il faut y réfléchir d’une manière méthodique et se souvenir que les pays du Nord resteront frugaux. Si les pays du Sud restent cigales, arrivera un moment où ça ne marchera plus. J’en reviens à l’Allemagne. Les Allemands traversent un moment difficile mais ils sont Allemands ! Ils feront ce qu’ils disent et quand ils se seront réorganisés ils se remettront rapidement en marche. Il n’est pas nécessaire non plus d’être un grand historien pour savoir que les Allemands se sont toujours intéressés à l’Est, à la Russie. La relation entre l’Allemagne et la Russie est d’ordre géopolitique. Le moment venu, le premier pays européen à rétablir et à développer des liens (économiques et autres) avec la Russie sera vraisemblablement l’Allemagne. Et si on n’a pas réussi à maintenir un rapport équilibré entre la France et l’Allemagne, il faudra s’attendre à des conséquences graves.
Je peux même prédire où la rupture se produirait si elle devait avoir lieu. Ce serait sur la zone euro. En effet, la construction de l’euro – que j’ai moi-même en son temps suivie de très près – fut un pari politique extraordinaire contre les lois de l’économie. « C’est impossible, donc on va le faire », se sont dit Mitterrand et Kohl, qui avaient le grand avantage de ne pas connaître la science économique. Et ils l’ont fait. Cette incroyable initiative a permis à la Communauté européenne, rebaptisée Union européenne, de survivre à la chute de l’URSS.
Si le fossé économique devait s’élargir entre l’Allemagne et la France, les mêmes raisons qui ont favorisé la survie de l’Union européenne pourraient annoncer sa mort.
Marie-Françoise Bechtel
Merci.
Vous avez tenu un champ large et vous nous avez dit des choses très profondes dans le temps.
Je me tourne vers Pierre Lellouche qui nous a régalés par son dernier ouvrage [1].
Il me semble que vous avez déplié différents scénarios sur la base d’analyses qui nous font reculer toujours davantage en profondeur sur les hypothèses possibles en ce qui concerne tout ce qui se passe à l’intérieur de l’Europe et même au-delà.
Je vous donne la parole et nous vous écouterons avec le plus grand intérêt.
[1] Pierre Lellouche, Engrenages. La guerre d’Ukraine et le basculement du monde, Paris, Odile Jacob, 2024.
Le cahier imprimé du colloque « Quelle architecture de sécurité en Europe ? » est disponible à la vente dans la boutique en ligne de la Fondation.
S'inscire à notre lettre d'informations
Recevez nos invitations aux colloques et nos publications.