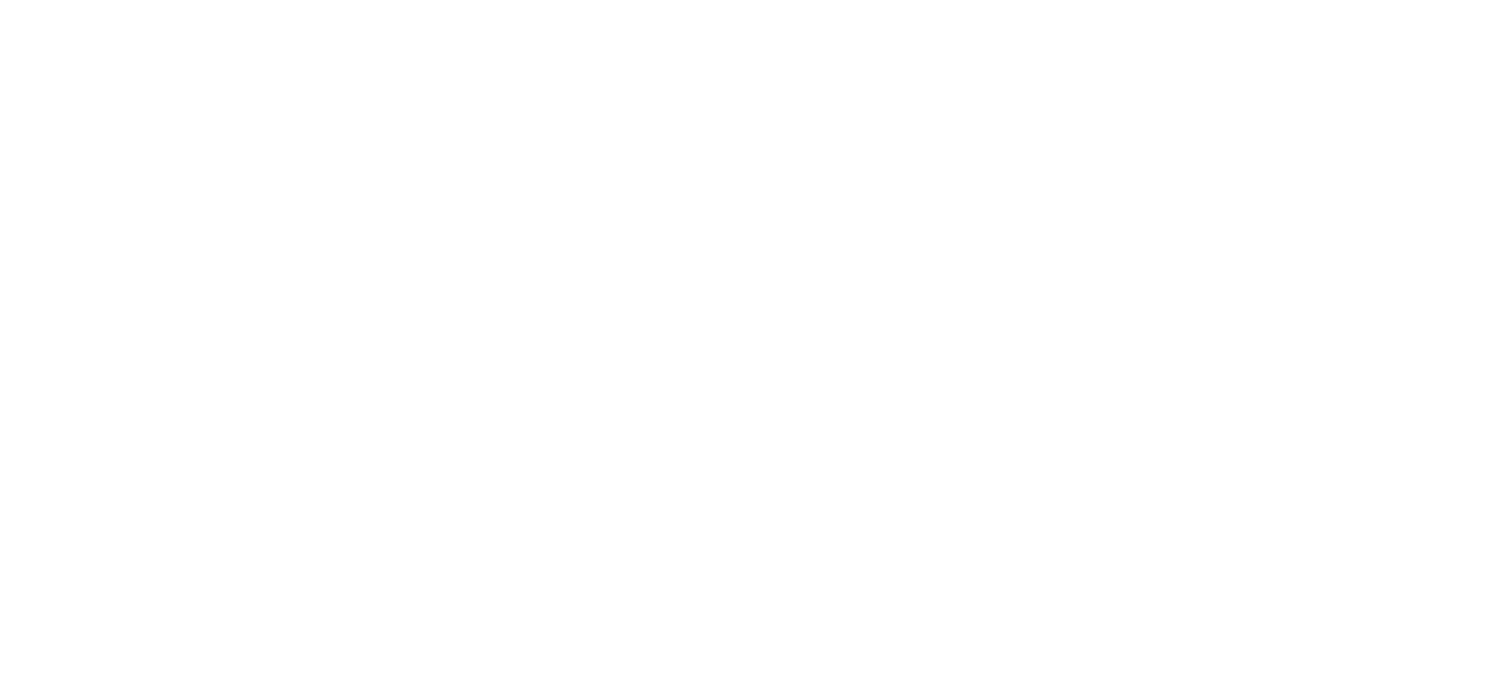Nous assistons à un retour du politique et à la fin de la fin de l’histoire
Intervention de Julien Aubert, haut fonctionnaire, ancien député, lors du colloque "L'avenir de l'Europe : que penser de la Communauté politique européenne ?" du mardi 28 janvier 2025.
Puisque Jean-Louis Bourlanges a choisi les armes de la géopolitique je relève le défi, en parallèle aussi pour donner le point d’aboutissement de la réflexion.
Je crois que nous assistons – cela a d’ailleurs été esquissé – à un retour du politique et à la fin de la fin de l’histoire.
Pendant vingt-cinq ans on a effectivement vécu avec l’idée d’un momentum où l’économie prendrait le pas sur le politique et où le rôle de la politique ne serait pas de gouverner mais d’établir des gouvernances, des régulations, des réglementations qui permettraient aux marchés de fonctionner. Et le rôle du politique était finalement de faire en sorte que les peuples n’en souffrent pas trop et que le pouvoir d’achat reste suffisant de manière à leur offrir une capacité d’être heureux. Je crois que cette période est en train de se refermer.
C’est aussi la fin de la « mondialisation heureuse » telle qu’on l’a pensée, enseignée, avec un retour du réalisme, ce qui est rassurant et perturbant.
Ce n’est pas la première fois dans l’histoire de l’Occident, même dans la courte histoire moderne, que l’on assiste à cette alternance de moments de béatitude et de phases de retour aux réalités. Les années vingt ont été une décennie où l’on a pensé bâtir des institutions internationales éternelles, où l’on a cru à la densification des échanges commerciaux, à l’ouverture des frontières… avant, très rapidement, de déchanter dans les années trente. On se souvient des propos de Briand à la Société des Nations : « Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons ! Place à la conciliation, à l’arbitrage, à la paix ! » (10 septembre 1926, date de l’entrée de l’Allemagne dans la SDN). On sait ce qu’il en est advenu quelques années plus tard.
C’est surtout la fin d’un régime international qui a été conçu, bâti en plusieurs phases par les Américains qui en étaient l’horloger et le principal bénéficiaire.
Les régimes internationaux sont des choses intéressantes. L’OPEP, par exemple, est un régime international dont l’Arabie saoudite est l’horloger parce qu’elle accepte, lorsque quelqu’un triche dans le régime, de prendre sur ses propres réserves et sur son propre gain le coût de la tricherie de manière à ce que l’OPEP continue à fonctionner. Et cela fonctionne cahin-caha malgré le fait que certains pays, comme le Venezuela, aient pu tricher par le passé. Les Américains acceptaient de nourrir un système basé sur les Nations Unies, sur l’OTAN, et d’en payer le coût parce qu’ils étaient en même temps les principaux « consommateurs » du bien collectif ainsi produit : la sécurité d’un côté et de l’autre le commerce et les échanges capitalistiques liés à un système effectivement basé sur le droit, le capitalisme et les ouvertures commerciales les plus larges. C’est un changement parce que, finalement, le principal horloger du système, à un moment donné, s’aperçoit que le coût économique du maintien du système devient trop lourd à porter. C’est ce que Donald Trump a réalisé lorsqu’il s’est aperçu que les classes populaires américaines étaient aujourd’hui défavorisées par un régime d’ouverture commerciale trop grande. Il en tire les conséquences démocratiques. C’est le retour du politique par rapport à l’économique. Il décide de remettre des tarifs, il décide de refaire du protectionnisme américain, il décide de défendre l’intérêt national américain.
Mais ce n’est pas seulement un changement de cap, un retour réaliste, la fin d’un régime international, c’est aussi la fin d’une époque, illustrée selon moi de manière très évidente par les propos d’Elon Musk sur l’AfD. Que, dans un Occident formé après 1945 sur la lutte contre le nazisme, le principal conseiller du Président des États-Unis puisse encourager l’AfD, héritière des partis d’extrême-droite en Allemagne, au cœur de là où fut conçu l’esprit de Yalta, cela sans provoquer la moindre réprobation américaine… ! Imagine-t-on le conseiller du président Roosevelt déclarant, après la guerre, espérer que le parti nazi renaisse de ses cendres ? Il se serait fait virer dans la minute ! Mais cela n’a produit aucun effet, ce qui révèle un changement générationnel. L’héritage de la Seconde Guerre mondiale appartient désormais à l’histoire morte. Il n’y a plus assez d’acteurs vivants pour en défendre l’augure. Cela peut donc être instrumentalisé, réécrit, repensé sans produire le même impact parce qu’on n’est plus du tout sur de la mémoire vivante. Cela veut dire aussi que l’un des fondements du Pacte atlantique est mort. Pour moi il est mort le jour où Elon Musk a pu s’autoriser à tenir ces propos.
C’est aussi le symbole de la déliquescence de la civilisation occidentale.
Si, dans les tabous, il y a la lutte contre le nazisme, dans ce que Donald Trump a pu amener, au-delà du retour de la politique, il y a la perte de la civilité – invention occidentale – et de la diplomatie. Même les pires dictateurs, qu’ils fussent communistes ou nazis jouaient les règles de la politesse occidentale. C’est une chose qui disparaît, on peut se permettre d’injurier, d’invectiver. Cela traduit quelque chose d’une époque.
La perte du droit international.
Quand Adolf Hitler voulait récupérer l’Autriche tout le monde y voyait un Anschluss. Quand Donald Trump – qui certes n’est pas Adolf Hitler – explique qu’il veut récupérer le Groenland, il s’assied sur toutes les règles de droit international et de souveraineté des pays : il est interdit en droit international d’aller conquérir un autre territoire, a fortiori le territoire d’un allié au sein d’un système de sécurité. Nous assistons donc à la déliquescence d’un droit international pensé par les Européens et un temps soutenu par les Américains comme étant aussi une manière de faire tourner la machine. Ce n’est pas récent. Depuis vingt-cinq ans les Américains mettent des coups de canif dans le droit international. Cela a commencé avec le Kosovo, ce qui a d’ailleurs énervé profondément les Russes. Cela a continué avec un mécanisme de représailles entre Américains et Russes de plus en plus employé. On peut même dire que cela a commencé avec la guerre du Golfe, présentée à l’époque comme le summum de l’application du droit international. Déjà les Conseil de sécurité des Nations Unies s’était en partie délesté de ses prérogatives au profit d’une coalition internationale de facto dirigée par les Américains.
C’est la fin de la séparation entre intérêts publics et intérêts privés. Le fait de mettre Elon Musk à la tête de l’administration fédérale en est pour moi la quintessence. Le Président américain lance un programme spatial dont on devine aisément qui va en être l’un des principaux bénéficiaires. C’est une rupture car depuis un siècle l’Europe et les États-Unis ont cherché à délimiter la sphère de l’intérêt général et la sphère des intérêts privés.
C’est aussi une déliquescence idéologique.
La dernière révolution idéologique à droite fut le retour de Thatcher et Reagan dans les années 1980. On pourrait se dire que Trump, Milei, Boris Johnson, c’est la même révolution.
Pas véritablement.
Quand on regarde le parcours idéologique des uns et des autres on s’aperçoit que chez Reagan, Carlos Menem ou Margareth Thatcher, il y avait la croyance libérale dans un programme économique.
Il y avait aussi un conservatisme lié à la religion. Ronald Reagan concluait chacun de ses propos d’un « God Bless America ». Margareth Thatcher estimait que ses croyances chrétiennes rejaillissaient dans sa vie de tous les jours. Et Carlos Menem, musulman, s’était converti au catholicisme (un peu par intérêt électoral : en 1989, en Argentine, être catholique ne nuisait pas). Pour ces trois personnages politiques la religion était importante. Tous les trois venaient d’une religion minoritaire dans leur pays et avaient changé de religion. Reagan était presbytérien, il s’est converti à un courant plus large. Thatcher, méthodiste, est devenue anglicane et Carlos Menem, musulman, s’est converti au catholicisme. Tous trois ont fait un choix politique pour capter un électorat qui à l’époque était conservateur.
Très différent est un Javier Milei qui décide d’insulter le Pape dans un pays à
90 % catholique. Différent est un Donald Trump affilié à une église dont le pasteur explique que l’émancipation et l’enrichissement personnel mènent au salut, ce qui coïncide avec les choix qu’a fait Donald Trump dans sa vie. Quant à Boris Johnson (lui-même avait changé de religion), qui avait divorcé à plusieurs reprises, il a créé une polémique en trouvant le moyen de se remarier dans une église catholique, ce qui n’a pas manqué de produire quelques émois dans la population catholique.
On voit bien que même au niveau idéologique on est sur un tournant. La droite qui avait des croyances économiques très fortes et était adossée à un modèle de société conservateur n’existe plus. Au contraire nous connaissons aujourd’hui un charisme du « buzz » adapté aux réseaux sociaux. Les nouveaux représentants de la droite ont d’ailleurs des points communs capillaires qui amènent certains à les traiter de fous ou de clowns, ce qui n’était pas du tout le cas de la génération précédente.
Je dirai que c’est un changement d’époque.
C’est le problème externe de l’Europe.
S’y ajoute le problème interne de l’Union européenne.
L’Union européenne a cru que ses valeurs étaient éternelles et universelles.
Éternelles, non, je viens de vous le prouver. Tous les débats sur le wokisme, la place de la religion dans la société… montrent que l’héritage judéo-chrétien a plutôt tendance à se liquéfier.
Universelles, sans doute pas. Alors qu’il y a quarante ans le nec plus ultra pour un pays du tiers-monde était d’importer les valeurs occidentales, on voit bien qu’aujourd’hui l’Europe et les États-Unis sont de plus en plus isolés sur le corpus de valeurs. L’une des raisons d’ailleurs pour lesquelles on nous évacue d’Afrique est que nos leçons sur la bonne gouvernance et la démocratie ne passent plus à l’égard de pays qui n’ont plus guère d’attirance pour notre modèle occidental, voire le rejettent sur certains aspects progressistes, tels le modèle homme-femme ou la transition de genre, toutes choses qui, vues d’Afrique, semblent hérétiques, pour ne pas dire plus.
L’Union européenne, en choisissant le marché, a perdu sa spécificité.
La Ligue hanséatique n’est pas l’Empire romain. Surtout lorsque les barbares menacent. En ne voulant être qu’un marché l’Europe a refusé de réfléchir au problème quasiment organique qu’est sa relation à la frontière. En effet, elle s’est construite en faisant disparaître ses frontières internes. Mais s’efforcer de dissoudre ses frontières internes tout en réfléchissant à sa propre frontière
vis-à-vis de l’extérieur est très compliqué. Or l’Europe s’est toujours interdite de se demander quelle était sa finitude, en faisant un horizon indéfiniment repoussé, ce qui fait que d’autres sont venus nous expliquer quelles pouvaient être nos frontières. Les Américains, par exemple, auraient bien vu cette grande puissance marchande recouper à peu près les frontières de l’OTAN ainsi que leur cadre d’alliances militaires. D’où le débat sur la Turquie. Sauf que la Turquie ne partage pas le même héritage. En revanche il n’y a jamais eu de débat sur la Russie qui, au début du XXème siècle était un grand pays européen qui a longtemps été tournée vers la civilisation européenne. Qu’on ait eu un débat sur la question de savoir si la Turquie devait ou non rentrer dans l’Union européenne et qu’on n’ait jamais eu de débat sur l’intégration de la Russie dans l’Union européenne traduit une absence de réflexion sur la frontière. Nous le payons aujourd’hui quand on parle d’élargissement. Trump – c’est une autre différence – n’a aucun problème avec la frontière. Trump défend – de manière assez violente – sa frontière avec le Mexique. Il a aussi une conception très claire de ce qu’il souhaite quand il parle du Canada ou du Groenland. Les Américains ont une idée assez claire de la limite de leur frontière. Ce n’est pas notre cas. La Moldavie, l’Ukraine la Turquie… nous faisons comme si tout était substituable, ce qui ne tient pas si on réfléchit sur un bloc civilisationnel. Et l’Europe se résout finalement à n’être qu’un marché où plus on est de fous plus on rit.
L’Union européenne a oublié la nation.
Je ne surprendrai personne dans cette salle en disant qu’elle a vu dans la nation un problème à sa construction, sans comprendre que ce qui a fait l’Europe est justement le fait d’avoir autant de puissances en compétition sur un aussi petit territoire. En neutralisant les nations nous avons neutralisé la dynamique qui a lancé l’Europe à la conquête du monde. Si nous avons exporté nos valeurs et notre modèle politique par la conquête coloniale c’est aussi parce que nous étions un peu trop à l’étroit sur notre territoire et que la rivalité entre Français, Anglais, Britanniques, Allemands, Belges… les a lancés à la conquête du monde. Mais chaque nation est différente. On pourrait penser que c’est l’État français qui a créé la nation, donc que la France est aussi « une certaine idée de l’État » et qu’en paralysant l’État on neutralise une part fondamentale de ce qui fait la nation française… Mais je ne voudrais pas ouvrir un débat philosophique avec quiconque ici.
L’Union européenne a oublié la force et la démocratie.
Dans le sillage de l’Amérique qui avait ouvert la phase du monde merveilleux de la mondialisation (l’histoire était terminée, il n’y avait plus de problème), l’Europe a choisi le droit, considérant que nous entrions dans un monde postkantien d’où tout danger avait disparu. Or le droit sans la démocratie produit une bureaucratie qui émet de la réglementation dont on ne peut ni débattre ni la changer. Un problème de construction a conduit à un système européen qui est tout sauf démocratique. L’Europe a délégué sa sécurité à l’OTAN, abandonnant les projets qu’elle avait pu avoir de Communauté de l’Europe occidentale, devenue l’Union de l’Europe occidentale avant d’être digérée sous forme de « pilier ». En réalité nous n’avons pas de stratégie de rechange (la France a tenté d’y remédier mais nous étions un peu seuls) quand les États-Unis décident d’arrêter de payer pour le système otanien, ce qui, évidemment, produit un choc chez nos voisins.
Enfin il faut bien reconnaître qu’au sein de l’Union européenne il y a les États qui comptent et ceux qui comptent moins.
Si le soutien de tel ou tel petit pays de l’Union européenne sur telle ou telle directive peut être utile, quand on parle de géopolitique le nombre d’États qui pèsent véritablement se comptent sur les doigts d’une main. Nous en avons perdu un avec le Brexit, ce qui a d’ailleurs porté un grand coup à notre audience. Et les deux derniers qui comptent véritablement ne sont d’accord sur rien ! Nous nous disons unis mais en réalité nous n’avons pas fait les mêmes choix industriels et énergétiques qui sont au cœur de la compétitivité. Nous ne sommes pas non plus d’accord sur les choix idéologiques qui découlent de ces choix énergétiques, notamment à propos du nucléaire et des énergies vertes. Cela pose un véritable problème quand il faut définir une stratégie commune. Si la France et l’Allemagne étaient d’accord sur une stratégie on peut penser que nous arriverions à l’imposer, en tout cas dans le cadre de l’Europe actuelle. Mais, comme lorsque deux ministres d’un même gouvernement ont des positions divergentes, c’est l’administration du tout qui fait ses choix. Or l’administration du tout c’est la Commission européenne dont la présidente, Mme von der Leyen, a pris une importance insoupçonnée. Comme Napoléon dans le tableau de David, elle a pris la couronne des mains du Pape et se l’est posée sur la tête, se considérant de facto comme la présidente de l’Union européenne, ce qu’elle n’est nullement institutionnellement, ce qu’elle ne peut pas être politiquement. Je ne suis pas tout à fait neutre parce que je n’ai pas beaucoup d’affection pour le personnage. Largement inféodée aux intérêts américains, elle a pris toute une série de décisions extrêmement préjudiciables pour les intérêts français. Et lorsqu’elle n’écoute pas Washington elle écoute Berlin et généralement ça se termine très mal ! Il n’y a qu’à voir la dernière organisation de la Commission européenne : Thierry Breton, qui avait essayé de se battre au moins sur la souveraineté, a été exfiltré pour être remplacé par Séjourné ! Cela ne nous empêchera pas de continuer à défendre l’intérêt national. Pourtant, quand on voit qu’on a donné les clés de la politique énergétique et de compétitivité à une socialiste espagnole antinucléaire, à un socialiste scandinave antinucléaire, à une présidente de commission elle aussi antinucléaire (elle vient du NFP) on se dit qu’il n’est pas possible de mener une stratégie d’épanouissement industriel et de compétitivité dans ces conditions ! La France a fait preuve sur ce sujet d’un manque de lucidité total. Sans compter le rôle profondément anormal de Mme von der Leyen qui, en imposant ses choix, a affaibli la France et qui a d’ailleurs placé des chargés de mission allemands un peu partout dans les cabinets pour contrôler ses collègues, à rebours de l’esprit de collégialité qui devrait présider dans cet ensemble.
Les solutions.
Je crois qu’on ne peut pas résoudre les problèmes du présent avec les solutions du passé. Chaque fois qu’on a rencontré un problème dans l’Union européenne on l’a attribué au fait qu’il n’y avait pas assez de fédéralisme. Cela fait cinquante ans qu’on applique cette solution, cela fait cinquante ans que le « bidule » est de plus en plus compliqué, de moins en moins efficace et de moins en moins puissant.
C’est pourquoi je pense que l’élargissement est la dernière chose à faire. Quand on voit que d’aucuns promeuvent l’élargissement à l’Ukraine… quand on voit que le rapport du pouvoir d’achat va du simple au triple par rapport à la moyenne européenne… on pense à ce qu’a fait la RFA avec la RDA lors de la réunification allemande. Certes, sur le plan démographique, l’Ukraine représente 10 % de la population européenne totale. Et le différentiel de richesse n’est pas comparable. Toutefois il ne faut pas regarder la totalité des pays européens mais ceux qui vont payer, c’est-à-dire la petite liste des États européens qui sont des contributeurs nets. Ceux qui vont jouer le rôle de la RFA ce ne sont pas les 27 mais plutôt une dizaine d’États. Et sur cette dizaine d’États ceux qui sont nettement contributeurs. C’est là où va se produire le choc. Choc économique provoqué par un élargissement à un pays très pauvre qu’il va falloir porter à bout de bras ; choc politique parce que l’Ukraine pourrait devenir le cinquième pays le plus peuplé de l’Union européenne, ce qui veut dire cinquante parlementaires au plan européen. Cela veut dire un éléphant au milieu du paysage, avec un impact sur les fonds structurels. En effet, une politique d’aide efficace sur cinq ans représenterait environ 180 milliards d’euros… à comparer au budget européen. On marche véritablement sur la tête. Sans compter le problème géopolitique : avec cet élargissement nous aurions une frontière avec la Russie et nous serions de facto alliés de l’Ukraine avec le risque de nous plonger tous dans un conflit.
La dernière chose à faire est donc d’intégrer l’Ukraine, et d’ailleurs un quelconque autre pays. Je crois qu’il faut arrêter l’élargissement. Plus on a élargi l’Union européenne, plus on l’a dissoute.
Nous avons besoin d’un protectionnisme européen, c’est-à-dire d’être en capacité de défendre une frontière, de défendre un intérêt européen (je préfèrerais défendre un intérêt national mais essayons de jouer le jeu) et d’avoir une impulsion industrielle pour rattraper notre retard. Or nous assistons à un décrochage massif. Nous sommes en train d’être largués sur un certain nombre de secteurs d’avenir, notamment l’intelligence artificielle (IA).
Pourquoi ne pas défendre l’investissement européen ? Celui-ci ne devrait certainement pas être financé par un impôt qui viendrait encore fédéraliser et donner à la Commission européenne le rôle de censeur. Je rappelle quand même que les Parlements sont nés en Europe de la nécessité d’établir un consentement à l’impôt. Il est hors de question de laisser le Parlement européen ou la Commission déposséder les démocraties nationales avec un impôt mutualisé. Cela suppose de trancher le problème écologique : il y a une incompatibilité à dire que l’on va réindustrialiser l’Europe tout en s’opposant à la moindre pollution. L’industrie pollue. On peut faire en sorte qu’elle pollue moins. Les Européens ne sont plus habitués à avoir des usines dans le paysage mais si on veut réaliser l’Europe il va falloir à un moment donné se poser cette question. En réalité, nos choix ont fait le bonheur des Chinois. Je pense notamment aux véhicules thermiques interdits à l’horizon 2035 : aucun impact en matière de CO2 … en revanche un bilan industriel catastrophique.
Il y a quand même un élément positif.
« L’Europe c’est la paix », entend-on souvent. Je dirais plutôt que l’Europe c’est la peur. La peur d’être envahis par les Soviétiques a fait que les Français et les Allemands ont très rapidement compris après 1945 qu’il leur fallait se rabibocher et essayer de se regrouper pour ne pas finir avalés par Staline. Aujourd’hui, coincés entre un Vladimir Poutine qui n’hésite pas à envahir l’Ukraine et un Trump qui n’hésitera pas, demain peut-être, à envahir le Groenland, les Européens, et notamment nos partenaires, finiront peut-être par comprendre qu’il faut une défense européenne autonome, que nous sommes seuls et qu’à un moment donné soit nous faisons des efforts, nous mettons au pot commun, nous arrêtons les bêtises avec la construction européenne soit nous disparaîtrons et serons découpés comme au temps de la Guerre froide avec des zones d’influence ou des zones vassalisées.
Je crois que c’est un point positif.
En conclusion, comme l’a fait « Oser la France », le parti que j’ai l’honneur de présider, je plaiderai pour une confédération d’États souverains, avec un certain nombre de lignes rouges à défendre :
Rétablir la démocratie, prenant conscience que la Constitution de 1958 est indépassable et qu’elle prime sur tout, y compris sur le droit européen. À un moment donné il faut remettre la structure juridique à l’endroit. Si les citoyens n’ont pas la capacité d’avoir un impact sur leur droit, ce droit devient illégitime. Devant des juges et des réglementations sur lesquels ils n’ont aucun moyen d’exprimer leur colère il ne faut pas s’étonner si les gens votent pour des partis protestataires.
Suspendre l’élargissement tant que nous ne saurons pas où est notre frontière. Commençons par déterminer ce que nous sommes avant de déterminer notre volume.
Instaurons un principe de réciprocité européenne en matière commerciale. Ce qu’un pays refuse à un pays de l’UE, refusons-le chez nous !
Faire des efforts, par exemple en proposant notre propre doctrine d’orthodoxie budgétaire pour regagner de la crédibilité au plan européen. Fournir une alternative aux ratios stupides de Maastricht et montrer ce qu’est une bonne orthodoxie budgétaire. Non, la dette ce n’est pas forcément mauvais. Quand on s’endette pour investir c’est une bonne idée. Quand on s’endette pour payer des fonctionnaires c’est mal.
On pourrait encore instaurer un droit de veto budgétaire, revoir la composition du Parlement européen en veillant à ce qu’il soit le reflet des parlements nationaux, mieux contrôler l’application du principe de subsidiarité par un office interparlementaire qui pourrait venir contrôler ce qui se fait, au niveau national en tout cas. Et prévoir une sortie de l’espace Schengen…
Ces quelques points permettraient peut-être de remettre d’aplomb la construction européenne. Je terminerai sur Baudelaire, et son poème « L’Albatros », puisque tout à l’heure on a cité Sieyès :
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. Nous avons voulu avoir un albatros qui ne vole pas, peut-être aurions-nous dû commencer par un canari qui vole, au moins aurions-nous un oiseau dans le ciel.
—–
Le cahier imprimé du colloque « L’avenir de l’Europe : que penser de la « Communauté politique européenne » ? » est disponible à la vente dans la boutique en ligne de la Fondation.
S'inscire à notre lettre d'informations
Recevez nos invitations aux colloques et nos publications.