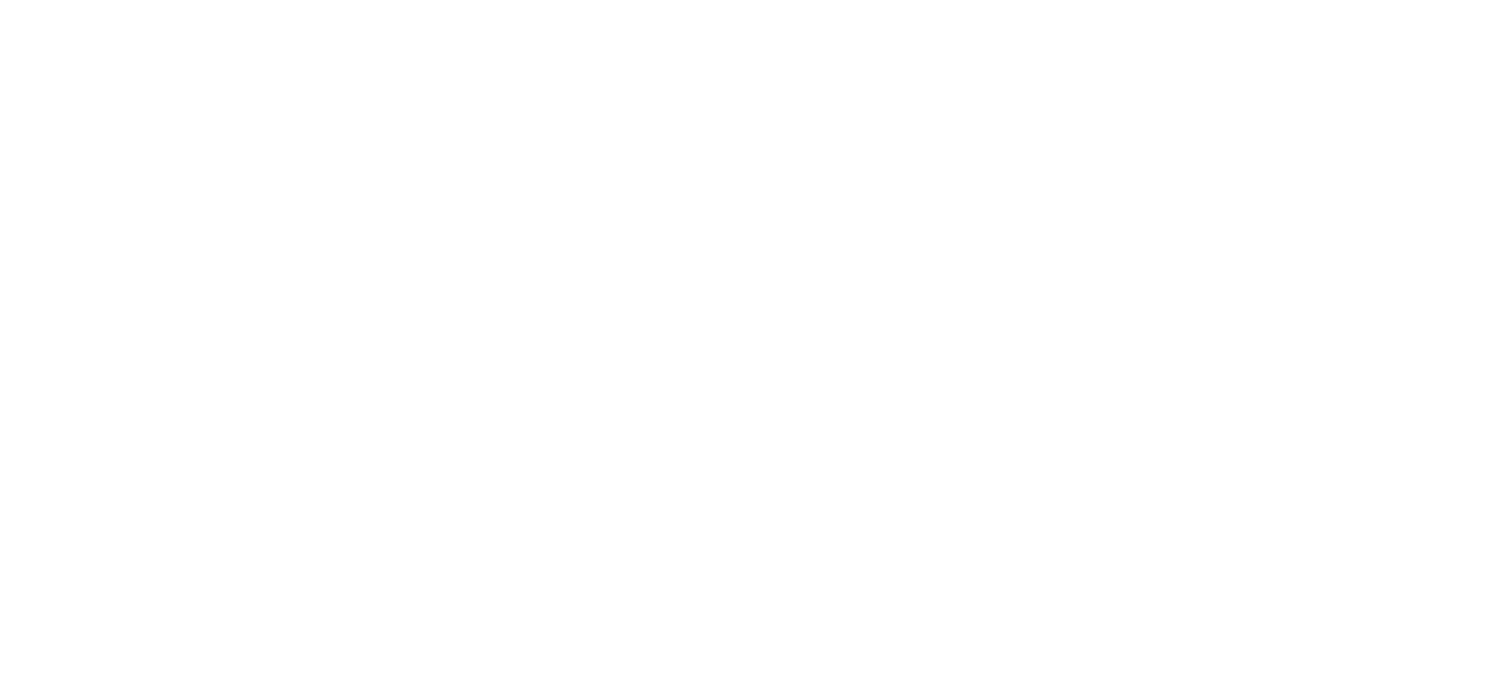Les Européens doivent être unis, mobilisés et forts
Intervention de Jean-Louis Bourlanges, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, ancien député européen, lors du colloque "L'avenir de l'Europe : que penser de la Communauté politique européenne ?" du mardi 28 janvier 2025.
Le tableau qui vous a été dressé reflète un grand désordre des choses. Désordre quand même limité puisque nous avons à cette tribune une conseillère d’État qui a invité deux magistrats à la Cour des comptes. C’est quand même le signe qu’il y a encore des choses qui continuent à défaut de fonctionner dans ce beau pays de France.
Après le tableau à la fois complet et plutôt désespérant que vous avez tracé, il est en effet assez difficile de dessiner un chemin. Je crois qu’il faut pour ce faire partir de notre situation géopolitique et idéologique car elle est très préoccupante.
Un défi géopolitique
Sur le plan géopolitique, disons pour parler comme Sieyès, que l’Europe, en 1914, c’était tout ; qu’en 1945, ce n’était rien ; et, qu’à travers la construction européenne, elle a depuis lors cherché à redevenir quelque chose. Aujourd’hui, on a le sentiment que non seulement l’Europe mais la France et les nations qui la composent sont extrêmement menacées sinon dans leur existence du moins dans leur avenir, dans leur force, dans leur influence.
Cette menace est de deux ordres.
Elle tient d’abord aux valeurs et aux principes qui sont aujourd’hui très chamboulés. Après la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu le sentiment de construire un ordre juridico-politique qui était fondé sur trois choses : le retour aux valeurs libérales et démocratiques ; l’acceptation d’une économie raisonnablement ouverte et régulée dans le cadre d’un univers contrôlé par les puissances occidentales ; et un ordre de sécurité stratégique combinant pour la première fois – rien n’est parfait dans ce bas monde – une certaine cohésion idéologique des alliés avec un principe de sécurité collective.
Avant la Guerre de 1914 nous avions un système d’alliances entre des puissances qui ne professaient pas forcément les mêmes valeurs (par exemple la Russie autocratique, tsariste, et la France républicaine et radicale). Ce système était un apporteur de sécurité pour la France mais, exclusivement fondé sur des logiques de puissance, il était lourd de déséquilibres et nous a conduits en 1914 à entrer dans une guerre que nous n’avions pas vraiment voulue, comme le montrent les élections qui en 1914 ont immédiatement précédé le conflit et ont été gagnées par le tandem pacifiste Jaurès-Caillaux.
Nous sommes par la suite passés dans les années d’entre-deux guerres à une tentative d’organisation de la sécurité collective qui a tragiquement échoué, essentiellement en raison du refus américain de s’y associer : refus de ratifier le traité de Versailles en dépit de la contribution décisive du Président Wilson à son élaboration, puis refus de participer à la Société des Nations.
Compte tenu du désengagement corollaire du Royaume uni, le pas de côté américain conduisait à faire peser sur la France (un pays agricole et vieillissant de 40 millions d’habitants ) des responsabilités trop lourdes pour elle puisqu’il lui était demandé de garantir seule l’équilibre européen, un équilibre menacé par une Allemagne beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus industrielle qu’elle, et par l’ Union soviétique – c’est à dire par une puissance immense et elle aussi fondamentalement révisionniste depuis la Révolution de 17. Sans surprise, l’échec a été complet.
Un défi idéologique.
Après la Seconde Guerre mondiale nous avons donc construit un système d’alliances fondé sur quelque chose d’assez cohérent : on acceptait la vaillance – pour parler comme Thucydide : « Il n’y a pas de bonheur sans liberté ni de liberté sans vaillance » – mais on enracinait cette volonté de vaillance dans le souci partagé de défendre ensemble des valeurs démocratiques et humanistes.
C’est cet équilibre qui est aujourd’hui profondément remis en cause.
Certains s’étaient illusionnés au moment de la chute du mur de Berlin et de l’effondrement du système soviétique. Ils ont alors parlé des « dividendes de la paix » (ce n’était pas mon cas ni celui de Jean-Pierre Chevènement). Certains ont eu l’illusion qu’on arrivait à « la fin de l’histoire » et que les valeurs onusiennes et de liberté allaient s’imposer sans coup férir et régner sur l’ensemble du genre humain. On décelait des prémices d’évolution favorable avec M. Deng en Chine, avec M. Eltsine qui professait (quand il était à jeun) des idées très libérales, et même une expansion saisissante et admirable dans tout le monde arabe du thème de la liberté à partir de l’explosion révolutionnaire du peuple tunisien.
Nous avions un certain nombre d’espoirs mais tout cela a été progressivement remis en cause en Chine, en Russie et dans le monde arabe. Selon M. Filiu, grand spécialiste des questions arabes, c’est l’échec du printemps arabe qui a provoqué dans le monde arabe cette crispation de violence dont la Syrie a offert un exemple effroyable mais la remise en cause a été générale et elle est maintenant prolongée par la remise en cause de leurs valeurs fondamentales par les Américains. Je ne dis pas que l’Amérique a toujours été exemplaire sur le plan de l’humanisme démocratique mais il est évident qu’il y a une volonté délibérée du président Trump de remettre en cause l’héritage idéologique que nous partagions avec les États-Unis.
Cette crise idéologique a affecté l’ensemble des pays avec lesquels nous sommes en relation mais elle nous affecte nous-mêmes en profondeur. Je remarque par exemple qu’aux dernières élections législatives, environ 50 % de la population en France a voté pour des partis qui affichaient une très grande méfiance à l’égard des systèmes de démocratie libérale. Ils se sont prononcés pour des systèmes de démocrature ou ont cautionné des perspectives révolutionnaires qui remettaient en cause les fondements économiques de l’après-guerre et s’orientaient en termes d’alliances vers des préférences plutôt situées à l’Est qu’à l’Ouest.
Nous avons donc, y compris chez nous en France, vécu des remises en cause très profondes qui se combinent avec une montée du dissensus. Nous faisons donc face à un grand défi auquel nous ne sommes pas habitués parce que nous avons fondé ce que nous avons fait depuis la guerre sur un certain consensus idéologique, consensus imparfait mais auquel pour finir tout le monde s’était rallié, y compris le général de Gaulle et, même, à la fin, une bonne partie des communistes français.
Un effondrement géo-idéologique.
Nous avons été confrontés après la Seconde Guerre mondiale à une menace soviétique. N’étant pas en mesure ni moralement, ni politiquement, ni techniquement de nous opposer seuls à l’Union soviétique, nous avons conclu une alliance avec les États-Unis. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une situation extraordinairement nouvelle et inquiétante où, comme le dit M. Araud à propos des années trente, nous autres Européens, nous sommes seuls. Avec nos valeurs, notre civilisation, ce que nous aimons, ce que nous avons fabriqué, nous sommes dans la situation qui était celle de l’Angleterre le 18 juin 1940, date marquée par un grand discours prononcé par Winston Churchill à peu près au moment où le général de Gaulle prononçait son célèbre Appel. Ce discours est passé à l’histoire comme le discours de la Finest hour. Churchill dit à peu près : nous sommes seuls, la civilisation entière dépend de la résistance du Royaume-Uni, nous allons nous battre, nous allons gagner et ce sera « The finest hour of our history », la plus belle heure de notre histoire. Après 1945, quand on demandait à Churchill quelle période de sa vie il aimerait revivre, sans hésiter il répondait « l’année 1940 ». C’est, je crois, très significatif.
Nous sommes dans une situation à certains égards analogue, une situation géopolitique très menacée. Nous sommes face à une agression caractérisée de l’Ukraine par la Russie, menée au mépris de tous les principes et de tous les engagements pris. Nous sommes de surcroît confrontés à une modification très sensible de l’attitude des États-Unis. L’excellent journaliste qu’est Pierre Haski disait l’autre jour que si nous nous étions inquiétés pendant des mois pour savoir si l’élection de M. Trump se traduirait par le maintien ou par le relâchement de la protection des États-Unis sur l’Europe occidentale, nous n’avions pas envisagé qu’ils changeraient de camp et nous feraient carrément la guerre !
La situation est donc plus grave que nous ne l’imaginions. Au Moyen-Orient où notre influence est devenue relativement limitée on voit bien que les valeurs qui sous tendaient nos solidarités traditionnelles, notamment en Israël, ont été profondément bouleversées : les gouvernements actuels d’Israël s’éloignent de l’héritage humaniste et universaliste qui rattachait l’État hébreu à l’aventure occidentale. Aujourd’hui l’Israël de Ben Gourion, de Golda Meir et d’Yitzhak Rabin tend à n’être plus qu’un souvenir
En Afrique, nous sommes partout rejetés. Notre reflux coïncide curieusement avec l’abandon de ce qu’on a appelé d’un terme un peu imprécis la « Françafrique ». Nous constatons là un effet de la loi de Tocqueville qui posstule que c’est quand les choses vont en s’améliorant qu’elles deviennent intolérables. C’est au moment où nos relations se sont efforcées d’être fondées sur plus de démocratie, plus de coopération, plus de respect, qu’on nous a mis dehors un peu partout. Il faudrait savoir pourquoi nous avons été punis pour notre découverte de la vertu après avoir été si longtemps tolérés en dépit de nos vices, et notamment celui d’un néocolonialisme globalement assumé.
Dans le monde d’aujourd’hui, nous sommes devenus les derniers des Mohicans, les derniers à porter les valeurs qui avaient fait de l’après-guerre un temps d’espoir et de progrès.
Les discussions qui vous animent sur la confédération, la fédération, la coopération politique… m’apparaissent à cet égard un peu nébuleuses et quelque peu décalées. Il me semble, au risque d’être un peu centriste, avoir été choisi pour que nous fassions face ensemble à une situation inédite. Pour retrouver leur audience les Européens doivent être unis, mobilisés et forts. Or je constate qu’ils ne sont pas unis, qu’ils ne sont pas mobilisés et qu’ils ne sont pas forts.
Les Européens doivent être unis.
On voit bien qu’ils ne le sont pas. Nous vivons la situation, absurde à certains égards, que décrivait jadis Michel Rocard : quand on regarde à trente ans tout le monde est européen ; quand on regarde à dix ans c’est déjà beaucoup moins net ; quand on regarde à six mois tout le monde se bagarre. Nous savons que technologiquement, humainement, politiquement, culturellement, les intérêts des puissances européennes sont profondément solidaires. En revanche, concrètement, il y a des divergences d’approches un peu partout. Les Balkans ne réagissent pas comme les Pays baltes. Les Baltes sont très soucieux de résister à Poutine, très soucieux aussi de maintenir une relation privilégiée avec les
États-Unis. Les Balkans, beaucoup plus sensibles à la propagande et à « l’agitprop » russes, sont très incertains. Au milieu de cette Europe centrale (dans ou hors de l’UE), la Serbie, la Bulgarie, la Moldavie, la Hongrie, la Slovaquie, la Croatie sont assez profondément travaillées par la volonté d’une relation privilégiée avec la Russie. La Pologne, les Baltes, la Finlande, la Suède, le Danemark (ce pays atlantiste aujourd’hui menacé par les États-Unis est une illustration parfaite des paradoxes actuels), la Norvège, extérieure mais étroitement associée à l’U E, et même le Royaume-Uni qui fait partie de l’Europe même s’il ne fait plus partie de l’Union européenne, sont sur une ligne très différente. L’Espagne et l’Italie sont en situation d’attente. Au milieu de tout cela la France et l’Allemagne, les deux puissances centrales de l’Union européenne, sont en situation de grand désarroi. La crise française est évidente, elle est structurelle. Il suffisait d’écouter le Premier ministre hier pour savoir qu’il est extrêmement difficile aujourd’hui de bâtir un véritable projet pour la France, que ce soit sur le plan européen ou intérieur.
Les élections allemandes du 23 février sont très incertaines. Il est très vraisemblable que la CDU et Friedrich Merz vont l’emporter mais dans quelle mesure, avec quelle force ? Que voudront-ils et pourront-ils faire exactement ? Seront-ils fortement menacés par l’extrême-droite ? Les sociaux-démocrates vont-ils s’effondrer ? Les libéraux devraient vraisemblablement passer en-dessous des 5 %. Les Verts qui sur certains plans (pas sur le nucléaire) sont nos partenaires les plus proches vont sans doute subir une défaite très importante. Quel score va faire l’extrême droit ? Il est extrêmement difficile de savoir ce que sera l’Allemagne de demain. Avec un tandem Merz-Pistorius, par exemple, nous pourrons agir mais le résultat peut être tout à fait différent. Quant à l’Europe méridionale, elle offre un contraste entre d’un côté une péninsule ibérique solidaire mais un peu à part et une Italie franchement hésitante entre ses fidélités européennes et les sirènes trumpistes.
Il est donc clair que nous ne sommes pas suffisamment unis.
Les Européens sont-ils mobilisés ?
Nous ne sommes pas du tout mobilisés. C’est même impressionnant ! Vous avez sans doute les uns et les autres des idées un peu nuancées sur la guerre d’Ukraine. Mais il y a maintenant trois ans, quand la guerre a débuté entre la Russie et l’Ukraine, nos pays ont pris position en faveur de l’Ukraine mais ne se sont absolument pas mobilisés à la hauteur nécessaire pour relever le défi que nous avions pourtant décidé de relever et pour assumer notre choix. Le Produit intérieur de l’Union européenne avoisine 17 000 milliards de dollars, celui de la Russie n’atteint pas 3000 milliards. Il est quand même extravagant qu’avec cette différence-là nous soyons dans une situation où nos « amis » ukrainiens, pour des raisons complexes et multiples, perdent pied alors que nous avons décidé d’être à leurs côtés. Nous n’avons absolument pas été en mesure de mobiliser comme il le fallait. Les représentants des grandes entreprises d’armement n’ont cessé de nous dire qu’ils auraient pu fournir beaucoup plus … à condition qu’on leur passe des commandes fermes ! Ce qu’on s’est gardé de faire au niveau nécessaire. Depuis un peu plus de six mois la France est en crise intérieure profonde sans qu’aucun débat géopolitique sérieux porté par la classe politique ne la traverse. Les politiques discutent de tout, du sexe du Premier ministre, de son appartenance à telle ou telle faction… et éternellement du problème important mais limité qui est celui des retraites… mais d’aucun problème géopolitique.
Ces carences du débat public sont très préoccupantes.
Je rendrai volontiers les armes à certains eurosceptiques en disant qu’il y a toujours eu une certaine ambivalence du projet européen au regard de la puissance. L’UE était-elle un projet plus ou moins bisounours de réconciliation des peuples ou un projet de reconstitution d’une autorité internationale détruite par les deux Guerres mondiales ? Il est certain que le système que nous avons mis en place n’a pas conduit à une mobilisation de nos forces. Résultat : nous étions sortis de l’Histoire en 1940, mais nous n’y sommes pas vraiment rentrés depuis lors. Le seul qui a vraiment voulu faire quelque chose de fort en matière de politique étrangère a été le général de Gaulle. Cela a fonctionné de façon assez brillante pendant un certain nombre d’années mais ça ne pouvait pas tenir faute d’institutions politiques pérennes. Le général de Gaulle ne serait-il pas tenté de dire aujourd’hui comme Simon Bolivar : « J’ai labouré la mer » ?
Les Européens sont sortis de l’Histoire il y a à peu près quatre-vingts ans et, alors que depuis des années nous sommes confrontés à des menaces précises, il n’est pas clair que nous soyons désormais prêts à y rentrer.
Les Européens ne sont pas forts.
Quand on compare l’Europe et les États-Unis, l’Europe a tous les moyens, analysait Brzeziński au début du siècle. Mais, ajoutait-il, les Américains n’ont pas à s’en soucier : l’Europe, désunie, est incapable de trouver des institutions communes, elle est donc incapable de fonctionner. Donc les Européens ne profiteront pas de leur force.
Militairement nous représentons quelque chose. Contrairement à ce que dit Trump nous consacrons une contribution assez importante à la défense collective, ne serait-ce d’ailleurs que par les armes que nos contribuables permettent d’acheter aux États-Unis. Mais cela ne prend pas de forme précise car ce n’est pas organisé, ni à l’intérieur de l’OTAN, qui n’a jamais été structuré autour de piliers jumeaux, américain d’un côté, européen de l’autre, ni dans le cadre de l’UE malgré la « boussole stratégique » (plan d’action ambitieux approuvé en 2022 pour renforcer la politique de sécurité et de défense de l’UE d’ici à 2030).
Sur le plan technologique je vous renvoie au rapport Draghi pour prendre la mesure de nos insuffisances J’étais rapporteur général du budget de l’Union européenne en 2000, sous présidence portugaise. Selon l’agenda de Lisbonne établi à l’époque, l’Europe se donnait pour but d’être la première puissance cognitive, c’est à dire intellectuelle et technologique dans les vingt-cinq ans à venir. Échec total !
Avait-on fait trop d’Europe ? pas assez d’Europe ? À part la monnaie unique l’Europe n’a rien fait depuis le début du millénaire. Le rapport Draghi est absolument accablant. Attendons de voir ce que sera la boussole, le compas économique que va sortir Mme von der Leyen mais je ne vois aujourd’hui ni conscience, ni volonté ni capacité suffisante des Européens pour redresser la situation. Le réveil de l’Europe reste à inventer.
Je n’ai pas abordé les problèmes institutionnels de la coopération politique car ils ne me paraissent pas prioritaires par les temps qui courent. Notre problème, c’est d’être unis, c’est d’être mobilisés, c’est d’être forts. Nous ne sommes pas suffisamment unis, nous ne sommes pas suffisamment mobilisés, nous ne sommes pas suffisamment forts.
Marie-Françoise Bechtel
Merci beaucoup.
Je n’aurai pas l’outrecuidance de vous demander ce qu’il faudrait faire à votre avis pour que nous soyons plus mobilisés, plus organisés et plus forts ni celle de vous demander ce en quoi la Communauté politique européenne – ou tout autre projet d’ailleurs – pourrait permettre une meilleure synergie entre les États européens, peut-être certains États européens. J’avais cru comprendre à travers votre rapport de 2023 à la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, et lors d’une ou deux conversations que nous avons pu avoir, que vous étiez quand même favorable à ce que Jacques Delors appelait à l’époque la « fédération d’États nations » et que, si le mot « fédéralisme » sonne comme un gros mot pour beaucoup d’entre nous, certains ont pensé qu’il était possible d’inventer une sorte de synthèse autour de la fédéralisation en cercles concentriques.
—–
Le cahier imprimé du colloque « L’avenir de l’Europe : que penser de la « Communauté politique européenne » ? » est disponible à la vente dans la boutique en ligne de la Fondation.
S'inscire à notre lettre d'informations
Recevez nos invitations aux colloques et nos publications.