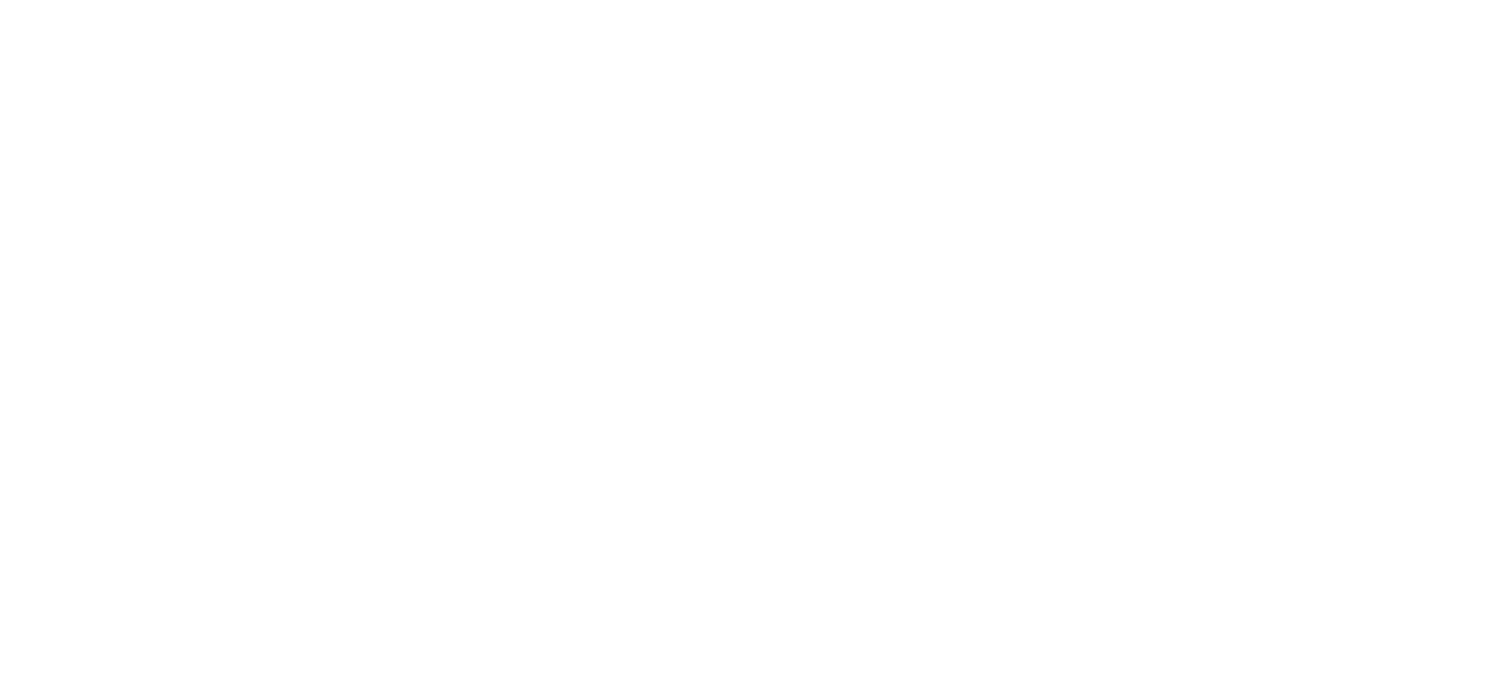Débat final
Débat final lors du colloque "L'avenir de l'Europe : que penser de la Communauté politique européenne ?" du mardi 28 janvier 2025.
Marie-Françoise Bechtel
Merci.
Vous avez tenu l’un et l’autre des propos très brillants sur le plan de la culture historique et géopolitique et très incisifs dans la manière, des propos qui à certains égards sont irréconciliables.
Je reviens sur la question de la Communauté politique européenne. Par prétérition je comprends pourquoi la Communauté politique européenne n’est à vos yeux rien ou n’est pas grand-chose. C’est une sorte de salle d’attente pour les 35 ou 36 pays qui un jour pourraient avoir vocation à entrer dans l’Union européenne.
Mais l’Union européenne telle qu’elle est aujourd’hui à 27 a assez de problèmes comme ça – c’est du moins la thèse que vous avez défendue, Julien Aubert – des problèmes auxquels il faudrait commencer par remédier avant que l’on s’achemine vers une formule de ce genre qui, d’ailleurs, devrait être précédée par une confédération politique.
Julien Aubert
Pour qu’il y ait une Communauté politique européenne il faut trois choses :
Qu’il y ait une communauté. L’Europe n’a jamais été aussi divisée que depuis que nous avons fait l’euro.
Que cette communauté soit politique (s’il y a bien une chose que l’Europe n’est pas c’est politique !). Et se poser la question d’une communauté politique passe par la démocratie.
Que cette communauté soit européenne. Or on ne sait pas où commence et où se termine l’Europe.
Tant que nous ne saurons pas pourquoi nous sommes divisés, pourquoi nous n’arrivons pas à être politiques ni à inclure la démocratie, ce qu’est l’Europe et jusqu’où elle va, parler de Communauté politique européenne est un rêve.
Marie-Françoise Bechtel
Je crois que par communauté politique il faut entendre communauté des États. Mais cela ne mange pas de pain par rapport aux européistes les plus engagés dans la construction européenne telle qu’elle est aujourd’hui parce que cette réunion d’États – qui n’est pas une construction – est extrêmement large. C’est juste quelque chose qui permettra de penser sur le long terme les éventuelles intégrations d’autres pays, avec l’énorme question névralgique que serait l’intégration de l’Ukraine qui – je suis d’accord avec vous sur ce point – créerait une catastrophe politique sur notre continent. On ne peut quand même pas ignorer complètement l’histoire ! On ne peut pas gommer les trente-quatre années qui nous séparent de la chute de l’Union soviétique, de la guerre des Balkans, de l’ensemble des négociations qui ont été menées au sein de l’Europe comme si aucun discours n’avait été tenu, aucune promesse n’avait été faite et aucun point d’équilibre n’avait jamais été recherché. On ne peut pas faire comme si l’histoire commençait aujourd’hui. Cela ne me semble pas possible.
Vous avez dit beaucoup de choses très riches mais je voudrais quand même que vous soyez peut-être davantage en écho l’un avec l’autre sur la question : et l’État-nation là-dedans ?
Les impératifs horaires m’empêchent de faire l’intervention que j’avais prévue sur ce sujet, aussi je me permets de renvoyer au premier chapitre de notre ouvrage collectif sur les travaux de la Fondation Res Publica qui porte précisément sur l’Europe et la question nationale[1]. Il me semble en effet que nous ne pouvons pas ainsi nous débarrasser de « ce spectre qui hante l’Europe ». Je crois que les nations sont plutôt de retour. Je crois que la fracture des référendums de 2005 dont nous parlions lors de notre récent colloque sur les institutions[2], a montré – et pas seulement en France[3] – que les peuples étaient très conscients de ce que leurs nations étaient maintenant ingurgitées par un ensemble dans lequel ils ne se retrouvaient pas. On a peu parlé des abus de la notion d’État de droit par la Cour de justice européenne mais aussi par la Commission et le Parlement puisque ce dernier ne manque jamais de saisir la Cour à bon ou mauvais escient.
Vous avez l’un et l’autre évoqué les dérapages qui ont suivi les transferts de compétences sur la base de ce qui avait été prévu à Maastricht puisque la réécriture de base de la Constitution provient de l’intégration du traité de Maastricht avec l’article 88-1 de notre texte fondamental. Nous avons beaucoup dérivé par rapport même à cette période.
Vous avez souligné les abus de pouvoir d’une Commission européenne qui s’arroge tous les jours des pouvoirs que personne ne lui a jamais octroyés. Or les peuples, et notamment le peuple français, ont une conscience infuse, réelle, profonde, de ce qu’est la souveraineté : un peuple qui délègue un certain nombre de pouvoirs. Lorsqu’on délègue des pouvoirs à une instance extérieure, forcément en vertu du principe de la compétence de la compétence, on lui transfère des pouvoirs qui sont précis et cadrés. Or les Français en particulier, mais ils ne sont pas les seuls, voient tous les jours la Commission européenne dériver. L’agenda atlantique que Mme Von der Leyen a certainement dans la tête, ce que manifeste d’ailleurs son embarras actuel vis-à-vis des déclarations de Trump (elle avait évidemment choisi un autre camp), ajoute des pesanteurs supplémentaires au pouvoir abusif que la Commission s’arroge tous les jours.
Pour dire les choses en termes simples, dans le cadre national nous avons quand même une vieille idée qui est celle de la souveraineté nationale, inventée par l’Angleterre puis la France : un peuple souverain qui délègue à un parlement le soin de voter une loi, également par construction souveraine, et des pouvoirs exécutif et législatif, qui sont là pour faire vivre la loi.
Aucun schéma de ce type en Europe !
Le Parlement européen, qui ne représente pas un peuple souverain, n’a de parlement que le nom. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le tribunal de Karlsruhe, la cour constitutionnelle allemande, qui écrit en 2009 que le peuple européen n’existe pas. Ce qu’on appelle « parlement » dans les institutions européennes rassemble des représentants avec lesquels on fabrique une institution qui n’a pas, loin s’en faut, la totalité du pouvoir législatif.
La Commission européenne aurait pu être l’exécutif de ce pouvoir s’il avait été législatif ou au moins l’émanation de ce que décide le Conseil des chefs d’État européens – seule institution externe à un fédéralisme qui règne par une Commission qui dispose d’un certain pouvoir… législatif ! La Commission est donc un organe hybride à la fois exécutif et législatif. C’est du jamais vu ! Ce système est vu comme « sans précédent dans le monde » par les professeurs de droit international même si cela ne suffit pas en soi à frapper son invention de nullité. Dans son manuel de droit international[4] le professeur Sur écrit que le seul exemple qu’on puisse avoir c’est le droit des gens, le droit qu’avait fondé l’Empire ottoman : des pays qui ne sont plus exactement des États-nations sont réunis entre eux par « un droit souple et lâche qui ne correspond à aucun canon du système démocratique de base ».
Je crois pouvoir dire sans polémique que nous sommes dans ce cas de figure.
Pour les uns il vaut quand même mieux s’appuyer sur les nations. Pour les autres ce cadre doit être dépassé parce qu’il est trop tard, nous avons trop de défis géopolitiques, il faut aller vers autre chose. Je pense que l’avenir de l’Union européenne mérite peut-être un peu plus d’optimisme ou d’esprit de construction que cela. Ne peut-on, en revenant sur cette « brique de base » qu’est la nation, selon l’expression de Jean-Pierre Chevènement, reconstruire quelque chose à travers les coopérations renforcées, plutôt de fait que de droit peut-être car il est extrêmement compliqué de les mettre en place dans les traités.
J’emprunte à Louis Gallois, ici présent, l’exemple des douze pays d’Europe qui se sont réunis pour défendre le nucléaire contre le Green Deal (Pacte vert) et l’agenda vert de la Commission européenne. Ne peut-on adapter cette méthode à de multiples autres sujets ? On peut naturellement penser aux industries de défense. Là c’est mal parti car il est précisé dans les attributions d’Andrius Kubilius, récemment nommé « commissaire chargé de la Défense et de l’Espace », qu’« il travaillera au développement de l’Union européenne de la défense et au renforcement des investissements de l’Union et de sa capacité industrielle ». Je pense que ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour la France …
Julien Aubert
Vous parlez de l’initiative européenne qu’est l’alliance sur le nucléaire mais quand, à propos des petits réacteurs modulaires[5], on regarde ce que la Commission a retenu dans ce qu’on appelle un projet, on voit que beaucoup de coalitions sont en réalité des faux nez des États-Unis. Ils vont donc venir vendre de la technologie américaine ! Biden avait d’ailleurs mis en place une grande coalition public/privé pour partir à l’assaut du marché européen sur ce sujet-là. Oui, politiquement, c’est intéressant mais, au-delà du symbole, il faut que cela se traduise par un retour sur investissement pour les industries européennes et plus particulièrement pour l’industrie française. Je suis très content que les Polonais bâtissent des centrales mais je préfèrerais que nous Français en vendions quelques-unes.
Marie-Françoise Bechtel
Pour une fois que nous sommes d’accord avec la Pologne sur un sujet ! Accord qu’on ne trouverait pas en matière de défense…
Je ne veux pas être trop longue sur des sujets que j’ai traités dans notre ouvrage collectif (Res Publica, 20 ans de réflexions pour l’avenir), je voudrais juste poser une question : l’expression « confédération d’États souverains » est-elle aujourd’hui vraiment malencontreuse ? N’y a-t-il vraiment rien derrière cela ?
Jean-Louis Bourlanges
Je suis très gêné par la façon dont vous abordez les problèmes parce que vous soulevez un dossier toutes les quinze secondes. C’est très intéressant à chaque fois mais comment peut-on suivre ? Il faudrait peut-être se concentrer sur un sujet plus précis.
Je ferai deux remarques :
Sur la « confédération » dont vous parlez, je ne vois pas du tout ce que c’est… Je vois bien qu’un projet de confédération a été conçu par François Mitterrand, puis repris par Emmanuel Macron avec l’idée de rassembler des États soit associés à l’Union européenne, soit destinés à rejoindre l’Union européenne, soit encore, comme le Royaume-Uni, sortis de l’Union européenne, dans le but de pouvoir échanger avec eux. Mais cette « confédération » n’a pas – et ne peut avoir – d’institutions, elle ne peut pas avoir de budget et ne peut pas émettre de normes… c’est un simple organisme de rapports entre des gouvernements. Il me semble que, pour l’essentiel, la « confédération » existe déjà à travers le Conseil européen qui, actuellement, se réunit un jour sur deux avec le Royaume-Uni. Il suffit de le réunir épisodiquement en formation élargie. Comme je l’ai dit en évoquant mon rapport sur la façon de traiter les problèmes balkaniques et ceux de l’Ukraine, il y a effectivement un grand besoin d’association politique, de réflexion politique et cet organisme, quelle qu’en soit la forme, peut servir à quelque chose. Mais ne croyons pas que cela puisse en quelque façon animer une politique commune qui déboucherait sur une politique commune. Rassembler vingt-sept ou trente personnes décidant par consensus déboucherait forcément sur quelque chose de tout à fait informe. En revanche, en tant que forum, en tant qu’instrument d’écoute d’un certain nombre de pays qui ne doivent pas rester isolés et séparés les uns des autres, cela peut être très utile.
M. Aubert a raison sur bien des points, notamment sur sa critique du système institutionnel. L’Union européenne, pour des raisons très profondes qui tiennent à la réticence des États à aller dans ce sens, n’a jamais posé clairement les questions que lui-même a posées. D’abord celle, fondamentale, des frontières. Les militants de l’Union européenne (Valéry Giscard d’Estaing, Sylvie Goulard, Robert Badinter, moi-même…) avaient par exemple très clairement exclu que la Turquie puisse être membre de l’Union européenne. Mais d’une façon générale la réflexion sur les frontières s’est limitée aux « critères de Copenhague » qui étaient quelque chose de relativement insuffisant.
On n’a donc pas vraiment répondu à la question « Qui ?» : qui doit faire partie de l’Union européenne ? On n’a pas non plus répondu clairement à la question « Quoi ? » : que devons-nous faire dans le cadre de l’Union, sorte de fédération d’États souverains, et que devons-nous faire dans le cadre de chacun des États nationaux ? Là encore, si on veut faire une politique, il faut que les gens comprennent ce qui est à l’intérieur et ce qui est à l’extérieur.
On n’a pas davantage défini le « Comment ? », c’est à dire la réflexion sur les institutions et les procédures.
La réflexion que je vous ai proposée sur la fédération d’États souverains n’a jamais été menée à son terme. Les anti-européens, les pro-européens, ont toujours un peu biaisé sur cette question. Je ne me rappelle pas que quiconque ait admis cette vérité d’évidence, à savoir que la victoire du « Non », dès lors qu’elle excluait la sortie de l’Union (cette exclusion étant au reste la condition de cette victoire), n’exprimait pas autre chose que la volonté de s’en tenir aux traités de Rome, de Maastricht et de Nice !
La réflexion institutionnelle, malmenée dans le cadre de l’élaboration d’une pseudo-constitution, a été durablement interrompue en Europe. J’avais dit très clairement dans Libération que je votais « Oui » pour dire « Non » au « Non ». « Un bon traité vaut mieux qu’une mauvaise constitution », disait justement Jacques Delors. Le débat institutionnel a été définitivement bloqué il y a vingt ans mais le gel de la réflexion vient de plus loin. Au Parlement européen, j’avais mené le combat de l’adaptation institutionnelle aux exigences de l’élargissement aux trois États neutres : Autriche, Suède et Finlande. J’avais alors mené une action très forte (en solitaire car aucun État ni aucun groupe parlementaire ne m’avait soutenu mais j’avais cependant été suivi par près de 200 parlementaires) pour dire qu’on ne pouvait pas élargir sans clarifier un certain nombre de choses comme la question des frontières, la question des compétences et la question des procédures. Delors m’avait assez fortement soutenu, de même que François Scheer, représentant permanent. Mais, pour des raisons que je comprends très bien, François Mitterrand, lors d’un voyage en Autriche, a expliqué au chancelier autrichien que l’élargissement se ferait sans modifications institutionnelles, donc sans approfondissement préalable du sujet. La raison en était que le chancelier allemand tenait à cet élargissement. Or le président français estimait avoir reçu de M. Kohl une concession très importante avec l’abandon du Deutschemark au profit de l’euro et ne voulait pas « charger la barque ». C’est à ce moment-là que le débat institutionnel sur l’Europe a été bloqué. Le débat constitutionnel mené par la convention ne l’a pas débloqué et le non au référendum l’a plombé.
Je suis contraint d’avouer que les sujets que vous avez agités, fédération, confédération, etc., n’intéressent plus personne, hélas ! Les problèmes institutionnels ne sont pas vraiment à l’ordre du jour. Nous avons abordé ces problèmes il y a vingt-cinq ans, nous ne les avons pas résolus et personne, à part vous et moi, ne veut plus en parler. Nous sommes aujourd’hui en face de problèmes purement politiques. Et nous sommes divisés, en Europe mais aussi en France. La division est notre lot sur le double plan européen et national. Vous avez raison de dire que la Commission est anti-nucléaire mais la France elle-même est loin d’être unanime sur la question. Il y a quelques années, elle était profondément travaillée – et ni Louis Gallois, ni Jean-Pierre Chevènement, ni moi-même n’étions de ce bord-là – par les anti-nucléaristes. C’était l’époque où une vedette de télévision (Nicolas Hulot) était ministre de l’Environnement et tenait sur le sujet un discours qui plaisait à beaucoup. Je suis favorable à l’Alliance pour le nucléaire et nous avons fini par constituer quelque chose qui nous donne au moins une minorité de blocage face aux anti nucléaristes mais nous sommes en face d’une opposition principalement mais pas exclusivement allemande car, pour des raisons à nos yeux dogmatiques, les Allemands font une espèce de crise sur la question nucléaire.
C’est un signe parmi d’autres de nos divisions. Nous sommes dans la situation des cités athéniennes décrite par le regretté Démosthène.
Sommes-nous capables de nous mettre d’accord avec les Allemands ? Voilà ce qui importe le plus. Globalement je crois que le choix est assez simple. Il a été formulé par le Président de la République avec la rationalité très grande et un peu éthérée qui le caractérise : nous sommes menacés par les Russes, nous sommes concurrencés par les Américains, nous sommes lâchés par les Africains, nous sommes très inquiets d’une non-coopération loyale avec les Chinois, il faut donc nous rassembler, nous unir, muscler notre industrie de défense, nous donner les moyens de construire un outil militaire capable de suppléer à une éventuelle carence des États-Unis, etc.
Il faut appliquer le rapport Draghi et donc nous unir. Enrico Letta dit la même chose (plan d’unification des marchés bancaires, etc.). Mais nous sommes en face de gens qui raisonnent trop souvent en termes d’opportunité tactique. Nos amis allemands notamment sont partagés entre la position que je viens d’évoquer et l’idée qu’il faut « s’arranger ». S’arranger avec les Américains en augmentant le budget européen de la défense… acheter du matériel américain, pour nous hausser au niveau de contribution requis par le président Trump et pour acheter la paix américaine. Ils constatent que les Américains ne veulent plus de leurs voitures, qu’ils veulent augmenter les droits de douane et que leurs propres choix énergétiques (le refus du nucléaire) font qu’ils payent l’énergie beaucoup plus cher que les Américains. Ils sont tentés de conclure, en tout cas le chancelier Scholz et la vieille garde du SPD, que la solution, c’est de faire le dos rond avec les Américains, avec les Chinois et même, à terme, avec les Russes, ce qui nécessite la fin rapide du conflit ukrainien.
Le problème démographique européen est, lui aussi, très difficile à régler mais doit être posé, ce qui va de soi, et en termes rationnels, ce qui ne va pas de soi dans l’Europe actuelle. L’industrie allemande a besoin d’immigrés. L’une des grandes causes de la stagnation allemande est l’incapacité pour un certain nombre d’entreprises de trouver de la main-d’œuvre. En même temps le traumatisme de la Saint-Sylvestre a provoqué un rejet des immigrés. Là aussi c’est une division. Une division allemande, mais aussi française et européenne.
Nous hésitons en fait sur tout. Nous ne sommes pas très clairs sur nos priorités. Nous nous sommes habitués à un modèle admirable en termes de justice, de solidarité, de protection des faibles… qui ne fonctionne peut-être pas très bien parce que le retour de la pauvreté tient à des causes très profondes telles qu’un développement excessif de l’individualisme. Mais notre système, en termes de droit, en termes de protection sociale, en termes de protection de l’environnement, etc. est bien supérieur à celui des États-Unis et même à celui de l’ensemble des peuples qui ne partagent pas nos choix. Nous y sommes attachés. Nous ne voulons pas le remettre en cause. Et sans doute à raison, même s’il faut l’adapter.
Tous ces problèmes sont politiques et les problèmes institutionnels que vous avez évoqués sont à cet égard plutôt irréels.
Marie-Françoise Bechtel
Je suis d’accord avec vous sur le fait que les problèmes principaux que rencontre l’Europe sont des problèmes politiques. Mais, contrairement à vous, je crois que le blocage institutionnel et les abus commis par des organisations européennes mal formées, mal réglées et qui fonctionnent mal ne sont pas pour rien dans le blocage politique lui-même.
Julien Aubert
L’idéologie anti-nucléaire est un problème politique, nous dit Jean-Louis Bourlanges.
Aujourd’hui, une dizaine de pays défendent l’idée d’un retour du nucléaire au sein de l’Union européenne. Quand, alors qu’une moitié des États membres défendent cette politique énergétique, la Commission européenne et sa présidente décident de bâtir une architecture de Commission violemment anti-nucléaire, c’est certes un problème politique mais surtout un problème d’organisation. À défaut de respecter les peuples, on pourrait à tout le moins respecter les représentants et les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne ! Quel syndic aurait l’idée de contrarier la moitié des occupants d’un immeuble dont il a la charge ? Un syndic normal, essaie plutôt de ne pas mettre les poubelles devant la porte des plus gros propriétaires parce qu’il a envie d’être reconduit. Il n’y a que Mme von der Leyen pour tracasser le type du troisième étage qui a 90 m2 !
Nous avons un problème qui n’est pas simplement un problème politique.
Nous sommes dans une guerre économique.
Nous n’avons pas de divergences politiques avec Donald Trump, même si nous pouvons avoir des divergences idéologiques. En réalité le problème est économique : les Américains ont décidé de changer le régime international à leur bénéfice, en entraînant les trois-quarts des pays européens qui, devenus des sociétés de marchands, réfléchissent comme des marchands. Au moins pourraient-ils se dire : nous allons « dealer » avec la Chine et à la fin nous y gagnerons … Eh bien non !
En Europe, la France est le dernier pays, avec la Grande-Bretagne, qui a encore une vision politique des choses. Mais on nous appelle à l’union ! Je veux bien m’unir avec les Allemands mais, comme le disait Bismarck, il ne faut pas commettre un suicide par peur de la mort. Je ne vais donc pas occire l’intérêt national français par peur de la mort de l’intérêt communautaire européen !
Si les autres pays, et notamment l’Allemagne, ne comprennent pas que leur intérêt est de choisir le nucléaire, de se dégager militairement et d’acquérir une forme d’indépendance et s’ils décident de devenir les petits porteurs de valises de Washington et de Pékin, je le déplore mais c’est leur souveraineté et je me dois de penser à l’intérêt national. Il est hors de question que je sacrifie ce qui reste de l’industrie française par souci de trouver à tout prix un motif d’union avec nos voisins !
Ce n’est pas un problème politique, c’est d’abord un problème de perception du contexte économique dans lequel nous sommes.
En tout cas ce n’est pas par plus de fédéralisme qu’on s’en sortira. L’Allemagne choisit en réalité la technique de l’apaisement devant un Donald Trump qui nous menace. Nous allons avoir une guerre des tarifs, le mieux c’est d’apaiser les Américains en leur donnant ce qu’ils veulent, m’a dit Christine Lagarde
elle-même. C’est une position munichoise ! Satisfaire des demandes exorbitantes pour avoir la paix ! Nous avons le choix entre l’humiliation et la guerre. Avec Trump, en choisissant l’humiliation, nous aurons quand même la guerre parce que le jour où il nous réclamera plus de tarifs sur tel ou tel produit nous obtempérerons parce que nous serons de plus en plus faibles.
Jean-Louis Bourlanges
Je ne suis pas d’accord avec l’approche de Christine Lagarde même si je respecte la dimension kantienne de son raisonnement : si tout le monde se met sur la même ligne que M. Trump, tout le monde perdra. Doit-on pour autant faire le sacrifice d’une riposte proportionnée ? s’interroge-t-elle. Comme vous je m’interroge sur le calcul stratégique à faire. Ne pas réagir c’est limiter les effets négatifs des mauvais choix américains car un ordre protectionniste généralisé serait extrêmement dommageable à la croissance mondiale. Mais c’est aussi encourager le président Trump à persévérer en le soustrayant aux conséquences de ses actes.
Julien Aubert
Vous avez tout à fait raison, c’est un changement d’époque. Rappelez-vous les dévaluations des années trente : le perdant est le dernier qui dévalue. Malheureusement, si, comme pour l’écologie ou pour le CO2, nous sommes les seuls à être les bons élèves de la planète nous risquons de nous retrouver en situation difficile.
Dans la salle
Il me semble que les difficultés de la construction de l’Union européenne viennent du fait que certains, notamment, en France, François Mitterrand, n’ont pas fait la révolution sociale qui était promise et ont d’une certaine façon abandonné la politique de lutte contre les inégalités sociales. Avez-vous sur le plan social des propositions qui changeront des politiques néolibérales qui sont aujourd’hui appliquées au niveau européen ? En effet je crois que le problème n’est pas tant la politique institutionnelle de l’Union européenne, même s’il y a des problèmes majeurs qui ont été soulevés, que la politique économique qui est mise en œuvre. Et si on change tout pour faire la même politique économique je pense que le problème ne sera pas résolu.
Julien Aubert
Je suis en partie d’accord avec vous. Je pense que la politique de la concurrence pure et parfaite, notamment européenne, est totalement dépassée dans le monde d’aujourd’hui. En effet l’analyse des failles de marché se fait sur le seul marché européen. On peut être un monopole européen mais un nain mondial. La politique de la concurrence doit prendre en compte le marché mondial, sinon on va systématiquement favoriser des géants chinois au détriment d’acteurs européens.
Je n’ai jamais cru à l’Europe sociale car je pense que c’est au plan national que se conduit la politique sociale. Le problème est plus global. Nous payons par des dégâts sociaux incroyables les conséquences de la mondialisation. C’est ce qui produit aujourd’hui la réaction protestataire dans tous les pays occidentaux. Malheureusement le retour de balancier est amorcé et je pense qu’il va, hélas, nous revenir dans la figure.
Bernard de Montferrand
J’ai été très impressionné par la qualité des analyses qui ont été faites et la description de la situation.
Mais, ai-je envie de vous dire : Qu’est-ce qu’on fait ?
Soit on dit que c’est une question institutionnelle. Et je ne crois pas du tout que Mme von der Leyen soit le vrai problème. Soit c’est un problème de volonté politique et dans ce cas-là il faut savoir ce que l’on veut.
Une chose m’a frappé : vous n’avez jamais parlé de la situation économique française, de l’affaiblissement aujourd’hui terrible de notre pays, ni de ce que sont nos intérêts nationaux. C’est à partir de là que nous devons agir.
Avec mon expérience de diplomate je peux témoigner que lorsque la France sait ce qu’elle veut en général elle voit une bonne partie de ses demandes satisfaites à Bruxelles.
Or je suis frappé de voir que depuis quinze ans nous sommes d’une grande paresse sur la définition de ce que nous voulons précisément.
Le premier exemple est celui du nucléaire. J’ai vu sur ce sujet des variations, des hésitations, des compromis… alors que nous avions des intérêts nationaux fondamentaux à défendre.
Autre exemple, celui de l’agriculture. Lorsque j’étais en Allemagne, on s’alarmait du fait que la compétitivité de l’agriculture française dégringolait – ce qui est quand même étonnant – vis-à-vis de l’agriculture allemande. Ce n’est pas très grave, nous disait -on. Nous avons des plans de redressement …
Jean-Louis Bourlanges a cité le domaine de la défense. Il se trouve que j’ai visité il n’y a pas tellement longtemps une usine française qui fabrique des obus. Je m’étonnais de voir la chaîne de montage avancer à l’allure d’un escargot. C’était faute de commandes !
Quand on sait ce qu’on veut on l’obtient. On fait des coalitions. Et, contrairement à ce que l’on dit, ce n’est pas Mme von der Leyen mais le Conseil européen qui décide, encore aujourd’hui. Encore faut-il qu’au Conseil européen nous soyons capables de dire les choses et surtout de bloquer.
Par exemple on ressort le serpent de mer qu’est depuis quinze l’épargne européenne. Aujourd’hui les marchés européens sont plus cloisonnés qu’il y a quinze ans ! Cela veut dire que notre épargne, comme on l’a redit ces derniers jours, finance beaucoup moins nos investissements et nos capacités que ça ne devrait être le cas.
« Il faut savoir ce que l’on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire », disait Clemenceau.
Notre paresse dans ce domaine me paraît aujourd’hui navrante.
Marie-Françoise Bechtel
Je suis d’accord sur le fait que Mme von der Leyen est peut-être un symptôme mais ce symptôme est grave parce qu’il est le fait de la démission des gouvernements qui nous ramène à votre analyse.
Jean-Louis Bourlanges
Je suis d’accord avec ce que dit M. de Montferrand.
Je prolongerai l’exemple. Le rapport Letta signale exactement ce que vous venez de dire, c’est-à-dire que la politique d’épargne, la politique bancaire, se sont profondément recloisonnées. C’est la limite non franchie du marché intérieur. Et c’est, avec celles que j’ai évoquées tout à l’heure (la concurrence chinoise, la démographie…), une des causes fondamentales de la stagnation allemande et européenne.
Si nous appliquions le rapport Letta, nous aurions une source de financement pour l’économie allemande. Économie allemande qui est appuyée sur un système bancaire assez archaïque. Et comme, en plus, les Allemands ont une conception extrêmement rigide de l’équilibre budgétaire (j’espère qu’ils vont faire sauter le frein budgétaire après les prochaines élections) ils ont un vrai problème de financement. Si on résolvait cette question – nous pourrions la résoudre ensemble – nous stimulerions la production allemande. Et je peux vous dire que ce n’est pas un jeu à somme négative. Nous ne sommes pas dans les logiques colbertistes, néoprotectionnistes de M. Trump. Si les Allemands vont mieux nous irons mieux aussi économiquement. Je crois qu’il y a là des choses qu’il faut penser d’une façon solidaire.
J’ai dit que les Européens ne savaient pas ce qu’ils voulaient et M. de Montferrand a ajouté : les Français non plus. Je lui en donne tout à fait acte : je pense que nous n’avons pas les idées claires, nous n’avons pas d’idées fortes.
Un autre exemple : Je suis étranger à la querelle anti-Mercosur systématique. Quand quelqu’un est condamné à l’unanimité il faut aussitôt le relâcher, dit le Talmud, parce que cela veut dire qu’il n’a pas pu faire valoir ses droits à la défense. Le débat sur le Mercosur n’a pas eu lieu. Le tabou s’est imposé. Or aujourd’hui l’agriculture française est exportatrice net à l’extérieur de l’Union européenne mais déficitaire net à l’intérieur de l’Union européenne. Ça devrait faire réfléchir. C’est exactement l’exemple que vous donniez : nous ne nous sommes pas adaptés, nous n’avons pas fait le travail. « Il ne faut surtout pas signer ! », se contente-t-on de dire, ce qui va d’ailleurs dans le sens de la « doctrine de Monroe » économique de M. Trump. Il veut nous priver d’accès à l’Amérique du Nord. Pour son plus grand plaisir nous nous priverons volontairement d’un accès à l’Amérique latine ! Comprenne qui pourra.
Marie-Françoise Bechtel
Je voudrais faire remarquer à l’ambassadeur de Montferrand que nous avons des difficultés d’entente avec l’Allemagne depuis une bonne vingtaine d’années, depuis le plan Hartz (qui a réformé le marché du travail allemand entre 2003 et 2005) et que nous entendons régulièrement dire qu’il faudrait vraiment arriver à se mettre en ligne avec l’Allemagne et à s’entendre avec elle. C’est quelque chose qui ne se produit jamais.
Julien Aubert
Je suis très content de retrouver M. l’ambassadeur de Montferrand, vingt-cinq ans après mon stage de l’ENA, dans un débat arbitré par mon ancienne directrice de l’ENA !
Je suis d’accord avec vous, je pense que le vrai problème est d’abord de définir l’intérêt national.
La question du Mercosur pose quand même un problème politique quand on voit un président de commission avancer sur un projet contesté par un pays comme la France !
Après c’est une question économique. Ces accords peuvent en moyenne être bons, dans le sens où le solde est positif pour la France, mais en démocratie ce sont les gens qui marginalement peuvent y perdre qui posent un problème. Peut-être que globalement la France gagne au Mercosur mais si le prix à payer est le sacrifice d’une partie de nos agriculteurs, à quoi bon ?
En termes d’aménagement du territoire, certaines régions (je pense à l’Île-de-France) ont globalement profité ces vingt dernières années, avec des taux de croissance de 4 %, ce qui signifie, quand on a une moyenne à 2 %, qu’il y a des régions qui, depuis dix ou quinze ans, ont chuté, notamment aux plans industriel et agricole.
Anne-Marie Le Pourhiet
Je voulais poser une question au sujet de l’intervention de M. Bourlanges qui a conjugué toute son intervention à la première personne du pluriel : « Nous sommes porteurs de valeurs, nous sommes les derniers des Mohicans (…) Nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas mobilisés, nous ne sommes pas forts », etc…
Je me suis demandé qui était ce « nous ». J’ai d’abord cru que c’était « nous, les Français » et puis j’ai compris que c’était « nous les Européens ». Donc vous bâtissez votre exposé sur le présupposé qu’il existe un « nous » européen.
Mais qui est exactement ce « nous » ? Est-ce une réalité ou un souhait, un mirage, une chimère ? La Cour constitutionnelle de Karlsruhe dit qu’il n’y a pas de demos européen, mais seulement des États dont les peuples ne peuvent être privés de leur droit à l’autodétermination politique. La Loi fondamentale allemande comporte une clause d’éternité (article 79 LF) qui interdit de remettre en cause cette autodétermination y compris par la construction européenne (article 23 LF).
Je conçois que vous critiquiez cette jurisprudence mais elle dit quelque chose d’absolument fondamental qui empêche l’« union sans cesse plus étroite » que vous évoquez dans votre cadre fédéral.
Le citoyen français a-t-il le sentiment de faire partie d’une communauté politique avec le Slovaque, Le Néerlandais ou bientôt l’Ukrainien après que le Turc a disparu de l’agenda ?
« Nous » ne sommes pas unis, organisés et mobilisés tout simplement parce que ce « nous » ne sort pas des urnes et que les élections démocratiques qui se déroulent dans les États-membres ainsi d’ailleurs que les référendums disent que nos peuples entendent continuer à s’auto-déterminer chacun librement.
L’on bute évidemment sur du politique dès lors que manque le fameux « sentiment national » d’Ernest Renan. En l’absence de ce sentiment d’appartenance collective, l’Union européenne restera une immense machine bureaucratique tendant à imposer ses normes au forceps. Frantz Kafka a décrit ce à quoi mène inexorablement ce type d’« organisation » où le réel perd le contrôle dans une entité chimérique. Vous dites que vous ne savez pas ce qu’est une nation mais une majorité de Français, de Britanniques, d’Allemands, de Hongrois, etc. ont l’air de le savoir.
Selon vous les institutions sont secondaires et le problème est politique. Il n’en demeure pas moins que vous avez, en novembre 2023, ardemment défendu à l’Assemblée nationale une résolution tendant à réviser les traités, prétendument inspirée de la « conférence sur l’avenir de l’Europe » qui n’a intéressé personne. Il s’agit pourtant de consentir encore à de considérables abandons de souveraineté en substituant la majorité à l’unanimité dans toutes les matières, y compris la défense et la politique extérieure communes. Vous prônez une union d’États souverains de laquelle tout veto national sera désormais exclu. Selon vous, la souveraineté n’est pas en cause mais les mécanismes doivent être fédéraux ! Mais c’est oxymorique ! Si c’est supranational ce n’est plus national. Le Conseil constitutionnel lui-même, a constaté que chaque nouveau traité portait atteinte « aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale », mais le futur traité dont vous préconisez la ratification achèvera de les anéantir.
Jean-Pierre Chevènement
C’est à juste titre que Jean-Louis Bourlanges a dit que beaucoup de questions avaient été soulevées pour lesquelles il n’y avait pas de réponse claire.
La question préjudicielle a été posée par Anne-Marie Le Pourhiet. Qui est ce « nous » ? De quoi parlons-nous quand nous disons « nous » ? Il me semble quand même qu’on peut encore dire que nous c’est le peuple français. Nous n’avons pas changé de constitution. Nous sommes toujours sous la Constitution de la Cinquième République. La légitimité est là. Le reste vient après.
Jean-Louis Bourlanges
Je ne vis pas la querelle des « nous ». Quand je dis « nous », ce peut être la famille Bourlanges, ce peuvent être les Français ou l’Union européenne dont notre pays fait partie. Il m’arrive de dire nous, les Occidentaux. Il m’arrive assurément de dire nous, les êtres humains. Je ne vois pas du tout pourquoi on devrait vivre dans la douleur cette pluralité des « nous ».
En revanche, méthodologiquement, la question est intéressante. Quand j’ai dit « nous », ai-je parlé en tant qu’Européen ou en tant que Français ? Je reconnais volontiers que j’ai pu glisser de temps à autre. Je suis plutôt parti du « nous » Européens et suis parfois passé au « nous » Français. Mais, c’est sans doute en raison de ma conviction profonde : je suis heureux quand il y a convergence entre ces « nous ».
Je crois qu’il faut vraiment cesser de brandir cette histoire de démos. Combien le Royaume-Uni a-t-il de démos ? Lors d’un match entre le Pays de Galles et l’Angleterre, l’Angleterre joue God save the Queen et le pays de galles joue son hymne propre. Ce sont deux nations mais ils forment ensemble un État démocratique. L’Autriche et l’Allemagne font-elles partie du même demos ? J’ai rédigé la préface d’une réédition de l’admirable lettre de Fustel de Coulanges s’opposant à la Prusse sur le fait que l’Alsace devait être considérée comme allemande. Les critères de Herder, les critères objectifs, faisaient en effet de l’Alsace une région allemande. Nos critères à nous, qui étaient des critères volontaires, des critères à la Renan, les critères d’adhésion hérités de la Révolution française, faisaient de l’Alsace quelque chose de français …La seule réalité que nous devons reconnaître, ce sont les États qui exercent la compétence de la compétence sur des territoires rassemblés au fil de l’Histoire et « les citoyens » qui sont la matière première du pouvoir démocratique. Je suis pour cette raison convaincu, comme l’était le doyen Vedel que, même si l’État est le cadre le plus approprié pour organiser le débat démocratique, on peut très bien avoir un pouvoir politique organisé démocratiquement dans le cadre d’une communauté qui dépasse la communauté nationale.
Jean-Pierre Duport
Jean-Louis Bourlanges nous invitait tout à l’heure à être unis et forts.
Vous avez terminé, M. Aubert, en disant que nous sommes confrontés à une guerre économique. Vous aviez dit tout à l’heure que c’était le retour du politique, je vois plutôt le retour de l’économique.
Ma question est simple : Mme von der Leyen peut-elle être la « cheffe » d’un cabinet de guerre économique ? Et si ce n’est pas elle, qui pourrait être chef d’un gouvernement de lutte économique ?
Julien Aubert
Je ne pense pas car on voit bien que la construction idéologique de Mme von der Leyen la rend relativement étanche à la logique d’une guerre économique qui suppose de penser un intérêt européen qui ne peut pas être l’intérêt de la seule Allemagne ni l’intérêt de personnes privées. Elle a montré par le passé – à l’occasion de l’achat des vaccins – qu’une confusion entre intérêts privés et intérêts publics n’était pas impossible. Pour moi elle n’est pas la bonne personne. Ce n’est pas grave – là je rejoins Jean-Louis Bourlanges – parce que si demain la France, l’Allemagne et quelques pays qui comptent véritablement en Europe décidaient de mener une guerre économique et d’écarter Mme von der Leyen ce ne serait pas un problème en tant que tel car son pouvoir vient du fait qu’elle occupe un vacuum que nous lui laissons.
Il n’est pas tout à fait contradictoire de dire que nous sommes dans une guerre économique et de parler de retour du politique. L’échec de la mondialisation néolibérale a suscité une protestation des peuples qui a produit un résultat politique dans la première puissance mondiale, laquelle a décidé de changer les règles pour le bénéfice de la protection de son propre peuple et donc d’ouvrir une guerre économique.
Marie-Françoise Bechtel
Je suis d’accord avec vous pour dire que Mme von der Leyen est un symptôme de la démission du politique.
Jean-Louis Bourlanges
Je ne crois pas personnellement que c’est en polarisant sur le Mercosur, sur Mme von der Leyen ou sur la Commission que nous traiterons vraiment nos problèmes qui sont beaucoup plus profonds que cela.
Je voudrais quand même dire une chose sur la guerre économique et la guerre politique. La guerre économique est voulue par Donald Trump et ses conséquences seront lourdes, mais le conflit principal est politique. Quand son principal conseiller (Elon Musk) se déclare solidaire de partis néo-nazis c’est une attaque frontale contre ce que nous sommes et ce que nous avons fait ensemble. Quand il met en cause le Premier ministre de la plus vieille démocratie européenne, la démocratie anglaise, met en cause un chancelier fédéral élu démocratiquement, met en cause les autorités norvégiennes, sans parler des Danois, nous sommes en face d’une agression politique caractérisée et qui touche à l’essentiel.
Comme vous je pense que la réaction de la Commission a été très décevante. Faire faire par le spécialiste des réseaux, du numérique, une réponse qui commençait à peu près par : Monsieur Musk a le droit d’être solidaire de l’extrême-droite… c’est un singulier début, une entrée en matière étonnante vis à vis du représentant d’un pays qui a été notre allié et qui a toujours soutenu les efforts d’une Europe démocratique et libre ! Je suis absolument scandalisé que les institutions européennes n’aient pas réagi beaucoup plus vivement et beaucoup plus solidairement. Et j’y vois la preuve de cet à-plat-ventrisme qui est la funeste tentation des peuples de la vieille Europe, de « nous » les Français comme de « nous » les Européens. Il faut relever la tête.
Marie-Françoise Bechtel
Sur cette forte invocation au sursaut politique nous allons conclure ce colloque.
Forte invocation au sursaut politique qui, je crois, est partagée par les deux intervenants ainsi que par moi-même d’ailleurs. Merci à tous.
[1] « La France et l’Europe, ou l’avenir de la question nationale », chapitre de Marie-Françoise Bechtel dans l’ouvrage collectif Res Publica, 20 ans de réflexions pour l’avenir, Paris, Plon, 2024.
[2] « L’avenir de l’économie européenne : que penser des rapports Noyer et Draghi ? », colloque organisé par la Fondation Res Publica, le 27 novembre 2024.
[3] Le traité établissant une constitution pour l’Europe est rejeté par les référendums des 29 mai 2005 en France et 1er juin 2005 aux Pays-Bas.
[4] Jean Combacau et Serge Sur, Droit international public (13ème édition), Paris, Lgdj, 2019.
[5] Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2023 sur les petits réacteurs modulaires (2023/2109(INI)).
Le cahier imprimé du colloque « L’avenir de l’Europe : que penser de la « Communauté politique européenne » ? » est disponible à la vente dans la boutique en ligne de la Fondation.
S'inscire à notre lettre d'informations
Recevez nos invitations aux colloques et nos publications.