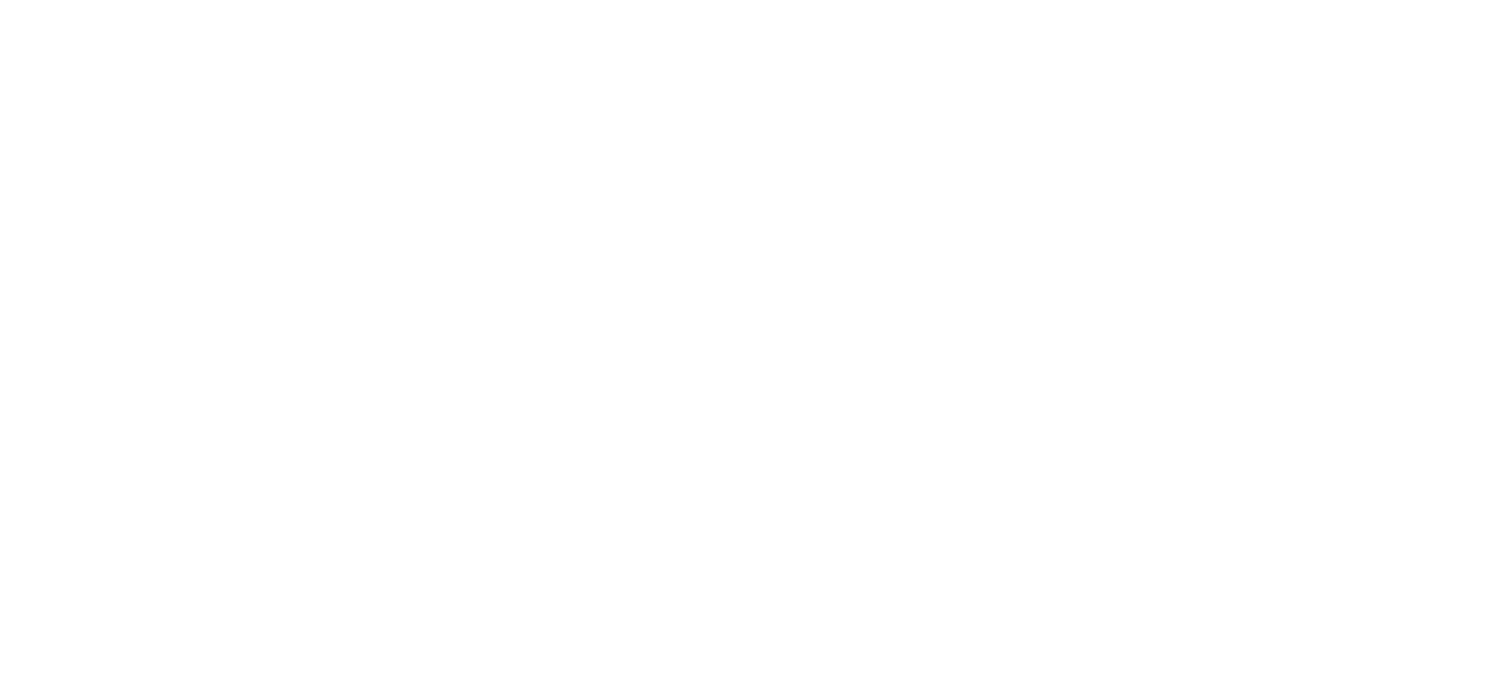Le rapport Draghi, quelles suites ?
Intervention de Franck Dedieu, docteur en sciences économiques, rédacteur en chef "Économie" et "Agora" à Marianne, membre du Conseil scientifique de la Fondation Res Publica, lors du colloque "L'avenir de l'économie européenne : que penser des rapports Noyer et Draghi?" du mercredi 27 novembre 2024.
Merci.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire deux mots sur la genèse de cette intervention. Marie-Françoise Bechtel avait prévu que Jean-Michel Naulot parlerait du rapport Noyer puis que François Geerolf développerait la dimension économique du rapport Draghi. Je devais quant à moi livrer le sens politique du rapport, sa portée symbolique. J’ai décidé de faire tout l’inverse. De dire non ce que le rapport est mais ce qu’il n’est pas.
Parce qu’il comporte un vice de conception, il intervient dans un vide européen à remplir. Il veut créer l’illusion politique que l’Union européenne peut changer, que de la stérilité bruxelloise va cesser, que l’esprit communautaire ne se résume pas à une succession de mots ou plutôt de cases à cocher. Le rapport Draghi en fait veut plaire à tout le monde et prend ainsi le risque de n’emballer personne. Il y en a pour tous les goûts. Tout le monde s’y retrouve. Les socio-démocrates y trouvent une critique de l’austérité germanique, les fédéralistes y voient un appel à poursuivre l’intégration, les néolibéraux se voient rassurer par des tentatives de dérégulations. La lecture en anglais vous donne l’impression d’une IA du « en même temps d’un robot conversationnel ultra consensuel qui aurait aspiré toutes les datas de la presse économique faite de postures bienveillantes surplombées de chiffres assommants. Si ce rapport est un énorme « tout », il devient peut-être un « rien », et c’est pour cela que l’on doit s’intéresser à ce qu’il n’est pas plutôt qu’à ce qu’il est.
D’abord il n’est pas nouveau du tout.
J’entends parler de « plus petit commun dénominateur », de « divergence » des pays. J’entends dire « Ce n’est déjà pas mal, il y a une avancée ». Ces mots-là sont usés. J’ai l’impression de les avoir entendus depuis le début de l’Union européenne. Ces mots reviennent à l’occasion des remises de rapports de gens brillants, intelligents. Et ce n’est pas tout à fait un hasard. Le point-clé du rapport Draghi concerne la stratégie d’innovation. Il préconise que 5 % du PIB soient consacrés à la recherche avec la création d’une agence européenne de l’innovation de rupture, carrément ! Très bien. Effectivement, les gains de productivité en Europe ont disparu. C’est fondamental. La différence est énorme avec les États-Unis à tel point que les Américains gagnent l’équivalent de 20 jours de travail au bout de 5 ans. 20 jours de travail supplémentaires par an grâce aux gains de productivité ! On peut débattre pendant des heures sur la question de savoir si on va devoir travailler un jour de plus pour boucher le trou de la sécu. En vérité, ce différentiel est un problème existentiel. De ce point de vue, Draghi a raison : le terme de « lente agonie » est assez vrai. Mais ce constat a déjà été fait dans les mêmes termes. J’ai ressorti le rapport de la Stratégie de Lisbonne, fait en mars 2000, « pour faire une Union européenne en 2010 »… « l’économie de la connaissance la plus compétitive du monde » il préconisait déjà de consacrer 3 % du PIB à la recherche. Ce sont les mêmes mots.
C’est facile, me direz-vous, moi aussi je me répète largement dans mes articles.
Prenons la Stratégie 2020, adoptée en 2010. Elle allait mettre l’accent sur l’innovation (toujours les mêmes incantations) pour doper le taux d’emploi et faire reculer de 25% la pauvreté.
Je continue : l’Union Bancaire en 2012-2013 visait à harmoniser la surveillance, à unifier le corpus réglementaire. Tiens, cela aussi se retrouve dans le rapport Draghi avec une union des marchés des capitaux mais avec moins de contraintes : des banques plus grosses et le recours à la titrisation pour augmenter les prêts et utiliser une épargne abondante.
C’est la même musique à chaque fois. Et à chaque fois on y croit un peu.
Le dernier « copier-coller » concerne la simplification : Draghi préconise la création d’un commissaire européen à la simplification – merveilleuse idée que de créer un statut compliqué pour simplifier – or mission a été donnée il y a quelques mois à Valdis Dombrovskis d’assurer un effort de simplification au sein même de la Commission, en disant : il faut en moyenne 19 mois entre la proposition de la Commission et la signature de la résolution.
Ce que je veux dire par là, c’est que c’est bien de faire l’exégèse du rapport Draghi mais j’ai l’impression d’une redite. À chaque fois on nous fait le coup. À chaque fois je tombe dans le panneau si vous me pardonnez l’expression.
Donc il n’est pas nouveau.
Il n’est pas non plus contestataire.
J’ai d’abord fait une brève analyse sémantique. Les mots comptent mais leur occurrence compte tout autant dans un gros rapport. Dans le rapport de 328 pages, les mots « compétition » ou « compétitivité » apparaissent 672 fois (2 fois par page). Son antonyme, si j’ose dire, le mot « protection » ou « protégé », apparaît 83 fois (8 fois moins). Quant au mot « peuple », il apparaît 34 fois et « citoyens » 33 fois. Mais les mots « intégration » ou « intégré » ressortent 82 fois, deux fois plus. Pas besoin d’un doctorat en linguistique pour comprendre le sens de cela : le rapport poursuit sur la route de l’économisme, du cadre communautaire classique. Et surtout de la concurrence. Il ne s’agit que de compétitivité, pas de protection. D’ailleurs si le rapport forme prudemment le vœu d’une Europe puissance et indépendante, il souhaite valoriser la concurrence à l’intérieur de l’Union européenne. Effectivement il y a un changement de doctrine à l’extérieur de l’Union européenne mais à l’intérieur, il faut y aller justement à fond pour le dire familièrement. Cet élément, essentiel, est capable d’annihiler toute tentative de changements concrets.
L’Europe pourrait se protéger à ses frontières des voitures chinoises mais elle devrait faciliter l’intégration à l’intérieur de ses frontières. L’idée générale est de se protéger à l’extérieur tandis qu’à l’intérieur les capitaux, les hommes, les salariés doivent circuler davantage. Le rapport remet même en cause les aides d’État accusées de favoriser les grandes Nations aux moyens budgétaires importants. Dans cette doctrine (on se protège à l’extérieur mais on augmente la concurrence à l’intérieur) il y a l’idée en vigueur depuis toujours que les salaires vont converger si les capitaux et les travailleurs circulent sans entraves. Les salaires en Hongrie restent 2,5 fois inférieurs à ceux des Français aujourd’hui. Et même s’ils augmentent à un rythme soutenu (deux fois plus vite que les salaires français depuis quinze ans) il faudrait 21 ans pour que les Français soient aussi compétitifs que les Hongrois au regard de leur condition sociale. On peut changer de braquet sur la naïveté libre-échangiste européenne, Draghi le fait, il n’est pas libre-échangiste. Mais si les disparités salariales sont exploitées sans limite à l’intérieur des frontières, alors le malaise industriel en France apparaît et les grands pays européens, sur le plan industriel, finiront quand même par y perdre. L’exemple de BYD, constructeur chinois de véhicules électriques, est à cet égard assez éloquent. On met, sous la pression française et à bon droit, des taxes aux frontières de manière à ce que les voitures chinoises n’arrivent pas sur notre sol mais les Chinois contournent l’obstacle et construisent ces voitures sur le continent européen… en Hongrie ! Et aujourd’hui les salariés français de Renault et de Stellantis, se retrouvent en compétition avec des salariés hongrois. On peut se dire que les salaires vont finir par converger. Si les Hongrois augmentent deux fois plus vite leurs salaires … simplement il va falloir 21 ans. Et en 21 ans on a le temps de passer à la machine à laver tout notre tissu industriel et de voir arriver des groupes d’extrême-droite dans tous les pays.
Donc le rapport Draghi, qui n’attaque pas ce dogme synonyme de paupérisation des classes moyennes, n’est pas contestataire du tout. Il n’est pas nouveau du tout.
Je dirai qu’il n’est pas courageux non plus. Au fond l’Union européenne ne fabrique pas seulement des normes. Alors qu’elle a un problème existentiel, elle produit du storytelling, elle scénographie sa vacuité. Les journalistes ont leur responsabilité : « Le sommet de la dernière chance », titrait-on à chaque fois quand tombait un communiqué doucereux illustré par une photo de groupe. On a désormais « Le rapport qui dit tout sans faux semblants ». On avait la langue caoutchouteuse de Bruxelles, on se retrouve avec une collection de « yakafokon » avec force tableaux, façon consultant américain. La critique à peine voilée de l’Allemagne tient du cas d’école. Le rapport pointe du doigt son approche trop mercantiliste, trop excédentaire, trop tournée vers la dépendance énergétique. Mais il ne propose rien d’institutionnel. Or, la stratégie germanique, certes réprouvée dans le rapport, se fonde sur le libre-échange, l’austérité salariale, l’euro surévalué, absolument pas remis en cause par Draghi. « Comment faire de la relance ? » a interrogé Marie-Françoise Bechtel. « D’où vient le décrochage ? » se demande plutôt Draghi. Il ne répond pas au « Comment ? » puisqu’il n’apporte rien sur la question institutionnelle, sur la structure même de l’Union européenne, sur ces dogmes qui surplombent tout le reste et rythment désormais notre vie politique : le budget 2025 de Barnier, les retraites 2023 de Borne et le Pacte de stabilité à respecter prennent leur source à Bruxelles. Vous pouvez faire tous les diagnostics formidables et, avec un certain courage, rompre avec cette langue un peu naïve de l’Union européenne, ça n’apporte rien si la question institutionnelle reste sans réponse. Le rapport critique les conséquences d’un système dont il apprécie les principes. Il livre un mode d’emploi mais sans les bons outils. Il dessine une Europe du bon sens et des évidences, plus solidaire, plus puissante, moins tatillonne, mais garde les mêmes pièces du puzzle. Raymond Aron critiquait les communistes quand ces derniers comparaient « les États-Unis tels qu’ils sont avec l’Union Soviétique telle qu’elle devait être ». Les compagnons de route du PCF évoquaient l’idéal soviétique mais se moquaient du réel de la Russie et de ses épigones. Ce rapport se fixe un idéal assez consensuel mais ne se soucie pas du réel, du tangible, des grands équilibres. Par exemple : il préconise 800 milliards de financements supplémentaires mais l’ancien Président de la BCE connaît bien assez les forces en présence pour savoir que les pays dits frugaux s’y opposeront (l’Allemagne, l’Autriche ou encore les Pays-Bas). Une hypothèse : et s’il ne s’agit pas de transformer toutes ces exhortations en réalisations mais plutôt de continuer le storytelling européen, de combler le vide bruxellois. Ce rapport met tous les sujets à plat, il peut se lire en diagonale mais il finira sans doute classé à la verticale. Merci.
—–
Le cahier imprimé du colloque « L’avenir de l’économie européenne : que penser des rapports Noyer et Draghi ? » est disponible à la vente dans la boutique en ligne de la Fondation.
S'inscire à notre lettre d'informations
Recevez nos invitations aux colloques et nos publications.