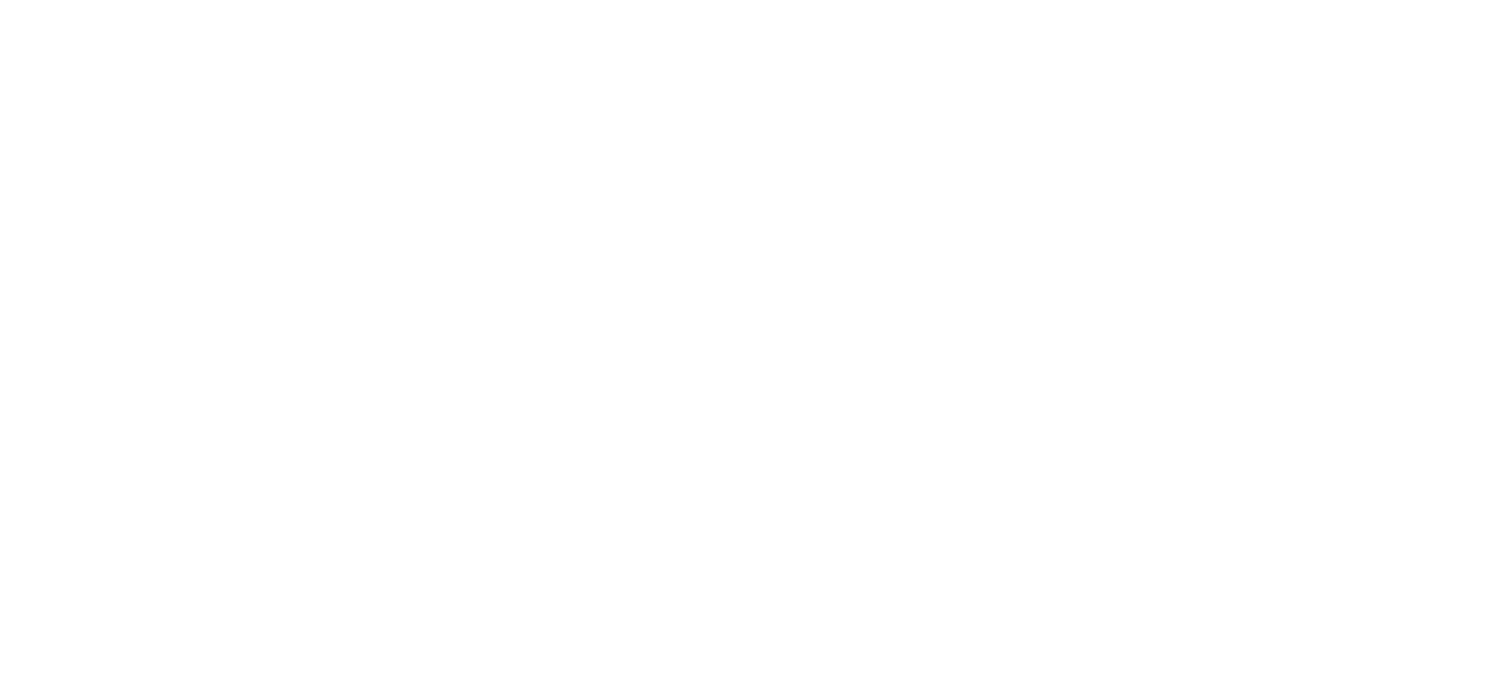Débat final
Débat final lors du colloque "L'avenir de l'économie européenne : que penser des rapports Noyer et Draghi ?" du mercredi 27 novembre 2024.
Marie-Françoise Bechtel
Merci.
Vous nous dites que Draghi est un faiseur. Mais ce qu’il dit a quand même un débouché politique : le sommet de Budapest se réfère explicitement au rapport Draghi. Le Président de la République française dit lui-même y attacher une grande importance. N’y a-t-il pas dans le langage que Draghi tient vis-à-vis de l’austérité à l’allemande quelque chose de neuf qui pourrait faire de ce rapport le point d’appui pour la remise en cause de ces volontés austéritaires dans le cadre d’un plan de relance qui n’est quand même pas tout à fait rien (800 milliards) ?
Comme cela a été souligné on lit dans le rapport Draghi la critique du libre-échangisme, qui est très importante, mais aussi l’idée de la mise en cause des politiques de restriction budgétaire et le plan de relance à 800 milliards … Mais le point le plus important pour moi est quand même sa reprise par les autorités politiques, ce qui a quand même une signification.
À quel prix pourrait-on mettre en œuvre le rapport Draghi dans sa totalité – ce qui est douteux face à l’opposition des pays austéritaires ? Telle était la question que je posais en introduction… et à laquelle je n’ai pas obtenu de réponse. Car il me semble que Draghi va dans le sens d’une plus grande fédéralisation politique de l’Union européenne, avec un commissaire qui serait spécialement chargé, si j’ai bien compris, de surveiller les dérapages. Tout cela est loin d’être neutre sur le plan de la configuration politique future de l’Union européenne. N’y a-t-il pas un lien entre le rapport Draghi, un rapport intelligent, cela a été dit – même si son intelligence est un peu surévaluée selon Franck Dedieu, nous l’avons bien compris –, et ce qu’un certain nombre de partisans du fédéralisme européen regarderaient comme des avancées ?
C’était la question initiale que j’avais posée. Peut-être la réponse viendra-t-elle, fût-elle négative, dans les débats.
Franck Dedieu
Je reviens à la dimension juridique et institutionnelle. Il ne résout pas l’hésitation entre la souveraineté nationale et un « saut hamiltonien » fédéraliste. La majorité qualifiée, dans ce rapport, prévaut largement sur la majorité simple sur à peu près tous les sujets importants. Il n’est donc pas véritablement fédéraliste. Mais malgré un réalisme par rapport à l’importance des nations il reste quand même prêt à abandonner l’idée que la souveraineté populaire se fera dans le cadre de l’État-nation. Si cette hésitation institutionnelle conduit le rapport à produire de l’intelligence et de la réflexion vous n’aurez pas 800 milliards d’emprunts pour favoriser l’innovation parce qu’il y aura des blocages institutionnels. On peut s’en féliciter parce que derrière il y a l’idée d’unanimité et l’idée de la souveraineté nationale. Ou on peut être désolés parce qu’on ne produira pas fondamentalement de crédits européens à cette hauteur. Si cela a eu lieu il y a quelques années, c’est bien sûr sous la pression du covid où tout le monde est devenu keynésien.
Marie-Françoise Bechtel
Je voulais donner la parole aux autres intervenants, avant de la donner à la salle, sur l’appréciation du côté plus ou moins disruptif du rapport Draghi et de son utilisation politique éventuelle.
Jean-Michel Naulot
Draghi a beaucoup de talent pour dire les choses sans avoir à les dire explicitement… Au mois de juillet 2012 il a montré qu’il savait embarquer les gens dans des rêves qui ne correspondaient à aucune réalité, nous expliquant qu’il ferait tout pour sauver l’euro quand certains économistes et juristes objectaient : il y a quand même des traités européens ! Il est très convaincant, s’exprime brillamment, il est séducteur …
Marie-Françoise Bechtel
Il a quand même à l’époque adopté une politique nouvelle qui n’était pas évidente selon les statuts de la BCE.
Jean-Michel Naulot
Oui, mais l’histoire n’est pas terminée.
Je voulais dire un mot également de la tentation de certains d’avoir une politique monétaire plus offensive. Depuis 2008 nous avons connu une politique monétaire, aux États-Unis et en Europe, qui n’a pas de précédent dans l’histoire. De 1945 à 2008, aux États-Unis comme en Europe, les banques centrales n’ont pas créé directement de la monnaie. Pendant ces dizaines d’années, le bilan de la banque centrale faisait dans chacun de ces grands États entre 4 % et 6 % du PIB. C’est-à-dire que la banque centrale jouait son rôle traditionnel qui était de fixer les taux d’intérêt. Traditionnellement, ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie. Quand une banque accorde un crédit, elle fabrique de la monnaie. Quand le crédit est remboursé on détruit de la monnaie mais entre-temps la monnaie a fait des petits. Depuis la crise de 2008, nous sommes entrés dans un univers complètement différent auquel nous nous sommes habitués. Cela fait flamber les marchés financiers. La bourse américaine est aujourd’hui dans ses plus hauts niveaux historiques, tout près du niveau de 2000. Tout cela est très agréable mais cela s’accompagne de bulles financières. Avec le quantitative easing pendant la crise depuis 2008, la banque centrale a acheté quantité d’actifs financiers et elle a ainsi fabriqué directement de la monnaie. Ce n’était pas le cas avant. Et au lieu de limiter cette action à la période de crise, elle a continué quand la crise était terminée. Il en est de même de la BCE. Nous sommes donc dans une situation qui est très fragilisée sur le plan financier. Il faut en tenir compte. Il est très agréable de doper l’économie mais jusqu’au moment où ça craque…
Je me demandais si l’évaluation d’un supplément d’investissement de 800 milliards par an du rapport Draghi n’est pas un peu exagérée. Le rapport Noyer ajoute même 200 milliards au titre de la défense. 1 000 milliards, c’est plus mobilisateur ! Ce sont des chiffres qui sortent probablement des dossiers de la Commission mais ils ne sont pas pour autant crédibles… Certains disent que le besoin serait plutôt de moitié. J’ai rarement vu une banque refuser un dossier d’investissement de qualité ! Les banques ont des fonds propres et elles sont très désireuses d’avoir de bons projets à financer.
Sur la politique monétaire je voulais apporter un complément. Jacques de Larosière, qui est né en 1929 et relisait récemment Keynes…, évoque ce que Keynes appelle la « trappe à liquidité », c’est-à-dire des taux d’intérêt trop bas qui ont l’inconvénient de décourager les investissements. Prendre des risques quand les taux sont proches de zéro n’a en effet aucun intérêt. D’où l’abondance des liquidités. Et ces liquidités, aujourd’hui, vont toutes dans les marchés financiers. Il y a donc dans de telles circonstances un double risque : un risque de bulle financière et un risque de ne pas financer assez l’investissement. Donc Jacques de Larosière, qui est en pleine jeunesse, est très réservé sur une politique monétaire trop agressive.
C’est pourquoi il faut bien réfléchir avant de dire qu’aujourd’hui la BCE doit abaisser rapidement ses taux d’intérêt. Nous sommes dans une situation inédite. Jacques de Larosière dit très bien aussi que les montages financiers qui ont été faits quand les taux étaient à zéro, et qui se promènent actuellement dans les marchés américains, rappellent les subprimes, des opérations qui ont été montées dans des conditions de financement très différentes. Il n’y a jamais eu autant de titres financiers sur les marchés américains qui sont à la limite de ce qu’on appelle l’investment grade, c’est-à-dire qui peuvent basculer brutalement du côté de produits de mauvaise qualité.
Sur la politique monétaire, j’attire quand même l’attention sur certaines analyses. On voit depuis quelques années émerger des théories complètement farfelues. Il y a quatre ou cinq ans, on nous expliquait que selon la MMT (Modern Monetary Theory) les taux allaient rester très longtemps très bas. Il fallait donc emprunter massivement. Aujourd’hui, avec la remontée des taux, on n’entend plus ces grands économistes… Il faut se méfier des tentations en matière monétaire.
Marie-Françoise Bechtel
Je me tourne vers le troisième intervenant.
Si je devais résumer brutalement vos appréciations du rapport Draghi, je dirais, pour Franck Dedieu : beaucoup de bruit pour rien … pour Jean-Michel Naulot : du nouveau mais risqué …
Comment résumeriez-vous le caractère plus ou moins nouveau du rapport Draghi et les éventuels risques politiques qu’il peut entraîner ?
François Geerolf
La proposition de 800 milliards d’euros par an de financement en commun me paraît totalement hors-sol quand l’Allemagne refuse de dépenser pour elle-même et de remettre en cause sa règle de frein à la dette, au moment où elle a des difficultés absolument considérables, tant du point de vue industriel que de la défense, etc. On se souvient des discussions sur les Européens du Sud, qualifiés de flemmards, au moment de la crise de la zone euro. Comment les Allemands accepteraient-ils de financer les Français dont ils estiment depuis des années qu’ils devraient faire des efforts et mettre de l’ordre dans leurs finances ?
Marie-Françoise Bechtel
Je vous remercie beaucoup de cette troisième appréciation, encore différente des deux autres : la proposition de Draghi est « hors-sol » en raison de la crispation allemande sur les mécanismes budgétaires. Ceux-ci n’arrivent-ils pas tout de même au bout du bout ? La Commission elle-même a depuis maintenant des années encouragé l’Allemagne à investir dans les infrastructures, ce dont personne ne parle.
François Gouyette
Ma question s’adresse à Jean-Michel Naulot.
En présentant les perspectives de la présidence Trump au début de votre intervention, vous avez, si j’ai bien compris et bien entendu, indiqué que la politique économique de Trump allait être à la fois néolibérale et protectionniste.
N’y a-t-il pas une contradiction dans les termes ?
Jean-Michel Naulot
C’est exact, il y a une contradiction. Mais malheureusement je pense qu’il va concilier les deux politiques. D’un côté, il veut déréglementer massivement dans les domaines de l’énergie, de l’écologie et de la finance et, de l’autre, il veut protéger.
La question que l’on peut se poser est de savoir si son protectionnisme va vraiment se mettre en place ou si c’est une menace pour négocier. Je sais qu’il y a un brin de contradiction à parler de « néolibéralisme ». C’est, là aussi, l’expression de sentiments un peu mélangés. Donald Trump est quelqu’un d’autoritaire qui veut détruire toutes les barrières internes. Mais, parce qu’il raisonne comme un homme d’affaires, il est très favorable aux marchés financiers.
Cela me rappelle les années 1980-1990-2000. Le marché des quotas de carbone avait été proposé lors de la Conférence de Kyoto (COP 3) de 1997, par Clinton qui suggérait de créer un marché financier sur lequel on échangerait des droits à polluer. Les Américains avaient imaginé que la lutte climatique pouvait être un marché financier, ce qui était très choquant au départ. En fait, les Américains se sont tenus à l’écart mais les Européens ont foncé tête baissée sur cette proposition et l’ont mise en place à partir de 2005. C’était la caricature d’une forme de libéralisme. Puis ce marché a totalement dysfonctionné jusqu’en 2018. Les quotas de carbone sont restés à 5 euros la tonne de carbone pendant quinze ans et aujourd’hui ils sont à 70 euros parce qu’on s’est rendu compte qu’il fallait être beaucoup plus interventionniste sur le fonctionnement du marché.
Nous avons donc connu une explosion du libéralisme pendant trente ans, ce qui nous a conduits aux crises financières dramatiques de 2000 et 2008 qui m’ont laissé des souvenirs abominables. Aujourd’hui j’ai le sentiment que nous sommes repartis dans la même direction : Trump va déréglementer le système financier (c’est du néolibéralisme). Je crois que le protectionnisme est plus qu’un instrument de négociation. Quand Trump annonce à l’avance au Mexique et au Canada qu’il va imposer les importations à 25 %, c’est une décision considérable !
Franck Dedieu
Il peut y avoir une contradiction apparente dans les termes. En effet l’idée de Trump c’est d’être néolibéral et favorable à la déréglementation à l’intérieur des frontières et protectionniste à l’extérieur. C’est finalement quelque chose d’assez vu dans l’histoire. Les Anglais, au XIXème siècle, avaient les Corn Laws qui étaient protectionniste à l’extérieur et très classiquement libérales à l’intérieur.
Sur le plan politique cet attelage idéologique pose une question vertigineuse car il marie le populisme avec quelque chose de libertarien. C’est à peu près la même philosophie, finalement, que l’opposition entre protectionnisme et néolibéralisme. C’est un autre sujet mais qui recouvre peut-être les mêmes réalités politiques.
Arabelle Conte
Je suis étonnée que vous n’ayez pas cité la question de la réindustrialisation, qui ne doit figurer dans aucun des deux rapports. Visiblement ce n’est pas un sujet qui intéresse M. Draghi. Il me semble pourtant que ce devrait être le sujet prioritaire pour les Français comme pour les Européens.
Comment analysez-vous cette absence ?
François Geerolf
Il se trouve que j’ai écrit un chapitre dans l’ouvrage L’économie européenne [1] sorti il y a quelques semaines sur « la réindustrialisation entre l’Union européenne et les nations ». Là encore c’est un sujet de divergence entre nations européennes. En fait il n’y a que la France qui veut parler de réindustrialisation globale parce que l’Europe est surindustrialisée si on prend en compte la part du PIB. C’est d’ailleurs pourquoi nous sommes sujets aux rétorsions commerciales américaines. En effet, en Europe, il y a des pays qui sont très industrialisés : l’Allemagne évidemment mais aussi des pays d’Europe de l’Est depuis leur accession à l’Union européenne. La réindustrialisation est donc un problème que les Français mettent à l’agenda mais dans les autres pays industrialisation veut dire protectionnisme donc rétorsions commerciales. En fait on n’a pas du tout intérêt à en parler, de même qu’on n’a pas du tout intérêt à parler de tarifs douaniers en général.
En revanche le rapport Draghi déplore que nous soyons plutôt spécialisés dans les industries « d’hier » : l’automobile, le moteur thermique, alors que les industries de demain c’est plutôt l’IA, les gros serveurs de données, etc.
Il y a donc là une interrogation. Les États-Unis qui sont globalement désindustrialisés (leur part du PIB est inférieure à 10 %) ont quand même un avantage dans les secteurs de l’IA, du numérique, etc. Et le rapport Draghi suggère que nous les imitions. Mais c’est vrai qu’il n’y a pas de sujet de réindustrialisation qui se pose, en tout cas au même niveau. C’est pourquoi, quand on parle de souveraineté française et européenne, je rencontre un problème pour prôner la réindustrialisation au niveau européen car en fait nos partenaires ont du mal à comprendre ce langage.
Jean-Michel Naulot
Tout de même les 800 milliards dont nous parlons ciblent bien une réindustrialisation : le numérique, la transition écologique, les investissements de pointe. N’étant pas spécialiste, je ne saurais dire où il faut investir mais la réindustrialisation est un sujet très important pour de multiples raisons, sociales, économiques et de souveraineté. Derrière la finance, il y a des investissements.
François Geerolf
Le sujet est de savoir si on veut aller vers la production ou uniquement vers l’innovation. Dans « France 2030 »[2], qui s’est plutôt focalisée sur les projets innovants, la question se pose : voulons-nous vraiment faire revenir les usines, y compris dans un large éventail de domaines ou souhaitons-nous nous focaliser sur les technologies de pointe ? Là encore on n’est pas totalement sûr d’avoir bien défini ce qu’on veut faire.
Jean-Michel Naulot
Les Américains, avec l’Inflation Reduction Act, veulent industrialiser. C’est un thème d’actualité. J’ai probablement été un peu trop « financier » dans mes propos mais la réindustrialisation est bien l’objectif, le cœur du sujet. Toute cette finance n’a aucun intérêt si elle ne débouche pas sur la création d’emplois.
Philippe Taupin
Franck Dedieu parlait de l’absence du peuple. Benjamin Lemoine, universitaire, a écrit un livre intitulé La démocratie disciplinée par la dette[3] où il explique que la finance publique, en gros, devient l’assureur en dernier ressort de la finance privée. Dans ce livre il évoque l’idée d’un comité européen du crédit où il y aurait de vrais morceaux de représentativité à l’intérieur (comme dans un yaourt aux fruits).
On entend parler de la BCE, de la Commission européenne, on entend parler de 800 milliards mais tout cela manque singulièrement de représentation.
Peut-être ce sujet sera-t-il évoqué lors du prochain colloque. Je parle du meccano institutionnel. Mais à propos de cette idée du comité européen du crédit, peut-être avec de la régulation bancaire dedans, peut-être faut-il réintermédier avec l’appel plus massif aux banques pour financer ? Est-ce que cette idée du comité européen – voire national – du crédit, avec de la représentation, peut faire partie des solutions ?
Franck Dedieu
Pour répondre à votre question sur l’absence du peuple dans le rapport, il y a un malaise à l’égard du cadre de la souveraineté populaire. En effet, pour ces personnels qui ont dirigé la BCE, qui ont travaillé chez Goldman Sachs, etc. la souveraineté nationale est considérée comme rétrograde, voire dangereuse. Mais ils sont suffisamment intelligents pour noter que la souveraineté européenne n’a pas une véritable consistance politique. Je pense donc que si la notion de peuple est absente dans ce rapport c’est parce que les deux cadres de la souveraineté, la nation ou l’Europe, ne sont pas véritablement fixés pour eux. En revanche ils sont très diserts et très sûrs d’eux en ce qui concerne la publication de décrochage de PIB, de désindustrialisation, de productivité ….
Mais l’absence qui est au cœur du rapport, c’est la question institutionnelle…
Marie-Françoise Bechtel
À moins que cette question institutionnelle ne soit traitée implicitement. Je pense que ce rapport va dans la direction d’une fédéralisation de l’Europe avec plus de votes à la majorité qualifiée, au prétexte que l’on ne pourra pas faire des projets communs sans cela, et que tout cela nous mène nécessairement dans une direction très fédéraliste.
Nous partirons d’ailleurs de cette conception lors du prochain colloque pour essayer d’examiner ce qu’est la « Communauté politique européenne. » En effet elle peut avoir deux faces tout à fait opposées. Même si cela échappe aux peuples qui n’en ont pas conscience – rien n’étant fait pour les éclairer sur le sujet- il me semble qu’un certain nombre d’hommes d’État européens se rendent compte que l’absence de gouvernance politique de l’Europe, la montée en puissance de la Commission, est devenue quelque chose qui va rendre l’Europe ingouvernable, prise au grand vent de la mondialisation et au défi particulier que les États-Unis font peser sur elle depuis l’IRA de Biden.
C’est ainsi que je vois les choses. Ce sera le point d’accrochage avec notre prochain colloque sur les institutions européennes. Personnellement, derrière le rapport Draghi, je sens une petite musique fédéraliste quand même très insistante.
Jean-Michel Naulot
La Banque centrale européenne et la Commission sont des institutions complètement différentes.
La Banque centrale européenne est une institution fédérale. À l’époque, Jacques Delors, tous ceux qui ont plaidé pour le Traité de Maastricht, et Mundell – l’économiste qui a également joué un rôle dans la préparation de l’euro pendant trente ans – pensaient que le fait de créer une Banque centrale européenne allait faire basculer tout le reste des institutions européennes vers le fédéralisme. Par ailleurs, on voit, aux États-Unis comme en Europe, que la banque centrale est totalement indépendante des gouvernements. Ce n’était pas le cas autrefois. On peut se demander si on a eu raison de donner une indépendance aux banques centrales. Je pense que si celles-ci étaient restées dans la dépendance des gouvernements on aurait créé beaucoup moins de monnaie qu’avec cette banque centrale indépendante qui, de plus, n’hésite pas, avec beaucoup d’habileté, à violer les traités.
Depuis le traité de Lisbonne on a confié à la Commission l’intérêt général européen. Grave erreur car elle se sert de cet article (l’article 17 du TUE) pour prendre des initiatives, notamment depuis que Mme Von der Leyen préside l’institution. Les gouvernements ne jouent pas du tout leur rôle qui devrait être, non seulement de canaliser les initiatives de la Commission mais de mettre en place une politique européenne de relance de l’investissement. Tous autour de la table, avec des pays comme l’Allemagne, nous pourrions mettre la pression pour que soit appliquée une politique de relance de l’investissement. Or ce n’est pas le cas.
À une époque, j’ai beaucoup suivi les questions de la régulation à la fois au titre de l’AMF et avec Michel Barnier. J’ai observé et regretté très vivement que les gouvernements ne jouent pas leur rôle à Bruxelles. Des jeunes fonctionnaires français d’une très grande qualité s’y battaient comme des lions jusqu’au moment où leur ministre, qui n’avait pas ouvert le dossier et ignorait ce qui était en discussion, vienne les presser d’aboutir : « Il serait peut-être temps de signer. C’est très bien, vous vous donnez beaucoup de mal mais il faut qu’on avance ! » Vraiment, j’ai été très choqué à de très nombreuses reprises par l’attitude des gouvernements. Je vois comme un point très positif chez Mario Draghi le fait qu’il appelle à une relance de la coopération intergouvernementale et à la mise au goût du jour du rôle des États dans le fonctionnement de la Commission européenne.
De même, je trouve que les citoyens ne sont pas assez, et même pas du tout, informés de ce qui se passe à Bruxelles. Nos députés européens rendent rarement compte auprès des citoyens du travail qui est fait, sauf dans les périodes électorales… Nous ne sommes pas informés non plus des négociations en cours. Quand il y a un Conseil européen, on dispose de deux pages de compte-rendu et on ne sait pas ce qui se négocie vraiment.
Marie-Françoise Bechtel
Le Parlement national français lui-même ne fait pas son travail en ce qui concerne le contrôle par des résolutions des directives européennes dont il est parfaitement habilité aux termes de la Constitution à dire qu’elles outrepassent éventuellement les compétences bruxelloises et Dieu sait que les exemples ne manquent pas
J’ajoute une chose qui complète le tableau que vous faisiez. Dans les années que vous évoquez on voyait aussi les hauts fonctionnaires français, y compris des directeurs d’administrations centrales qui négociaient des directives à Bruxelles sans aucune consigne. Ils revenaient en disant : on a dit ça et ça, on va signer la directive, laquelle était ensuite transposée avec force complexités… c’est un engrenage extrêmement dangereux pour une vision démocratique des choses.
Mais le plus grand danger est quand même une Commission de Bruxelles qui est devenue une sorte d’appareil d’État sans État.
Jean-Michel Naulot
J’ajoute que ce sont des gens remarquables sur le plan professionnel, extrêmement compétents. Si on se laisse impressionner par les lobbies et qu’on ne fait pas le boulot à fond, ils font ce qu’ils veulent.
Nicolas Leblanc
Pour aller dans le sens de M. Naulot sur le fait d’exploiter la dimension intergouvernementale et aussi pour rebondir sur ce qui s’est dit au cours des échanges sur les obstacles politiques qui existent à la mise en œuvre du rapport Draghi, notamment le fait qu’ils nécessiteraient sans doute de mettre en œuvre un saut fédéral, j’observe que le fait de s’endetter en commun constitue en soi un pas dans le sens d’un fédéralisme. Très concrètement, pourrait-on faire du Draghi sans la fédéralisation ? Est-il possible dans le cadre européen actuel de faire ce plan massif d’investissements dans l’innovation en contournant l’exigence d’aller vers le saut fédéral ou même en contournant les institutions européennes actuelles ?
Franck Dedieu
Dans le rapport Draghi, il est question de coopérations renforcées qui seraient assouplies et développées. On peut imaginer par exemple qu’à défaut d’obtenir la majorité qualifiée ou l’unanimité sur certains sujets, il puisse y avoir, y compris même pour lever de l’argent, un groupe de pays qui seraient prêts à jouer le jeu. Donc l’idée des coopérations renforcées peut être une réponse à votre question qui consiste finalement à contourner l’exigence de majorité qualifiée ou d’unanimité pour agir tout de même au niveau supranational.
Marie-Françoise Bechtel
Cette perspective est très importante. Vous êtes en train de dire que le rapport Draghi ne ferait pas obstacle à des coopérations renforcées. Mais il faudrait, encore une fois, que des gouvernements -quelques-uns d’entre eux au moins – prennent des initiatives communes pour avancer. On a parfois vu des coopérations renforcées de fait. Je pense aux douze pays qui se sont mis derrière la promotion du nucléaire, ça a plutôt bien marché. Il y a peut-être d’autres domaines dans lesquels ces coopérations renforcées, plutôt de fait que de droit, pourraient se manifester dans les enceintes bruxelloises. Il ne faut pas désespérer. Mais je note alors que, de ce point de vue-là, on pourrait considérer que le rapport Draghi est neutre par rapport à la formule politique qui permettrait de le traduire. C’est la question que je posais dans mon introduction. Le rapport Draghi, quelle que soit sa nouveauté, exige-t-il de nous, pour être mis en œuvre, une sorte de « saut fédéral », des engagements qui iraient au-delà de ce à quoi nous consentons aujourd’hui (qui est encore beaucoup trop) ? Jean-Michel Naulot rappelait que le budget de la France ne se négocie pas à Bruxelles mais se contrôle à Bruxelles. Et ça dure des mois ! Il y a le premier semestre, le deuxième semestre, ensuite, avant que le Parlement ne vote, il rencontre au sous-sol de l’Assemblée nationale, salle Lamartine, des fonctionnaires de la Commission qui lui expliquent ce qu’il va aller voter !
Jean-Michel Naulot
Les années 2010-2013 ont été absolument terribles. On a alourdi les procédures. Dans le renforcement des critères budgétaires européens qui vient d’être décidé, les pays qui ont plus de 90 % de dette (suivez mon regard) doivent réduire le déficit structurel de 1 % tous les ans … Nous sommes contraints de rédiger en permanence des copies sous haute surveillance … Les procédures sont beaucoup trop lourdes. La convergence dans les politiques financières est parfaitement normale à partir du moment où l’on a une seule monnaie mais ces procédures infantilisantes vont beaucoup trop loin.
Marie-Françoise Bechtel
Il faudrait laisser les États libres d’aller vers des convergences qui seraient politiquement négociées par les voies et moyens qu’ils trouveraient les plus appropriés.
Nous allons terminer le colloque de ce soir en remerciant l’assistance.
[1] OFCE, L’économie européenne 2025, Paris, La Découverte, 2024.
[2] « France 2030 », plan d’investissement dévoilé en 2023 par le président de la République. Avec 54 milliards d’euros, ce plan devait permettre de rattraper le retard industriel français, d’investir massivement dans les technologies innovantes ou encore de soutenir la transition écologique.
[3] Benjamin Lemoine, La démocratie disciplinée par la dette, Paris, La Découverte, 2022.
Le cahier imprimé du colloque « L’avenir de l’économie européenne : que penser des rapports Noyer et Draghi ? » est disponible à la vente dans la boutique en ligne de la Fondation.
S'inscire à notre lettre d'informations
Recevez nos invitations aux colloques et nos publications.