Note de lecture de l’ouvrage de Stéphane Rozès, Chaos. Essai sur l’imaginaire des peuples (Le Cerf, 2022), par Marie-Françoise Bechtel, présidente de la Fondation Res Publica.
Cette note de lecture est suivie d’une conversation entre Marie-Françoise Bechtel et Stéphane Rozès, à partir du récent ouvrage de ce dernier.
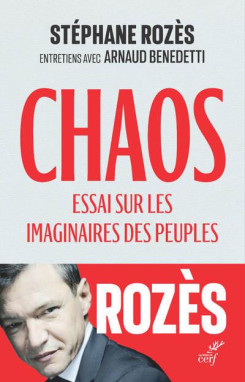
![]() Note de lecture de l’ouvrage de Stéphane Rozès Chaos Essai sur les imaginaires des peuples.pdf (280.2 Ko)
Note de lecture de l’ouvrage de Stéphane Rozès Chaos Essai sur les imaginaires des peuples.pdf (280.2 Ko)
Dans cet ouvrage inspiré qui n’est pas seulement le bilan d’une riche carrière de sondeur et de conseiller, mais ouvre des perspectives nouvelles de par sa valeur heuristique, Stéphane Rozès s’attaque de front à un invisible, celui de notre imaginaire collectif. Il ouvre par là un véritable chantier intellectuel qui ne laisse de côté aucune des questions fondamentales qu’une telle démarche peut susciter : en quoi d’abord est-il nécessaire, dépassant les présupposés des études d’opinion de fonder celles-ci sur ce qui dort dans notre inconscient collectif ? Comment ensuite définir celui-ci, avec quelles justifications épistémologiques, nourries à quelle source ? Et que dire enfin, au-delà de l’analyse de l’écrasement de notre imaginaire collectif, de ses chances de renouveau ou de plongée dans le chaos ?
Du quantitatif au qualitatif, un saut épistémologique
C’est d’abord à la méthodologie des études d’opinion et à leurs présupposés sous-jacents que s’attaque l’ouvrage, mûri par des années de pratique. Les pages nourries consacrées à la critique de la méthodologie pratiquée par les grands instituts de sondage et d’opinion ne se bornent pas à des critiques techniques mais s’attaquent au substrat lui-même qu’une certaine sociologie a conforté : ainsi on ne saurait, nous dit l’auteur, confondre la « représentation dominante » avec « l’idéologie dominante » qu’ont tenté d’imposer comme concept clé Bourdieu et ses disciples. Quant à la méthode quantitative privilégiée par les instituts comment, s’interroge-t-il, se fonder sur la quantification des opinions dès lors que les questions posées pour y parvenir échappent, faute de substrat analytique solide, aux conditions réelles dans lesquelles les consciences réelles appréhendent leur présent et leur avenir ? C’est donc un sentiment d’insatisfaction quant aux fondements des études d’opinion qui a conduit Stéphane Rozès au fil du temps à dégager l’hypothèse que l’explication des idées, opinions ou positions sur tel ou tel problème a pour substrat la conscience collective qui réunit un peuple autour d’une conception qui lui est propre de lui-même et du monde. Toutefois le passage du quantitatif au qualitatif (« les sondages « quantitatifs » sont une fenêtre permettant de mesurer ce qui bouge perpétuellement, quand les études qualitatives vont expliquer pourquoi cela bouge ») va au-delà d’un changement de méthode : il s’agit plutôt d‘un renversement de perspective. Là en effet où la quantification (« les quantis ») « mesure les mouvements perpétuels, les qualis m’ont permis d’accéder à l’idée qu’il y avait d’un côté le réel, de l’autre la réalité ». Affirmation risquée dirait un épistémologue biberonné à Husserl. Mais attendons la suite : s’ouvre à l’exploration un monde riche fait de la contradiction entre « ce que l’on dit aux sondeurs », et qui est conforme à « ce que l’on croit faire » et « ce que l’on fait ». Il y a bien là la saisie objective d’une contradiction trop fréquente et trop répétitive pour ne pas interroger. Si « les gens disent une chose et font le contraire », la tension entre ces deux polarités est ce qui ouvre le champ à une recherche plus exigeante : « le fait qu’il y ait une tension entre ce qui relève du dire et ce qui ressort du faire permet d’accéder par le dire aux fondamentaux de l’imaginaire parce qu’on dit le souhaitable, et que le faire résulte toujours d’une contrainte entre le souhaitable et le possible ».
L’imaginaire, ce concept-outil forgé par Stéphane Rozès fait donc ici son entrée. Une entrée remarquée d’ailleurs puisque c’est à partir de cet outil nouveau – même s’il ne l’avait pas encore formalisé – que Stéphane Rozès avait notamment inventé en 1995 « la grève par procuration » ou encore qu’il avait évoqué, j’en garde un souvenir personnel, dans l’échec de Ségolène Royal le souhait des Français, mal compris par la candidate, « de remettre la politique à l’Elysée », de la même façon que plus tard François Hollande devait à ses yeux échouer à comprendre que le pays ne demandait pas un président « normal » mais respecté, ce qui n’est pas la même chose. Si j’évoque ici ce succès passé de l’imaginaire tel qu’inventé par Stéphane Rozès, c’est qu’il me semble la preuve rétrospective de la valeur de l’outil d’interprétation qu’il a ainsi forgé. Ce regard nouveau était certes trop neuf (s’il ne l’est encore) pour des politiques engagés dans l’action à court terme et donc à courte vue. On sent bien en tout cas aujourd’hui combien la maturation de ces longues années de conseil et d’analyse, qui ne sont peut-être pas terminées, a nourri et affiné le concept d’« imaginaire » tout en le légitimant par la confrontation au réel.
L’« imaginaire des peuples », outil d’exploration et de confrontation au réel
L’auteur, porté par les questions exigeantes qui lui sont posées, approfondit le contenu de cet imaginaire, qu’il a dégagé comme un outil majeur de la compréhension de ce qui nous arrive.
L’imaginaire français d’abord. C’est dans la distanciation entre la politique et le politique que se trouve selon Stéphane Rozès le quid du malaise français, le facteur explicatif d’un désamour qui n’est pas indifférence. Si « chaque peuple noue avec le politique, dans le sens institutionnel, et la politique, une relation différente », cette relation se traduit chez le peuple français par « la centralité de la politique comme passion et l’Etat comme enjeu et référence de dispute commune ». De sorte que « la défiance du politique au sein de la société française ne signifie pas la baisse d’intensité de la passion pour le politique » comme le relève Arnaud Benedetti.
Quels sont donc les identifiants principaux de cet inconscient collectif qui, contrairement à l’opinion commune, est « exprimé » mais « n’est pas dit » ?
D’abord son rapport à l’universel. A lire les pages très éclairantes consacrées à ce sujet, on songe à ce qu’écrivait en 1932 Ernst Robert Curtius dans son Essai sur la France : la projection du Français vers l’universel est justement ce qui fait sa spécificité, et non l’inverse. Analyse qui reste juste aujourd’hui encore et à laquelle, des décennies plus tard, cet ouvrage apporte une remise à jour, un rafraîchissement et un contrôle a posteriori particulièrement bien venus.
Ensuite la verticalité : contrairement cette fois à l’approche de Curtius [1], Stéphane Rozès ajoute un élément essentiel qui est l’identification nationale par l’Etat [2]. En France c’est « le bas qui fait le haut » et ce contrairement aux apparences. Sur ce point, disons-le, la thèse peut sembler plus obscure : « le haut, l’Etat, a historiquement tenu le bas » mais ce serait « la dissémination du bas originel, les différents esprits de lieux, origines, statuts et intérêts de classe qui institue pour les assembler le surplomb et la verticalité du bas à l’unité du haut ». On peut admettre l’intérêt de cette hypothèse fondée sur la diversité des origines du peuple français et qui par ailleurs rend compte de la profonde singularité de la Révolution française. L’idée que « l’Etat a précédé la nation » laisse toutefois plus songeur [3].
Troisième trait marquant : notre conscience collective est inséparable de ce caractère politique que Marx attribuait déjà au peuple français. Ce peuple ne peut exister comme peuple sans la dispute autour du commun. Et cette dispute même manifeste non le déchirement de tendances centrifuges mais une sorte de hantise d’un débouché qui pourrait être commun, ce que l’on a nommé l’intérêt général. C’est la privation de cette possibilité de dispute, constitutive de notre être historique, qui fait la dépression française vis-à-vis de son avenir.
Stéphane Rozès nous dit aussi une chose particulièrement importante, c’est que l’imaginaire ne doit pas être confondu avec l’identité : il y a bien une crise identitaire en France mais cette crise exprime avant tout « la panne de notre avenir commun ». Pourquoi donc s’interroge Stéphane Rozès la France aurait-elle déployé un génie si singulier si l’identité française pouvait être réduite à une origine ? « Le sujet de la France, ce n’est pas l’origine chrétienne, c’est l’inverse. Ce sont les imaginaires qui donnent les modalités religieuses qui font qu’il y a le gallicisme en France (…) qui font que le catholicisme l’emporte sur le protestantisme et que les jésuites l’emportent sur les jansénistes » [4]. On le voit bien aujourd’hui : les défis dans lesquels les Français voient une impasse, à commencer par l’immigration, ne le sont que faute d’une vision de la construction de notre avenir puisque c’est justement en dépassant sa diversité, romaine, gauloise, celte, franque, que la France a pu se définir comme projet. Cette analyse est une illustration de plus de ce que le peuple ne peut se confondre avec l’opinion publique : c’est, comme on l’a dit, tout l’écart entre le « dit » et le fondement de ce que l’on exprime.
Tous ces traits : sens de l’universel, verticalité, goût de la dispute, intégration de la diversité dans un projet commun n’ont d’ailleurs de portée que dans et par la nation [5]. Ce constat, il est vrai, ne nous distingue pas, en ce sens que pour Stéphane Rozès tous les imaginaires sont nationaux. Mais il donne la mesure, pour nous Français en particulier, de la profondeur de l’atteinte à notre imaginaire dans ce qu’il a de plus fondamental : le caractère essentiel de notre besoin de nous projeter dans l’universel alors que nous n’avons plus les outils pour le faire.
Enfin, la notion d’imaginaire des peuples trouve sa portée – et en quelque sorte la preuve de sa pertinence- dans le constat qu’aucune nation n’y échappe. Dans un panorama dont la concision est compensée par un sens de la synthèse qui emporte le lecteur, Stéphane Rozès donne quelques traits principaux de ce qui fait selon lui l’imaginaire de nombreux peuples de la planète : de l’Allemagne dont l’esprit de discipline notamment en matière budgétaire « s’enracine dans un imaginaire où la procédure maintient un peuple traumatisé par de très anciennes divisions » notamment religieuses, à l’Espagne et au Portugal qui, « aux marches de l’Occident ont des imaginaires verticaux ». Ou encore sur l’imaginaire italien « archipélique qui se nourrit de la vie des cités-Etats ». On aimerait tout citer de ces synthèses très entraînantes. Ou trop ? On peut se poser la question de leur contrôle par l’histoire mais elles n’en ont pas moins dans leur concision, une puissance qu’on ne peut limiter à la simple rhétorique: ainsi de la Russie où l’imaginaire est « protecteur et impérial », nourri de « la nécessité de se protéger de l’envahisseur dans un immense espace », de Amérique latine où subsiste « un imaginaire onirique » lié au « rêve des origines », et comment ne pas citer ce que l’auteur « croit comprendre » de l’imaginaire chinois fait de la volonté de préserver une « harmonie (liée par l’histoire) à l’unicité ethnique des Han » ?
Les imaginaires collectifs : de l’écrasement au renouveau ?
Le récit de l’imaginaire de chaque peuple dans sa confrontation contemporaine à la puissance universelle du marché [6] est ainsi ce qui fait la conclusion de l’ouvrage. Les conclusions pourrait-on plutôt dire, caret c’est un des traits originaux de cet ouvrage qui en comporte beaucoup, l’essentiel de notre avenir est fait d’incertitudes et l’auteur ne tranche pas entre le pire et le possible.
Pour Stéphane Rozès non seulement l’universalisation du monde par l’économie et la finance est le contraire de notre propre sentiment de l’universel qui suppose un être politique mais la projection dans une construction du futur qui se limite à la « construction européenne » laisse dans le vide tout projet français ou plutôt : tout projet pour la France.
Le plus grave défaut de l’Europe est en effet à ses yeux qu’elle nous empêche de nous incarner : peut-être ce manque qui s’est aggravé depuis les débuts explique-t-il pourquoi, dépositaires eux-mêmes de l’inconscient collectif français, nos chefs d’Etat ont tenté à plusieurs reprises de fusionner notre imaginaire national avec un imaginaire européen qui peine à exister.
Les imaginaires des peuples ont largement en commun le désarroi, que nul ne peut plus nier, né de la confrontation à une mondialisation économique et financière qui fait éclater non seulement leur cadre de vie mais leurs références et leurs valeurs sociales, familiales, culturelles, linguistiques même. C’est la marginalisation de la nation dans les pays qui ne sont pas au premier rang de la puissance, typiquement les pays européens pour lesquels la construction d’un cadre commun est, on l’a dit, une perspective vide.
C’est aussi, brochant sur la tapisserie du néolibéralisme triomphant, la méconnaissance persistante de la part des élites de cette situation qui leur semble un épiphénomène et non un facteur de profonde déstabilisation pour l’avenir : où l’on retrouve la nécessité d’aller en profondeur rechercher les causes de phénomènes d’« opinion – et la résistance de la pensée dominante à le faire.
Au passage, notons que les pensées qui se veulent à rebours de la pensée dominante ne nous aident pas davantage à affronter le futur. La notion marxiste d’idéologie prend un coup sévère dès lors que c’est la nation qui est le socle indestructible de l’inconscient collectif des peuples, de tous les peuples.
Le résultat est que s’il est aujourd’hui un point commun à la mise à mal des imaginaires des peuples, fragmentés par la mondialisation, c’est bien le désarroi. Plus réel ou plus visible sans doute chez nous en Occident où l’incompréhension de la perte de la puissance non seulement économique mais largement axiologique définit le « chaos ». Quand les références de nos imaginaires ne s’ordonnent plus pour créer un univers mental cohérent, le moment arrive où la dissolution du collectif peut être envisageable.
Pour envisager une sortie du « chaos », sans doute faudrait-il revenir sur les trois erreurs fondamentales que dénonce Stéphane Rozès qui expriment en creux trois prescriptions pour les élites :
A refouler l’imaginaire des peuples, on se retrouve à ne plus comprendre son propre pays : il semble à l’auteur de ces lignes que la dérive du PS jusqu’à sa paralysie actuelle en est – entre autres – un exemple saisissant.
A se défier de cet imaginaire, on est conduit à baptiser « populisme » tout mouvement dont on ne comprend pas les racines : un mal très partagé dans la presse et la classe politique.
A ignorer son rôle déterminant dans l’adhésion au modèle de société qui peut prévaloir, on se condamne à ne pouvoir agir. Ce dernier vice, s’il procède des deux autres, n’en est pas moins le plus grave. C’est tel politologue qui explique le désamour des urnes par les « passions tristes » sans se demander le moins du monde – fût-ce à titre d’exercice épistémologique – si par hasard ces passions ne seraient pas, plutôt que la cause, le résultat de la privation de fait de l’influence du peuple sur les élus. C’est tel journaliste, tel élu qui disserte avec gravité sur la montée de l’extrême-droite en France comme une sorte d’accident de l’histoire. Et le portage massif de ces idées superficielles par les médias boucle encore un peu plus un système qui refuse de se remettre en cause. Quelle est alors la leçon de tout cela ? Quelle clé pour sortir du « chaos », facteur commun de l’éclatement des représentations de l’imaginaire collectif ?
La situation nous dit Stéphane Rozès est « systémique » : à son interlocuteur qui relève « la cupidité, l’inaptitude d’une partie des élites à comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons, le fait qu’un grand nombre de décisions se prennent loin du peuple », il répond que la rapidité et la profondeur de la régression est exceptionnelle. Voilà pour le diagnostic.
Alors le « que faire » ? Rien n’est possible sans la remise en selle du politique au sens de la vision du long terme. Consulté par les têtes de l’’exécutif comme par de nombreux acteurs de la vie publique, l’auteur ne sait que trop comment l’obsession du court termisme peut bloquer l’horizon de l’action politique. L’urgence d’en sortir n’en est pas moindre, un défi peut-être pour la génération qui vient. Pourtant selon lui rien ne peut nous sortir de l’impasse sans que l’on « redonne le pouvoir au politique ».
Peut-être en ce point de l’analyse aurait-on pu s ‘attendre à ce que Stéphane Rozès intègre à son approche la République – dont on aura noté qu’elle ne fait pas partie des facteurs identifiant notre inconscient collectif. En citant Napoléon : « Je suis de tempérament monarchique et d’esprit républicain », Stéphane Rozès semble faire de la République un phénomène non essentiel de notre imaginaire peut-être parce que pour lui l’Etat et la nation la précèdent dans notre univers mental et peut-être aussi parce qu’il pense avec Péguy qu’au fond elle ne se différencie pas de la monarchie.
Il faut en tout cas selon Stéphane Rozès évacuer les remèdes qui sont un cautère sur une jambe de bois : non, nous dit-il avec force, l’Europe ce n’est pas « la France en grand ». Sur ce point on ne saurait certes parier sur un avenir qui tirerait les leçons de ce constat, tant le poids de l’interdépendance des institutions européennes, du marché et des Etats est un facteur de résistance. Mais l’histoire est imprévisible et l’actuel conflit sur le sol européen obligera peut-être à rebattre les cartes.
Le facteur d’espoir réside finalement dans le fait que la France « ne consent pas » au triomphe du néolibéralisme : sinon, note justement Stéphane Rozès, elle ne serait pas dépressive. Dépression qu’il date du début des années 80 pour la classe ouvrière « rejointe par les classes moyennes au début des années 1990 ». [7]
Dire que la dépression nationale est un facteur d’espoir est certes paradoxal. Pourtant c’est bien ce refus qui peut ouvrir une autre voie vers l’avenir : elle dépendra de la force de résistance du peuple français et de sa capacité à relever une fois encore la tête contre des forces contraires comme, après tout, il l’a souvent fait dans son histoire. Encore ne faut-il pas oublier que pour St Rozès les scénarios multiples qui peuvent résulter de sa grille d’analyse n’inclinent pas à l’optimisme : « ce qui est probable selon moi est que nous allions au pire ». Car le chaos, produit par les résonances extérieures des évènements et évolutions du monde, se marque et se marquera par « ce réflexe premier qui consiste à percuter les autres […] pour régler ses problèmes internes ». Sa prescription serait-elle alors de « dire le chaos », en laissant au banc des espoirs impossibles toutes les rudes disputes pour un avenir meilleur qui ont marqué la génération d’après-guerre : « Tout cela pour en arriver là ! » Signant « l’échec générationnel » de ceux qui ont voulu se battre pour l’intérêt général, le chaos exprimerait alors le fait que « la mondialisation tarde à se civiliser » et du moins faudrait-il, contre tous nos espoirs passés, l’exprimer clairement. On sent la tentation du désespoir – et qui d’entre nous d’ailleurs n’a pu l’éprouver ? Tout au mieux peut-on admettre qu’« une course de vitesse est engagée entre une recivilisation de la mondialisation d’une part et d’autre part la poursuite du délitement mondial et les affaissements nationaux conduisant aux guerres ». La crise, la vraie, celle de l’effondrement des Etats et des peuples, le « retour du tragique » est une hypothèse historiquement envisageable car l’histoire est cyclique. « Réparer les imaginaires » est selon Stéphane Rozès le remède de fond. Mais il est sans alternative.
Conclusion
On l’aura compris : dans cet ouvrage Stéphane Rozès ne fait œuvre ni de sondologue ni de militant. Il a, expose-t-il, été les deux. Trop de choses le séparent du métier de détecteur et d’analyste d’une opinion qu’il ne peut plus se résoudre à interroger ou décrypter en s’en tenant à la surface. Et pour ce qui est de l’engagement politique, qui l’a notamment, comme on sait, conduit à suivre Jean-Pierre Chevènement dont il relève la pertinence de la vision et la force du combat, il considère que le choix de militer n’est pas compatible avec cette distance nécessaire qu’appelle l’analyse avec le privilège donné aux faits. Me pardonnera-t-il de dire que cet ouvrage profond et inventif n’en est pas moins une nourriture idéale pour ceux qui veulent regarder les yeux ouverts l’avenir de notre République, comme a toujours essayé de le faire notre Fondation ?
—–
[1] Voir l’échange ci-après.
[2] Sur ce point l’analyse de Stéphane Rozès s’écarte d’ailleurs sensiblement de celle de Curtius, voir l’échange ci-après.
[3] C’est faire assez bon marché, peut-il sembler, de la France de Philippe Auguste (au plus tard) dans laquelle la formation de l’unité française était inséparable des débuts de la centralisation monarchique…La France a-t-elle été constituée autrement que dans une dialectique Etat-Nation ? Et en ce cas peut-on vraiment faire du premier une entité préexistante à la seconde ?
[4] Comment ne pas songer à la vérification de ce postulat par la création de l’Eglise anglicane par laquelle une grande nation renationalise le pouvoir spirituel sur son territoire propre ?
[5] Au point que pour lui « ce qui va faire évènement révolutionnaire total et violent c’est Varenne », autrement dit la nation.
[6] Il est intéressant de constater que cette période correspond à la mise en panne de l’ascenseur social dans l’éducation telle qu’elle résulte des statistiques et étude de l’Insee.
[7] Henry Kissinger soulignait qu’en cent ans, du congrès de Vienne à la première guerre mondiale, l’Europe avait perdu « le sens du tragique » et « oublié que les Etats sont mortels, que les bouleversements peuvent être irrémédiables, que la peur peut devenir le ciment de la cohésion sociale » – cité par Thierry de Montbrial, Perspectives, Ramsès 2023.
S'inscire à notre lettre d'informations
Recevez nos invitations aux colloques et nos publications.

